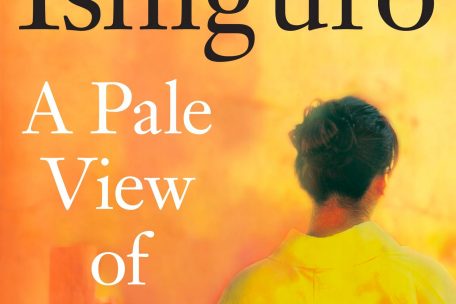
Kazuo Ishiguro est un écrivain peu prolifique: depuis la parution de son premier roman, „A Pale View of Hills“, en 1982, et „Klara and the Sun“ en 2021, l’écrivain britannique aux origines japonaises a publié huit romans et un recueil de nouvelles. Le soin extrême qu’il porte à ses romans contraste quelque peu avec la simplicité apparente de son style, derrière laquelle se cache un art de l’épure, des constructions narratives diablement complexes, des mondes noirs d’une plasticité rare ainsi que des narrateurs dont chaque assertion ou presque est à évaluer avec précaution.
Là où d’autres écrivains nobelisés – l’on pense à Patrick Modiano – donnent l’impression de toujours écrire le même livre, les romans d’Ishiguro paraissent différer radicalement d’un opus à l’autre alors même qu’une lecture plus précise laisse entrevoir des fils rouges présents dès le premier roman, qui reviennent et s’enchevêtrent de façon obsessionnelle et qui ont toujours à voir avec les imperfections de la mémoire, la guerre et le pardon, l’art de se mentir à soi-même et le choc d’une confrontation tardive avec le réel.
L’œuvre de Kazuo Ishiguro est communément dite se scinder en deux, avec trois premiers romans („A Pale View of Hills“, „An Artist of the Floating World“ et „The Remains of the Day“) qui se déroulent dans un cadre historico-réaliste précis – le Japon et l’Angleterre d’après-guerre –, et quatre romans qui s’éloignent de plus en plus d’un tel cadre, jouant avec des genres paralittéraires tels le roman policier, la science-fiction et la fantasy plutôt que de s’en prendre au réel en soi.
Malgré le cadre réaliste des premiers romans, qui se déroulent tous trois aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, ces trois œuvres sont déjà imprégnées de ce caractère abstrait et allégorique que l’auteur adoptera de plus en plus au cours des années et qui sera la clé de voûte de son récent „The Buried Giant“ où, partant de conflits bien réels – la guerre en Bosnie-Herzégovine et la vie commune, sur un même territoire, d’une population qui s’est jadis entretuée –, l’auteur imagine un pays sur lequel plane une brume mystérieuse plongeant ses habitants dans une amnésie collective protectrice. Cette brume permet une cohabitation pacifique aux Bretons et Saxons après des années de conflits sauvages au cours desquels les Bretons, menés par le roi Arthur, ont brisé leur promesse d’épargner les innocents, saccageant des villages, massacrant leurs habitants (Srebrenica n’est pas loin).
Alors que le modus operandi d’Ishiguro vise, depuis au moins „Never Let Me Go“, à trouver dans les univers et tropes de la science-fiction ou de la fantasy un décor propice à l’universalisation de thématiques qui le préoccupent, les premiers romans d’Ishiguro extraient au contraire de l’universel en partant du particulier.
La période réaliste – entre histoire et abstraction
Dans „A Pale View of Hills“, Etsuko, qui a quitté le Japon pour déménager en Angleterre (ce qu’on fait les parents du jeune Kazuo, qui s’est retrouvé en Angleterre à l’âge de cinq ans), raconte la visite de sa fille cadette Niki après le suicide de sa demi-sœur Keiko. C’est l’occasion pour la mère endeuillée de se rappeler l’amitié étrange qui la liait, l’espace de quelques semaines d’été, à Sachiko, une mère solitaire venue se réfugier avec sa fille dans un chalet délabré à Nagasaki. Le récit des quelques jours passés en présence de sa fille s’emmêle progressivement avec les souvenirs de cet étrange été, alors qu’elle était enceinte de sa première fille Keiko.
Ce premier roman cumule les non-dits et les ellipses: le suicide de Keiko est tout aussi peu évoqué que la guerre, la bombe atomique et le père de Niki, un Anglais pour lequel Etsuko a quitté son premier mari Jiro et le Japon, tous éléments qui hantent cependant les moindres gestes et situations narratives, faisant de cette première œuvre un récit qui déborde de toutes parts, où chaque phrase prend un poids terrible, malsain, imprégnée qu’elle est de traumatismes personnels et sociétaux irrésolus. Ishiguro y montre déjà comment le non-dit engendre des existences ratées, qui pataugent dans la noirceur.
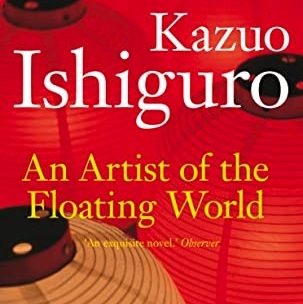
„An Artist of the Floating World“ poursuit l’exploration d’une société japonaise d’après-guerre de plus en plus influencée par la culture occidentale. A travers le regard du peintre Masuji Ono, qui a perdu sa femme et son fils dans la guerre et dont l’œuvre, après un apprentissage auprès d’un mentor spécialisé dans la représentation d’un monde nocturne débauché, a pris un tournant patriotique, militant et militaire, Ishiguro dépeint une société japonaise qui essaie de se reconstruire après le désastre des égarements fascistes de la Deuxième Guerre mondiale.
Comme souvent chez Ishiguro, l’intime et le politique s’enchevêtrent de manière subtile: alors qu’Ono déplore que son petit-fils Ichiro incarne, lors de ses jeux de make-believe, des cowboys américains plutôt que des samouraïs japonais, ses deux filles encouragent une telle hybridité culturelle parce qu’elle détourne d’un héritage cultuel néfaste, utilisé à des fins patriotiques et belliqueuses en amont et pendant la guerre. Ono, d’abord d’une vanité totale, finit par revisiter son passé en admettant son rôle d’artiste de propagande tout en cherchant quelle fonction il peut encore endosser dans une société où les suicides des maîtres d’antan sont considérés, par la nouvelle génération, comme une épure nécessaire à la renaissance du pays.
Responsabilité individuelle, culpabilité collective
„The Remains of the Day“, couronné par le Booker Prize et adapté au cinéma par James Ivory, reprend le sujet de la responsabilité et de la culpabilité individuelles dans un égarement collectif. Alors qu’un riche Américain reprend la propriété du décédé Lord Darlington, Stevens, le majordome de la maison, entreprend de traverser l’Angleterre dans le but de convaincre Miss Kenton de revenir travailler dans la prestigieuse demeure.
Au cours du trajet, Stevens en vient à se pencher sur son passé et la dignité qui, selon lui, devrait caractériser tout majordome qui se respecte, dignité qui l’amena à servir repas, thé, cognac et cigares à des nazis – car Ribbentrop fut l’un des principaux invités de son maître – pendant que son père, majordome lui aussi, se mourait dans la solitude. Stevens, d’abord fier de sa carrière qu’il passe en revue, finira par réaliser qu’il s’est entièrement mis au service de quelqu’un qui, par naïveté et amateurisme, était dévoué à la mauvaise cause, ratant ainsi sa vie professionnelle tout en ayant négligé sa vie intime.
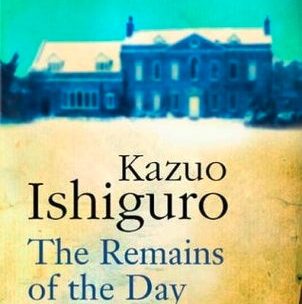
Si ces romans historiques paraissent en partie abstraits, c’est non seulement parce que les narrateurs tournent autour du pot, hésitant à dire les traumatismes personnels et collectifs ou à reconnaître leurs fautes, mais aussi parce que ces récits fonctionnent par ellipses. Les sujets cruciaux ne sont pas simplement écartés en faveur de trivialités – ces mêmes truismes deviennent d’habiles façons d’exprimer ce qu’on n’ose pas aborder. Ainsi, pour aborder sa part de responsabilité dans la collaboration passive et les penchants antisémites de son employeur, Stevens évoquera d’abord pendant des pages et des pages de la dignité du majordome.
Malgré une telle abstraction, les œuvres d’Ishiguro sont éminemment politiques: qu’il écrive un roman historique ou fantastique, la culpabilité collective, le pardon et la vengeance imprègnent jusqu’à la plus touchante des histoires amoureuses. Dans „The Buried Giant“, la quête du vieux couple Axl et Beatrice, qui part à la recherche d’un fils perdu dans un monde où pullulent ogres, fées maléfiques et dragons, est aussi une quête pour dissiper l’amnésie collective, le retour de la mémoire se soldant pourtant aussi par un retour des inimitiés.
Scindée en deux
Au beau milieu de la scission de l’œuvre ishigurienne entre réalisme et paralittérature trône un monolithe noir et incompris par la critique: „The Unconsoled“, paru en 1995, est une œuvre on ne peut plus étrange, sorte de réécriture du „Château“ de Kafka par David Lynch au cours de laquelle l’on voit un pianiste mondialement reconnu, Ryder, débarquer au beau milieu d’une ville inconnue et insituable pour y donner un concert d’une importance capitale, qui déterminerait le sort et l’avenir de toute une communauté.
Au cours de ses journées préparatoires, le pianiste rencontrera les différents membres de la communauté, qui tous l’assaillent de leurs petits griefs, le confrontant avec leur mal-être en le priant de bien vouloir y remédier, voyant en lui une sorte de Messie venu les délivrer de toutes sortes d’angoisses, se voilant collectivement la face en plaçant un espoir démesuré en un artiste débordé et impuissant – à moins que Ryder n’affabule tout cela et n’exagère le rôle qu’il pense qu’on lui confie.
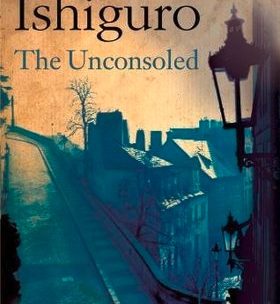
Les dédales de la ville sont labyrinthiques, les lieux se déplacent, se condensent et s’étirent comme dans un cauchemar, la salle de concert est toute proche mais en même temps inaccessible, les personnages changent de personnalité et d’identité, Ryder est en proie tour à tour à une amnésie complète et à des moments d’omniscience lui permettant de lire dans les pensées d’autrui: „The Unconsoled“ donne à lire un monde tissé d’incertitudes, une variation extrême et cauchemardesque d’une vision proustienne qui veut que les hommes soient en proie aux changements de personnalité les plus vertigineux.
Situé à part dans l’œuvre d’Ishiguro, „The Unconsoled“ marque un tournant dans la carrière de l’auteur, l’amenant à s’éloigner des univers réalistes pour s’intéresser à l’avant-garde et aux genres paralittéraires. L’on y retrouve, condensés et exacerbés, des sujets qui lui sont chers: les défaillances de la mémoire, l’amnésie et le cocon protecteur que cette dernière garantit à ceux qui ont du mal à affronter le réel; l’enfance et la relation compliquée, tissée d’abandon et de crainte, que les narrateurs entretiennent avec leurs parents; le récit comme fuite en avant, où l’on se retrouve „soi-même comme un autre“, comme le disait Paul Ricœur.
Le jeu avec les genres
Dans le Shanghai International Settlement, le jeune Christopher Banks grandit dans un cocon protecteur, passant ses journées entouré de parents aimants et jouant au détective avec son ami Akira. Après la disparition de ses géniteurs, Banks grandit auprès de sa tante, en Angleterre, et grandit pour devenir un enquêteur de renommée obsédé par l’idée de retrouver ses parents, qu’il s’imagine kidnappés par des malfrats. Retournant dans un Shanghai miné par la guerre sino-japonaise, le jeune enquêteur est convaincu que la résolution de l’énigme autour de la disparition de ses parents mettra fin à au conflit qui taraude l’Asie et empêchera l’éclosion de la Deuxième Guerre mondiale.
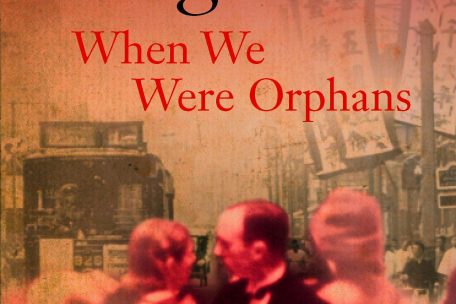
L’idée selon laquelle la mimesis et les jeux de make-believe des enfants contribuent durablement à notre perception du réel est au cœur de „When We Were Orphans“: Christopher Banks lit le monde adulte à la loupe de ses jeux d’enfance. Le roman est une charge contre les romans policiers traditionnels, lors desquels un enquêteur vient restaurer l’ordre dans un monde bourgeois chamboulé par un crime isolé: dans une réalité où les crimes, massacres et génocides sont quotidiens, la figure de l’enquêteur est archaïque, poussiéreuse et inutile, un vestige de temps meilleurs.
Après son excursion dans le roman policier, Ishiguro s’intéresse à l’uchronie: dans „Never Let Me Go“, Kathy H. raconte son enfance et son adolescence dans une école privée de l’Angleterre des années 90. Rien de plus normal, pense-t-on d’abord, que leurs enseignants les enjoignent à la prudence et leur disent de bien prendre soin de leur santé et de leurs corps. Sauf qu’on apprend assez vite que ces jeunes élèves sont en réalité des clones humains dont la seule finalité est de donner leurs organes à de riches Anglais. Le système dans lequel ils sont pris est clos et autopoïétique: une fois leur éducation terminée, ils deviennent des „carers“, qui prennent soin de leurs amis déjà malades à force d’avoir donné des organes avant de recevoir eux aussi, fatalement, une première invitation qui marque leur lent acheminement vers une mort prématurée.
Indigne de confiance?
Si les romans de Kazuo Ishiguro dégagent tous une ambiance étrange, c’est souvent dû à la lecture du monde particulière de leurs narrateurs, qui se voilent les yeux sur la réalité qui les entoure et le rôle qu’ils y jouent, qu’ou bien ils exagèrent de façon malsaine ou alors ils rabaissent d’une façon tout aussi pathologique, quand ça n’est pas un mélange explosif des deux. Si Ishiguro est devenu le maître de la narration indigne de confiance, c’est qu’il a montré que personne n’est digne de confiance dans sa façon de se raconter sa vie et que nous mentons pour la plupart du temps non par méchanceté mais pour nous protéger de réalités désagréables (le Lustprinzip freudien). Alors qu’avant Ishiguro, les narrateurs indignes de confiance étaient souvent de purs arnaqueurs lucides, les personnages ishiguriens ne sont pas conscients des modifications qu’ils font subir à leur réalité – et recourent à différentes formes de mensonge.
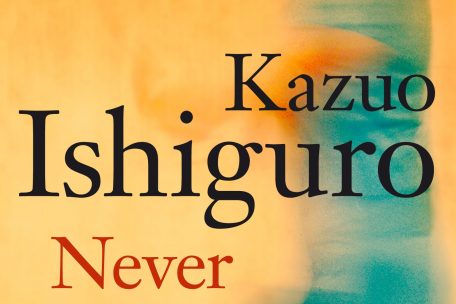
Ils mentent par omission: l’ellipse est un des principes sémantiques fondamentaux de l’œuvre d’Ishiguro. Ils taisent par analogie: quand, dans „An Artist of the Floating World“, Ono est sur le point de narrer l’éviction qu’il a fait subir à son disciple Kuroda, qu’il a dénoncé de surcroît à un comité artistique de propagande, il préfère remonter en arrière et raconter comment lui-même tomba en disgrâce auprès de son mentor Mori – le parallélisme des deux situations lui permet de raconter une scène pour dire l’autre, de façon métonymique, afin de ne pas devoir se remémorer tout à fait le rôle de salaud qu’il a joué et de se retrouver dans la situation de la victime.
Ces narrateurs interprètent mal le monde – parce que l’interpréter à sa juste valeur signifierait abandonner tout espoir. Ils sont incapables d’exprimer leurs méprises et leurs émotions, raison pour laquelle ils parlent sans jamais réussir à se dire quoique ce soit. L’euphémisme est leur arme rhétorique favorite: il leur permet de raconter le pire avec des mots neutres, faussement objectifs, horriblement banals – dans „Never Let Me Go“, pour dire qu’un de leurs amis vient de décéder, ils disent qu’il „has completed“, la fonction pour laquelle il fut né ayant été accomplie.
Ils sont presque toujours dans l’esquive narrative: à chaque fois qu’ils sont sur le point d’affronter un moment douloureux de leur vie, ils commencent à digresser, à parler d’autre chose, retardant le moment d’affronter la vérité jusqu’à ce que cette vérité, inévitablement, prenne le dessus. Ainsi, le lecteur lit constamment à rebrousse-poil, restituant, là où il peut, un monde fictionnel qui se construit avec la complicité de l’écrivain – mais au détriment du narrateur et de ses illusions.
La mémoire et la structure
Enfin, s’ils sont indignes de confiance, c’est parce que toute mémoire l’est, inévitablement. Là-dessus, ils sont bien plus honnêtes que des narrateurs traditionnels, qui souvent restituent dans leur intégralité des échanges qui ont eu lieu des années plus tôt. Le narrateur ishigurien admet très souvent se souvenir mal, il confesse qu’il a déjà trop souvent relaté un souvenir qui le préoccupe et que cette répétition colore a posteriori ses réminiscences. Parfois, ils font se rattacher des bribes de phrase qui leur trottent dans la tête à deux situations entièrement différentes, ces scènes flottant alors dans le récit sans qu’on puisse être certain de leur réalité.
Les récits d’Ishiguro ne sont jamais linéaires et les chapitres souvent construits en boucle, un déclic mnésique faisant digresser le personnage, qui raconte alors un autre souvenir, ce dernier déclenchant à son tour une autre scène, les souvenirs s’enchâssant jusqu’à ce que le narrateur remonte à la surface et finisse par raconter l’épisode par lequel il avait voulu commencer, Ishiguro excelle à montrer que notre mémoire fonctionne par liens thématiques, métaphoriques et métonymiques plutôt que par séquentialité chronologique et que c’est à cause de cet entrelacs que nos souvenirs perdent en précision, qu’ils se mangent les uns les autres, se contaminent: notre identité se construit à travers un passé qui nécessairement nous échappe, que nous colorons subjectivement pour nous faire tenir le beau rôle ou au contraire un rôle peu reluisant, mais où nous voulons tous tenir un rôle principal – de héros ou de méchant – alors qu’en vérité, nous n’étions peut-être que des personnages secondaires.

Un majordome efficace, explique Stevens à la fin de son récit, est celui qui donne l’illusion de la simplicité et arrive à camoufler la complexité du travail organisationnel: „I believe I even revealed to him (…) the various ,sleights-of-hand‘ – the equivalent of a conjuror’s – by which a butler could cause a thing to occur at just the right time and place without guests even glimpsing the often large and complicated manoeuvre behind the operation.“ En ce sens, l’art ishigurien s’apparente à celui du majordome accompli: si le lecteur croit lire un „simple“ roman de science-fiction ou de fantasy, c’est que l’auteur parvient à camoufler les „manœuvres vastes et compliquées“ qui se déroulent dans les coulisses de son écriture – et qui font toute la précision et la fascination d’une œuvre qui, en dépit de son excentricité et de sa simplicité apparentes, parle de l’identité trouble qui gît en chacun de nous.









Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können