Reprenons brièvement pour ceux qui n’étaient pas là la semaine dernière: la littérature contemporaine voit le retour, dans les oeuvres primées à la fin de l’année dernière tout comme dans ses parutions récentes, du réel sous trois formes différentes – l’Histoire, l’actualité et le moi. Au cours de cette série en douze épisodes, nous nous efforcerons d’analyser les tenants et aboutissants de ces tendances tout en nous demandant si cet excès de réel n’asphyxie pas le littéraire.
De Jeff Schinker
Parmi les romans couronnés en novembre dernier, nombreux sont ceux qui évoquent la période traumatisante des années quarante: „La serpe“ de Philippe Jaenada (prix Femina) déroule son intrigue policière de fait divers sur l’arrière-fond de l’Occupation française alors qu’“Un certain M. Piekielny“ de François-Henri Désérable, figurant dans les dernières sélections de presque tous les prix littéraires de l’année dernière (pour finir les mains vides, la vie est injuste), évoque, à travers un personnage de Romain Gary, le ghetto juif à Vilnius.
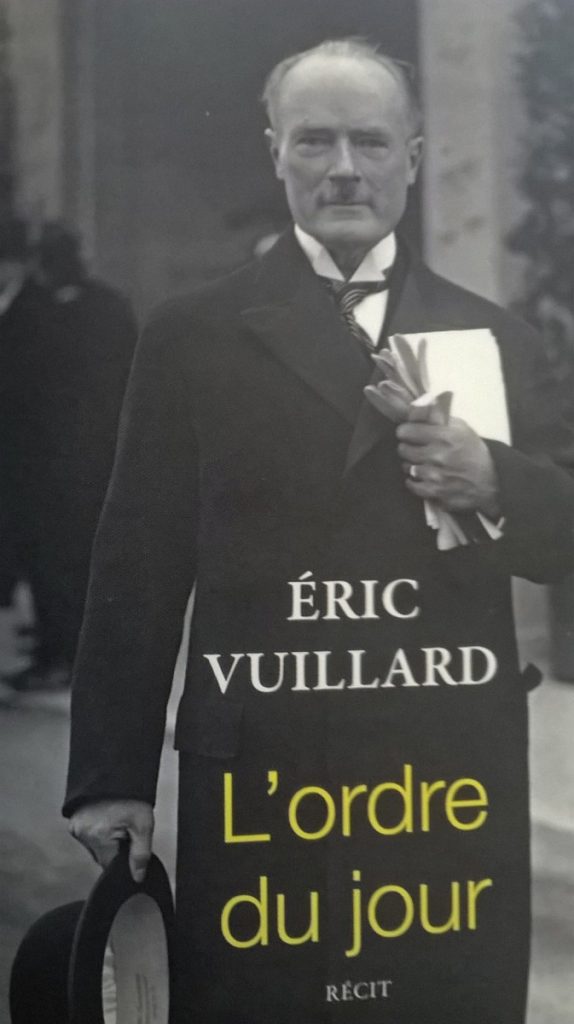 Quant aux deux autres ouvrages primés au centre de nos analyses aujourd’hui, ils sont entièrement consacrés aux sombres années 40 à un moment où le retour en force de l’extrême-droite un peu partout en Europe se fait sentir comme une douloureuse piqure de rappel de la bêtise humaine.(*) Ainsi, „La disparition de Josef Mengele“ d’Olivier Guez (prix Renaudot) évoque (sans surprise) la vie de Mengele après la fin de la Deuxième Guerre mondiale alors que „L’ordre du jour“ d’Eric Vuillard (prix Goncourt) tourne autour des lâchetés et complaisances politiques de l’Autriche et de l’Angleterre et des négociations entre les grands industriels comme Opel, BMW, Krupp et autres.
Quant aux deux autres ouvrages primés au centre de nos analyses aujourd’hui, ils sont entièrement consacrés aux sombres années 40 à un moment où le retour en force de l’extrême-droite un peu partout en Europe se fait sentir comme une douloureuse piqure de rappel de la bêtise humaine.(*) Ainsi, „La disparition de Josef Mengele“ d’Olivier Guez (prix Renaudot) évoque (sans surprise) la vie de Mengele après la fin de la Deuxième Guerre mondiale alors que „L’ordre du jour“ d’Eric Vuillard (prix Goncourt) tourne autour des lâchetés et complaisances politiques de l’Autriche et de l’Angleterre et des négociations entre les grands industriels comme Opel, BMW, Krupp et autres.
Ce qui fait l’intérêt des deux œuvres, c’est qu’elles choisissent toutes deux d’aborder la question du nazisme (et donc celle, plus métaphysique, du mal) sous des angles temporels différents et décalés. A aucun moment, nous ne sommes plongés au cœur de la Deuxième Guerre mondiale: le récit de Vuillard se situe en amont du conflit, explique ses prémisses et narre ses débuts alors que celui de Guez se situe dans l’après pour montrer avec quelle léthargie non seulement l’Allemagne, mais le monde entier a réagi aux horreurs du nazisme, comme s’il avait fallu des décennies avant qu’on se rende compte de l’ampleur du désastre – on connaît la rengaine, tout réveil est dur, pour preuve, ce matin, j’ai mis vingt minutes à me lever – ou, sous un point de vue plus pessimiste, comme si les rouages du nazisme étaient si profondément ancrés encore dans la société d’après-guerre qu’il fut bien pratique de se fermer les yeux sur le tragique de ce qui eut lieu.
La brume, qui, dans „The Buried Giant“ de Kazuo Ishiguro, plonge le pays du roman dans une amnésie collective, symbolise peut-être au mieux ces années après-guerre: ainsi, Guez écrit-il que ce n’est qu’aux alentours de 1956 que le monde découvre peu à peu l’extermination des juifs d’Europe. C’est pendant la même année, en novembre, que Mengele recevra, un passeport allemand à son nom.
On connaît les histoires de recyclage des nazis „intéressants“ par l’Amérique – l’exemple de Wernher von Braun est symptomatique – mais, néanmoins, les recherches de Guez laissent parfois quelque peu pantois.
Chez Vuillard, la consternation prend une légèreté ironique qui nous montre que ces leaders, de fait, n’étaient souvent pas très intelligents: il faut lire la scène d’ouverture, où Vuillard cherche à piéger les 24 industriels en arguant que la littérature permet tout: „je pourrais donc les faire tourner à l’infini dans l’escalier de Penrose, jamais il ne pourraient plus descendre ni monter“, tout comme il faut méditer cette scène où les Ribbentrop, de visite chez Chamberlain, retardent expressément le moment de s’en aller pour empêcher celui-ci de pouvoir réagir à la nouvelle reçue au cours de la visite, nouvelle qui annonçait l’invasion de l’Autriche par les troupes allemandes. Encore faut-il se demander si l’humour et l’ironie sont des moyens de lutte efficaces face au combat contre une extrême droite dénuée du premier et qui n’a souvent pas les moyens intellectuels de saisir les subtilités de la deuxième.
Dans les deux œuvres, le fait de raconter le nazisme en amont et en aval a une fonction d’alerte évidente. On nous fait voir que, non, ça n’était pas simplement le résultat, comme on aimerait bien que ça soit le cas pour dédouaner l’humanité, pour la déresponsabiliser, d’un égarement passager, ça n’était pas simplement une parenthèse de folie sanguinolente et indicible: ça s’est lentement préparé, ça s’est longuement prolongé et, de fait, ça n’a jamais vraiment disparu – comme l’écrit Vuillard, ces entreprises dont les représentants ont signé un pacte avec Hitler sont parmi nous et leurs produits se perpétuent au sein de notre quotidien.
Pouvoirs du littéraire
Pourtant, il nous faut aller plus loin. En temps de crises, la littérature peut-elle se contenter d’assumer un rôle d’alerte? Peut-elle être simplement mimétique? Ne devrait-elle pas, plutôt que de revenir sur le passé pour nous indiquer son éventuel retour, extrapoler vers les possibilités glauques qui nous attendent? Peut-elle se contenter de se faire museler par le réel, de venir toujours dans l’après, quand tout a déjà été fait et où est alors la transcendance? Quel rôle reste-t-il au littéraire une fois que l’Histoire l’a investi?
Olivier Guez et Eric Vuillard y répondent chacun à leur manière, Vuillard en ironisant à tout va, Guez en donnant à son texte une sobriété journalistique qui sonne juste: évidemment, il n’y a aucun besoin de rajouter une indignation stylistique à quelque chose qui révolte déjà rien que par les faits. A lire comment toute une bande de nazis mène plus ou moins la belle vie sans même devoir retourner sa veste – l’Argentine les accueille presque à bras ouverts –, l’on ne peut qu’être intérieurement révolté.
Car le roman historique a ceci de fâcheux qu’il doit bafouer le principe classique selon lequel le vrai n’est parfois pas vraisemblable: quand on lit comment le Mossad passe plusieurs fois juste à côté de l’arrestation de Mengele, on se dit que dans un roman, une telle scène n’aurait pas été perçue comme vraisemblable. Hélas, ici, elle se contente de reproduire la vérité historique.
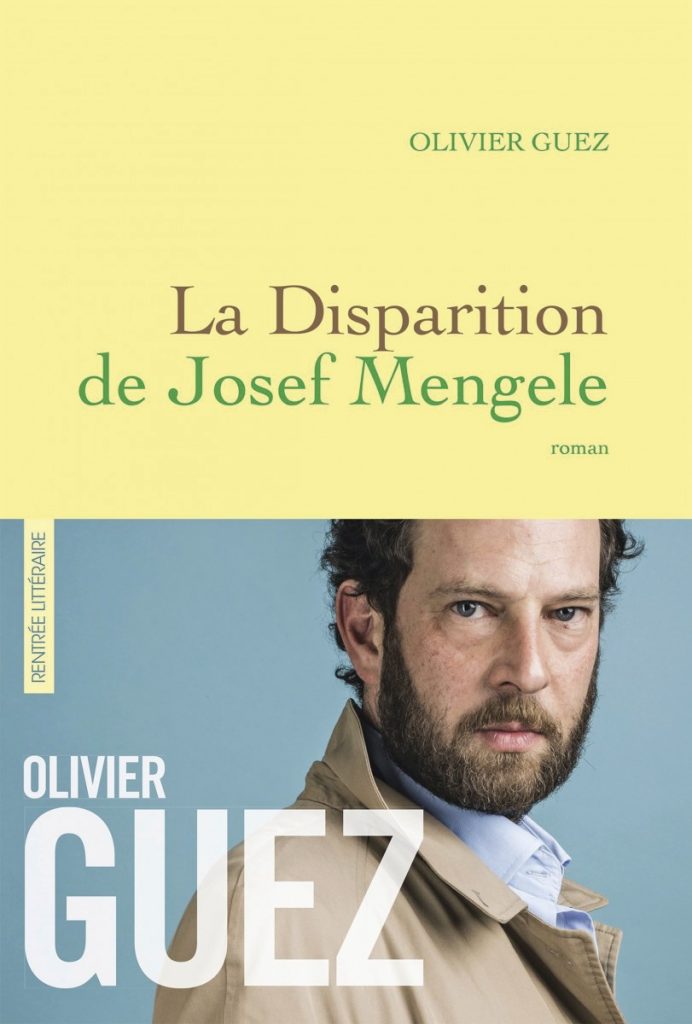 Une question plus centrale pour nos propos est peut-être celle du genre: là où le texte d’Eric Vuillard se distancie d’emblée du fictionnel de par sa labellisation (il s’agit d’un récit), „La disparition de Josef Mengele“ se veut un roman. Pour la chercheuse Dorrit Cohn, le propre du fictionnel s’observe à chaque fois que la fiction s’approche de ses frontières. Le roman historique est un tel cas limite ou hybride puisqu’il est un roman – donc une invention – qui s’en tient aux faits. Comme le dit Olivier Caïra dans „Définir la fiction“, une œuvre de fiction peut décider pour elle-même ce qui est vrai dans les mondes qu’elle développe (pensons à Vuillard tenté d’enfermer les nazis dans sa cage d’escaliers) – et quel rapport elle entretient avec la vérité historique. Dans „La disparition de Josef Mengele“, on assiste à un musèlement du fictionnel par les faits: la seule différence avec l’ouvrage de l’historien consiste ici à ce que Guez plonge, à la façon d’un romancier, dans la conscience de Mengele. Si les états d’âme qu’il décrit semblent à chaque fois fondés sur des faits historiques et peuvent être inférés d’après ce que l’on sait de l’affreux personnage, l’historien doit accompagner ses spéculations de formules du genre (quand Mengele se voit éjecté d’un logis) „il n’a probablement pas aimé qu’on lui ait refusé le refuge“, là où la fiction historique peut se permettre d’envoyer valser cette courtoisie en écrivant: „Il se fâcha qu’on ne voulût plus l’héberger.“
Une question plus centrale pour nos propos est peut-être celle du genre: là où le texte d’Eric Vuillard se distancie d’emblée du fictionnel de par sa labellisation (il s’agit d’un récit), „La disparition de Josef Mengele“ se veut un roman. Pour la chercheuse Dorrit Cohn, le propre du fictionnel s’observe à chaque fois que la fiction s’approche de ses frontières. Le roman historique est un tel cas limite ou hybride puisqu’il est un roman – donc une invention – qui s’en tient aux faits. Comme le dit Olivier Caïra dans „Définir la fiction“, une œuvre de fiction peut décider pour elle-même ce qui est vrai dans les mondes qu’elle développe (pensons à Vuillard tenté d’enfermer les nazis dans sa cage d’escaliers) – et quel rapport elle entretient avec la vérité historique. Dans „La disparition de Josef Mengele“, on assiste à un musèlement du fictionnel par les faits: la seule différence avec l’ouvrage de l’historien consiste ici à ce que Guez plonge, à la façon d’un romancier, dans la conscience de Mengele. Si les états d’âme qu’il décrit semblent à chaque fois fondés sur des faits historiques et peuvent être inférés d’après ce que l’on sait de l’affreux personnage, l’historien doit accompagner ses spéculations de formules du genre (quand Mengele se voit éjecté d’un logis) „il n’a probablement pas aimé qu’on lui ait refusé le refuge“, là où la fiction historique peut se permettre d’envoyer valser cette courtoisie en écrivant: „Il se fâcha qu’on ne voulût plus l’héberger.“
Le côté romanesque se situe ici aussi, peut-être, comme on l’a dit plus haut, dans ce que la chercheuse allemande Monika Fludernik appelle l’expérientialité plus poussée de la fiction. Peter Lamarque et Stein Haugom Olsen parlent pareillement, dans leur ouvrage séminal „Truth, Fiction, and Literature“, d’une connaissance fictionnelle, qui se caractériserait par le fait qu’outre d’apprendre comment ça s’est passé, la fiction permet de passer à l’intérieur du vécu là où les faits nous gardent à l’extérieur. La part d’invention étant ici de nous mettre dans la peau d’un monstre pour qu’on ressente au mieux l’ignominie.
(*) Dans „Le Dossier M“ auquel nous reviendrons, Grégoire Bouillier note que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité (ou, peut-être, depuis que nous le mesurons statistiquement), le quotient d’intelligence moyen de notre espèce est en train de chuter. Notons que ce même Bouillier minusculise tout au long de son texte les tyrans, dictateurs et génocidaires du dernier siècle: Hitler devient hitler, Staline staline.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können