„Trust is a hard thing to come by these days“, chantait Nick Talbot, décédé à l’âge de 37 ans, sur la chanson éponyme de Gravenhurst, résumant de façon assez laconique les quelque 400 pages et quatre livres dans le livre qui constituent le deuxième roman de Hernan Diaz.
L’ingéniosité de celui-ci commence par son titre: si „Trust“ désigne évidemment la confiance – celle que se font (ou non) deux êtres au sein d’un couple et qui détermine si toutes les zones d’ombre qui subsistent entre ces êtres seront bénéfiques ou ravageuses pour la relation –, la polysémie du titre veut que Diaz, ici, fasse aussi allusion à cet acte juridique dans lequel „un individu ou une personne morale transfère des actifs au trust et confère le contrôle de ces biens à un (ou plusieurs) tiers ou à une ou plusieurs institutions — le(s) trustee(s) — pour le compte du ou des bénéficiaire(s)“ (merci Wikipédia), puisque le roman plonge son lecteur dans le monde de la finance du Wall Street des années 1920, relatant cet apogée du capitalisme spéculatif jusqu’à un premier effondrement de la bourse en 1929.
L’ingéniosité du roman se poursuit dans sa présentation formelle: dans „Trust“, un peu comme chez José Luis Borges ou chez les poststructuralistes derridiens, il semble ne pas y avoir un dehors au texte, de sorte que la réalité extérieure aux récits que le roman nous présente – un roman, un fragment d’autobiographie, un deuxième roman autobiographique et des fragments d’un journal intime –, il incombe au lecteur de la reconstruire en recoupant les différentes versions qui lui sont présentées tout en décidant à quel narrateur ou narratrice accorder le plus de confiance.
Car si le romancier Kazuo Ishiguro a dit, un jour, lors d’une conférence donnée à la BNF, que nous sommes tous des narrateurs indignes de confiance quand il s’agit de raconter nos vies, puisque nous avons tendance à embellir certains aspects et à en escamoter d’autres, il y a, parmi les quatre voix que Diaz nous donne à lire et à entendre, certaines qui s’avéreront plus dignes de confiance que d’autres.
Pour nous dépêtrer de la dimension jusqu’à présent volontairement abstraite de cette critique – car il est important, pour ce puzzle littéraire, de ne pas trop en dévoiler, de l’intrigue du roman –, il faudra néanmoins entrer quelque peu dans le détail: lors de sa première partie, Hernan Diaz adopte la voix et le style de l’écrivain (fictionnel) Harold Vanner, dont le roman „Bonds“ (qui mime intelligemment la polysémie du titre du roman, le terme „bonds“ s’appliquant là encore à la fois au monde financier et à l’intimité d’un couple) est devenu un livre à succès lu par le tout New York de l’époque.
Ce roman relate l’histoire du couple improbable constitué par le financier Benjamin Rask, un homme solitaire qui fuit les rassemblements sociaux et qui deviendra, dans les années 20, à la suite d’opérations financières à succès et potentiellement crapuleuses, à la fois l’homme le plus admiré, le plus conspué et le plus scandaleusement riche de tout Manhattan, et de Helen Brevoort, issue d’une famille que trois générations de romanciers et d’hommes politiques ratés ont réduit à un „state of dignified precariousness“, et dont les penchants plus artistiques et caritatifs semblent incompatibles avec ce mari passionné par l’argent et dont la mort prématurée et dramatique signera la fin de cette biographique fictionnalisée.
Enchâssements en série
On comprendra ensuite, en lisant d’abord l’autobiographie incomplète, elliptique, interrompue sans cesse par des notes et des brouillons, d’Andrew Bevel, l’avatar de Benjamin Rask, puis le récit „A Memoir, Remembered“, d’Ida Partenza, que le roman de Harold Vanner fictionnalisait le destin du financier Bevel. Ce dernier fera appel à la jeune Ida Partenza pour l’aider à écrire une sorte de contre-biographie censée restaurer les faits, Bevel insistant surtout sur le fait qu’il lui importe, plus que de corriger l’image que donne de lui le roman à succès de Vanner, de réparer la réputation de sa femme Mildred, dont le vrai destin semble avoir différé pour beaucoup de celui de sa contrepartie fictionnelle.
Or, une fois qu’on en vient, après les récits des deux hommes, au récit d’Ida Partenza, qui relate avec la distance de l’autrice expérimentée qu’elle est devenue, son destin de jeune femme au service du distant et égocentrique Bevel, l’on constate que cet homme d’affaire semble lui aussi, plutôt que de vouloir remettre les pendules à l’heure et de faire brosser un portrait authentique de son épouse qu’il prétend avoir tant chérie, vouloir déformer la personnalité de sa femme. Ainsi, il se met à exiger qu’Ida efface certains traits de la personnalité de Mildred, toujours, comme il le dit, pour le bien du „common reader“, qui préférerait sans doute lire, dit-il, que son épouse ait écouté de la musique classique plutôt que de réaliser que cette femme, qui invitait et supportait des musiciens contemporains dans leur prestigieuse demeure, avait un exigent goût d’avant-garde auquel Bevel ne comprenait rien.
Mildred Bevel, la femme au centre de ce roman, devient ainsi une femme-palimpseste, dont l’identité est en permanence recouverte, voire souillée par les écrits manipulateurs des hommes … et Ida Partenza finit, en 1985, alors que la maison de Bevel est transformée en musée, par raconter comment elle a participé malgré elle, en tant que jeune femme inexpérimentée dans un monde dominé par les mâles, à ce processus d’effacement, de reconstruction fantasmée et réductrice d’une femme forte, admettant avec lucidité que cet exercice de falsification fut pour elle, assez tristement, son acte de naissance en tant qu’écrivaine.
L’écriture de Diaz s’adapte de façon intelligente à ce changement de voix et de perspectives, l’auteur new-yorkais d’origine argentine devenant une sorte de caméléon littéraire qui se glisse tour à tour dans la peau de ses différents auteurs-narrateurs, imitant de ce fait quelque peu le procédé d’Ida Partenza qui, pour trouver le ton exigé par son patron Bevel, se met à lire et amalgamer des biographies de mâles importants (ou qui s’autodésignaient comme tels): „I spent the entire day going through (the library’s) catalogue and looking at biographies written by ‚Great American Men’. Benjamin Franklin, Ulysses S. Grant, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge and Henry Ford are some of the names I remember coming up with, riffling through the cards. If Bevel’s own voice, transcribed without any embellishment or modification was not enough, I would make a new one for him out of all those other voices. […] Like Victor Frankenstein’s creature, my Bevel would be made out of limbs from all these different men.“
Passant du style élégant, parfois dramatique, de la biographie fictionnelle, où le narrateur-auteur semble flotter au-dessus de ses personnages, au ton hagiographique un peu ridicule du récit édifiant et pontifiant autour d’un „Great American Man“ pour finir sur les mémoires d’Ida Partenza, qui raconte son père, un Italien anarchiste, et son éducation littéraire dans le monde de la finance dans un style simple mais touchant qui n’est pas sans rappeler celui de Paul Auster, le roman se termine sur les fragments de journal intime des derniers jours de Mildred, où la vérité éclate au grand jour.
Dans cet entrelacs de voix et de récits moins complexe à saisir qu’il n’y paraît, Diaz montre qu’il y a autant de vérités que d’êtres humains, qu’il faut se méfier des mots tout autant que de leurs auteurs, que la fiction est toujours dangereuse quand elle se met au service de l’escamotage, du trucage de la vérité et que même l’empathie et les émotions qu’elle suscite peuvent être le fruit de la manipulation.
Certains souvenirs ou scènes apparaissant dans plusieurs récits, Diaz montre aussi la porosité de nos identités, que nous construisons parfois à coups de souvenirs tronqués, où, consciemment ou non, nous nous approprions des fragments des vies d’autrui pour embellir l’image que nous entretenons de nous-mêmes.
Surtout, il montre comment l’hybris d’un charlatan imbu de lui-même d’un côté et l’envie de construire une narration spectaculaire de l’autre ont recouvert l’identité d’une femme forte dont ne subsistent, en fin, que quelques tristes traces écrites d’un journal intime tenu quelques semaines avant sa mort.
Malgré une fin un peu prévisible, quelques indices trop évidents (l’insistance sur le méta-cadre du roman policier) et une structure parfois un brin conventionnelle à l’intérieur des quatre parties, Diaz confirme ici son statut de prodige des lettres américaines et publie un roman qui a amplement mérité sa présence sur la longlist du Booker.

Info
„Trust“ de Hernan Diaz, 2022 Picador, 406 pages. La traduction allemande (dont le titre, „Treue“, ne permet pas de rendre compte de l’ambivalence du titre original) est d’ores et déjà disponible chez Hanser Berlin dans une traduction de Hannes Meyer.


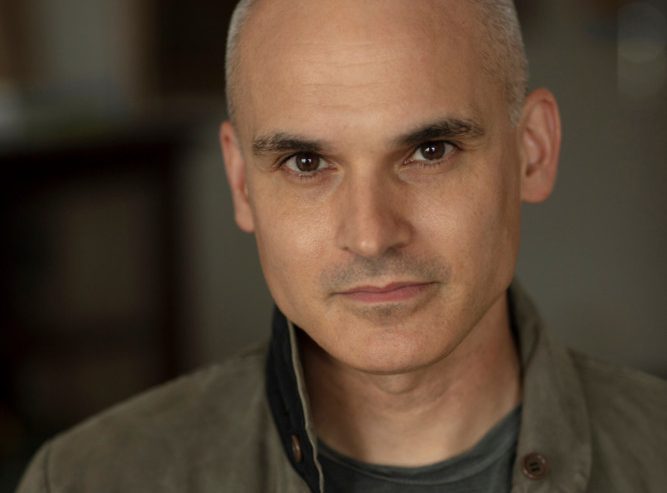







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können