Il y a, pour commencer, ce titre un peu énigmatique, qui annonce, dans son incomplétude même, dans la précision qu’il exige, les tenants et aboutissants de ce récit tissé d’ellipses et de non-dits – la „fille qu’on appelle“, c’est Laura Le Corre, et c’est elle-même qui en donne l’explication dès les premières pages du roman, alors qu’elle vient déposer plainte chez les flics et qu’elle relate sa première rencontre avec Quentin Le Bars, le maire de sa ville natale.
Pour cette rencontre, arrangée par son père Maxime Le Corre, ancien champion de boxe reconverti en chauffeur du maire, qui espère que ce dernier aidera sa fille à trouver un logement dans la ville, Laura Le Corre a choisi des vêtements neutres, „de sorte qu’on n’aurait pas su deviner si [elle était] étudiante ou infirmière ou je ne sais pas, la fille qu’on appelle“ – une call-girl donc, explique-t-elle aux policiers, qui ont du mal à suivre, étonnés que cette fille, qui dès l’âge de seize ans fut abordée à la sortie du lycée par ceux dont le métier consiste à „repérer les jolies filles, les traquer sur les plages ou dans les cours des lycées“ afin de „jeter dessus le filet de mailles serrées“, leur promettant un miroitant avenir de mannequin, étonnés donc que cette jeune femme formule les choses dans leur brutale immédiateté, sans les entourer des précautions verbales habituelles, qu’elle les énonce „comme si son histoire n’était pas vraiment la sienne“, la racontant comme „à la troisième personne“.
Oui, tout y est déjà, dans ce titre, tout le déroulement crapuleux des événements qu’on imagine dès lors que Laura Le Corre met les pieds dans le bureau du maire et que Viel déroulera avec la maîtrise stylistique qu’on lui connaît, tout le dispositif tragique, l’inéluctabilité de son enchaînement, ce que constate d’ailleurs Franck Bellec, tenancier du casino local, bras droit du maire et ancien manager de Max Le Corre, qui sait déjà, quand Quentin Le Bars lui suggère – ordonne donc, à vrai dire, car le maire a ce pouvoir de transformer en ordre toute suggestion qui émane de sa part, dans ce langage codé qu’il utilise pour parler à Bellec – de trouver logement et travail à Laura, qui se doute déjà, Bellec, que le maire „venait de transformer son casino en un gigantesque dépôt de munitions, du genre dont Laura elle-même était le principal baril de foudre, du genre dont Max Le Corre lui-même, pensa Franck, était désormais l’allumette qui ne demandait qu’à être craquée“.
Cela se passe dans une ville au bord de mer, comme (presque) toujours chez Viel, une ville où „on dirait que les siècles d’histoire ont glissé sur les pierres sans jamais les changer“. Et cette histoire qui n’a quasiment pas entamé la pierre – car rien n’entame le monde de ceux qui gouvernent –, c’est évidemment l’histoire des hommes, de leur violence héréditaire, de leur inassouvissable désir aussi, histoire que Viel explore de livre en livre en déplaçant lentement son centre d’intérêt, comme s’il s’agissait de lentement en faire le tour, des différentes manifestations que peut prendre la violence quand elle se lie au désir et au pouvoir.
Un monde immuable
Si la violence, lors de son roman précédent, l’excellent „Article 353 du code pénal,“ était contenue dans l’arnaque orchestrée par un promoteur sans scrupules aux dépens d’une populace induite en erreur, celle qui gouverne son nouveau roman est d’une autre nature, qui concerne une fois encore les relations de pouvoir immuables, mais qui se concentre sur une histoire de consentement, ou plutôt sur l’absence de celui-ci, le maire Le Bars prenant, dès sa première apparition, le lecteur n’étant pas dupe – mais ne pas être dupe n’a jamais évité au pire d’avoir lieu, c’est une des leçons qu’on pourrait tirer de ce roman – les traits d’un Weinstein de province, province dont il essaiera pourtant de s’extirper, car ce Le Bars a des ambitions: s’il a tout pour devenir ministre, c’est qu’il ne s’est jamais empêtré d’une „humilité qu’il n’avait jamais eue à l’excès – à tout le moins [il] n’en avait jamais fait une valeur cardinale, plus propre à voir dans sa réussite l’incarnation même de sa ténacité, celle-là sous laquelle sourdaient des mots comme ‚courage‘ ou ‚mérite‘ ou ‚travail‘ qu’il introduisait à l’envi dans mille discours prononcés partout ces six dernières années, sur les chantiers inaugurés ou les plateaux de télévision, sans qu’on puisse mesurer ce qui dedans relevait de la foi militante ou bien de l’autoportrait (…)“.
De livre en livre, Tanguy Viel continue son exploration de deux sujets, le crime et la lutte des classes, qui sont irrémédiablement liés: d’un côté donc, il y a l’immuabilité du monde des riches, un monde tout de pierre constitué, où on a substitué toutes sortes de rituels à des relations plus profondes comme l’amitié, la loyauté ou l’amour, et de l’autre, il y a ces gens qui espèrent un jour pouvoir faire partie de ce monde mais qui ont toujours déjà perdu la partie avant même de l’avoir entamée, car s’ils sont obligés de négocier avec eux, de pénétrer leur univers inaltérable dont les codes sont comme autant de remparts infranchissables, ils oublient ou feignent d’oublier qu’il y a dès le départ un déséquilibre constitutionnel, comme si on jouait une partie de fléchettes et que les vôtres, de fléchettes, avaient une pointe émoussée.
Et là où le monde de la boxe – qui sera, pour Max Le Corre, une sorte de tremplin qui le hissera tout en haut du monde de la nuit de cette ville de province, les huiles de la ville le portant alors aux nues, le boxeur triomphant de ce succès inespéré „sans qu’il sente à quel point ils préféraient tous leur place à la sienne“, sans qu’il réalise à quel point son statut y est temporaire, qu’il n’est, dans cet univers, qu’un corps étranger dont on ne tardera pas à se débarrasser – est un monde codifié selon des règles bien précises, avec un arbitre qui disqualifie celui qui use de coups bas, le monde du pouvoir, au-delà de ces ententes tacites entre ceux qui s’y meuvent, n’est que cela – un enchaînement de coups bas à peine déguisés.
Des flammes dans les yeux
Une fois les pions posés – une fois que Viel a décrit, avec le soin qu’on lui connaît, les personnages, leurs intérêts et les rapports qu’ils entretiennent –, il suffit, semble-t-il, de suivre la pente, de laisser les relations entre les personnages évoluer ou se dégrader selon une nécessité déterminée par la situation de départ, le tragique étant, chez Viel, une équation dans quoi se mêlent l’inclinaison naturelle des psychés et les inégalités sociales – ce qu’il traduit par cet „et“ anaphorique qui n’a de cesse d’apparaître en début de phrase et qui lui permet d’accentuer l’inéluctable, l’auteur-narrateur se contentant dès lors d’évoquer et de commenter ce glissement vers le tragique qui devient inévitable dès lors que deux mondes – celui des gouverneurs et celui des gouvernés – sortent de leurs lits comme sortirait de son lit une rivière, dès lors que ces mondes s’enchevêtrent.
C’est pour cela qu’il sera beaucoup question, comme cela est, là encore, une habitude chez Viel, de dieux et du diable, tout se passant comme si le néolibéralisme et ses lois avaient remplacé la Providence. Ainsi, à propos du maire, quand Laura croit lire dans son air inquiet qu’il „portait quelque chose de la bienveillance ou bien de l’inquiétude du monde“, le narrateur corrige: „il n’y avait rien de tout cela, seulement le fait que même le diable n’a pas toujours un costume rouge ni des flammes dans les yeux.“
C’est pour traduire de tels doutes, de telles nuances relatives au contraste entre expression extérieure et vie intérieure des personnages, que Viel multiplie les enchâssements de focalisation: plutôt que de lire, comme le fait le narrateur omniscient, la vie intérieure des personnages, il fait s’imbriquer différentes hypothèses – Laura s’imaginant ce que le maire peut avoir ressenti ou pensé à tel ou tel moment –, peignant tel ou tel personnage à travers l’évocation d’un simple geste, d’un accoutrement, d’une couleur, effeuillant parfois toute une série de métaphores possibles dans quoi il puise pour choisir celle qui exprime au mieux l’état du personnage décrit.
Ce style, ce langage, cet art de la litote, de l’understatement, Viel le met alors au service des démunis, des réprimés. Son langage, dans le cisèlement de ses périodes, dans sa précision, dans l’empathie de son analyse – il ne brusque pas ses personnages mais les cerne avec patience –, montre, en le contrastant avec celui, tout entièrement tourné vers la duplicité, la tromperie, tout entièrement vidé de ses signifiés, du pouvoir, que la lutte des classes imprègne jusqu’à notre façon de penser, de parler et d’écrire. Ecrire comme le fait Viel, c’est toute la révolte qui nous reste.
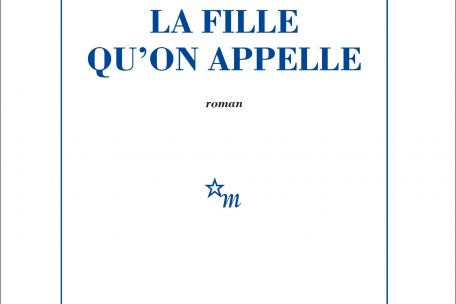
Info
„La fille qu’on appelle“ de Tanguy Viel, 2021 Les Editions de Minuit, 176 pages, 16 euros.
Le roman se trouve parmi la première sélection du prix Goncourt.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können