J’avais pensé d’abord à faire quelque chose comme un détournement ironique de Springsteen, moi qui ne suis pas un grand inconditionnel du „Boss“, qui trouve par ailleurs un peu ringard des artistes qui portent sans honte de tels sobriquets mégalomanes et qui préfère, en musique, ces groupes qui travaillent dans l’ombre, sans musicien qui se profilerait.
„Death to My Hometown“ est, pour moi, avant tout une chanson des Suédois de Logh, dont la musique est si sombre qu’on tomberait, en l’écoutant, presque tout de suite dans une sorte d’abysse de mélancolie – plutôt qu’aux États-Unis de Bruce, on pense aux grands espaces vides du nord de l’Europe.
C’est là l’ironie du sort: que celui qui chante les démunis soit lui-même tout sauf démuni, que celui qui parle des marginaux soit tout sauf un marginal. Alors, pour inverser la donne, je me persuadais qu’il fallait remettre les pendules à l’heure, que j’allais, par une pirouette rhétorique, rendre hommage à la marge en passant par la bande.
Mais c’est à une autre disparition que je pensai soudain en lisant la note d’intention de Denis Scuto et les vers de „Death to My Hometown“. Car quand je pense au bassin minier, moi qui suis né à Mondercange et qui pourrait donc relater une enfance postindustrielle des années 80, c’est toujours d’abord une image de mon grand-père paternel qui surgit.
Et la première image qui me vient de lui, se superposant à tant d’autres, dont celles issues de films d’Andy Bausch dans lesquels il adorait jouer au figurant, est celle de son ultime séjour eschois au CHEM, après qu’il eut versé quelques larmes – ce serait la seule fois que je l’aurais vu pleurer, mon grand-père, ému qu’il était que ma sœur et moi soyons venus le voir.
Alors que je refermai la porte de sa triste chambre d’hôpital et que, l’apercevant à travers l’entrebâillement de la porte, lui le dandy à la moustache soignée qui ressemblait tant à Dalí qu’un jour où nos parents nous avaient emmenés au théâtre-musée Dalí à Figueres, ma sœur et moi en étions sortis convaincus qu’on avait un papy célèbre, qui avait mené une double vie entre ouvrier démuni et artiste déjanté, le voyant tant amaigri, j’eus une pensée que je regrettai tout de suite, une pensée terrible qui me croisa l’esprit, une pensée d’autant plus terrible qu’elle s’avérerait juste. Et la pensée fut: ça sera la dernière fois que tu le verras, ton grand-père.
La plus grande partie de sa vie, Raymond l’avait passée dans une petite maison d’ouvrier à Schifflange – une maison coincée dans une rangée de bâtisses étroites, rachetée par un promoteur pour y planter un de ces immeubles modernes qui engloutissent un peu partout dans le monde des histoires de vies. Trêve de palimpseste: les promoteurs contemporains sont des dévoreurs de souvenirs.
Mais ce ne fut que plus tard qu’il s’installa dans le bassin minier, où il fut un ouvrier parmi tant d’autres à exploiter le gisement de minerai de fer à la Schmelz. D’abord, sa prime enfance, il la passa à l’étranger, non loin d’Arlon. Son père y travailla comme électricien pour le compte d’un riche châtelain qui tomba en dépression (c’est fou tout ce dans quoi la langue française permet de tomber) après le décès de son épouse, le quitta, son château, retournant à Bruxelles et obligeant mon arrière-grand-père à se trouver un nouveau travail, ce qu’il fit donc au Luxembourg et, pour être plus précis, à Mondercange.
Je tiens de mon père – donc de seconde main, mon grand-père, issu de cette génération de mutiques que produisent les guerres, ayant toujours été fort discret sur sa vie – deux anecdotes châtelaines. Un jour, un jeu d’enfant aurait mal tourné et il aurait fini par mettre le feu à une grange. Une autre, il aurait marché sur le toit d’une serre, qui se serait effondrée sous son poids, le jeune gamin survivant à une chute de plusieurs mètres, devant peut-être sa vie à la terre meuble dans laquelle germaient des grains d’haricots ou poussaient des pommes de terre.
C’est de lui que je tiens ce mélange entre enjouement, espièglerie et mélancolie, comme si mon grand-père avait déposé en moi, par métempsycose anthume, un héritage tragique à entretenir, moi qui suis un peu poète perdu à mes heures maudites, quand je ne suis pas poète maudit à mes heures perdues.
Car le tragique ne manqua pas de s’immiscer dans sa vie, l’enlevant à nouveau du bassin minier à l’âge de dix-sept ans, alors qu’il se pointait chez le directeur d’une école d’artisans dans l’espoir d’y être recruté.
Le directeur l’accueillit avec un salut hitlérien vigoureux, ce à quoi Raymond opposa un silence buté, un mutisme vaillant, un peu comme la famille dans „Le silence de la mer“ de Vercors – une référence avec quoi il n’aurait su que faire, lui qui n’avait pas connu, qui n’avait pas pu connaître une éducation plus poussée puisque, après ce refus, le directeur lui demanda de sortir puis de rentrer à nouveau pour bien faire les choses.
Mon grand-père obtempéra à moitié, c’est-à-dire que certes, il accepta de sortir et de rentrer dans le bureau, mais qu’au Heil Hitler! répété avec tout autant de vigueur, il réagit à nouveau avec un vide gestuel qui virait à la provocation. Le directeur, en bon dénonciateur zélé, rapporta la chose à l’envahisseur, qui enrôla de force mon grand-père pour l’envoyer en Russie, où il finit par déserter, manquant de se faire tuer par les Russes parce qu’il portait encore l’uniforme allemand, dont il se débarrasserait aussitôt qu’il aura trouvé des vêtements de substitution (eh oui, on ne parcourt pas la Russie en caleçon).
Ce fut grâce à un compagnon d’infortune, un certain Meyer, qui parlait le russe, que les soldats comprirent qu’ils avaient affaire à des déserteurs qui abhorraient l’ennemi allemand au moins autant qu’eux-mêmes. Ce Meyer, mon père et moi, nous avions cherché à le rencontrer pendant mes années d’études à Paris. Mon grand-père avait gardé le contact, il détenait son adresse et, quand nous réussîmes à trouver sa petite maisonnette non loin du parc des Buttes-Chaumont, nous étions un peu excités de rencontrer celui qui avait sauvé la vie de mon grand-père.
Hélas, nous dûmes vite déchanter – il n’y eut personne pour nous ouvrir la porte et nous servir, avec le café, les anecdotes que nous étions venus recueillir. Peu après, on apprit que le sauveur de mon grand-père était décédé – quand nous sonnions à sa porte, on venait de l’emmener à l’hôpital. Encore une rencontre ratée de peu, encore une histoire de moment inopportun, de malchance. D’anti-kaïros.
Car s’il n’y avait pas eu la guerre, s’il n’y avait pas eu sa désertion, sa longue traversée de la Russie et la maladie qui s’ensuivit, qui sait quelle vie mon grand-père aurait menée? Quand je vois sa fascination pour le cinéma et les forains, quand je pense au soin qu’il portait à son apparence physique, je me dis qu’il avait été promis à un autre destin que celui d’ouvrier, que c’est là une vie qu’il mena bon gré mal gré, de façon stoïque, sans tergiverser ni se plaindre, une vie toujours dictée par ce qu’autrui lui infligea. C’est ça le sort des démunis: de ne jamais avoir le contrôle sur sa vie.
Souvent, je pense à cette affinité qu’a le romancier Kazuo Ishiguro pour les mondes possibles, lui qui, âgé de cinq ans, quitta le Japon parce que son père océanographe avait décroché un poste en Angleterre. Ses premiers romans évoquent un Japon fantasmé, et les critiques le louèrent pour la reconstitution fidèle d’un pays qu’il a presqu’intégralement imaginé.
Et je me dis qu’il faut peut-être ça, au romancier: l’impression qu’il aurait pu mener d’autres existences, et une écoute de ces autres vies fantomatiques, le courage de les raconter, de les vivre par procuration. Il lui faut une sorte de déchirement ontologique qui rende visible les éclats de ces possibles non avenus, inscrits en jachère en nous, tatoués sur nos organes.
Quand j’avais onze ans, mes parents divorcèrent et déménagèrent tous deux en ville. Ce fut, pour moi aussi, une rupture, l’abandon d’une vie possible pour embrasser une nouvelle existence, comme si on m’avait acheté des chaussures trop grandes dans lesquelles il me faudrait réapprendre à marcher. Peut-être, pensais-je alors, que dans ma famille, nous avons tous la démarche un peu claudicante de ceux qui marchent dans les pas d’une vie qui n’aurait pas dû être la leur.
Sur l’auteur
Né en 1985 à Mondercange, Jeff Schinker est écrivain et journaliste. Il organise des soirées de lecture qui sont à l’image de ses livres, qui sont à l’image de sa vie, donc un peu déjantées. Ses deux derniers romans, „Sabotage“, un objet littéraire non identifié écrit en quatre langues et „Ma vie sous les tentes“, une autofiction dystopique, figuraient sur la shortlist du prix Servais. Depuis 2017, il dirige les pages culturelles du Tageblatt.

„This Hard Minett Land“ – Das Buch
Bald ist es so weit: Seit März haben das Tageblatt, das Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) und capybarabooks die LeserInnen jeden Freitag zu einer besonderen Entdeckungsreise durch Luxemburgs Süden eingeladen: Rund vierzig SchriftstellerInnen und HistorikerInnen ließen sich von Bruce Springsteens Songs inspirieren und schrieben Texte über das luxemburgisch-lothringische Eisenerzbecken, „de Minett“, sowie über diejenigen, die dort leben und gelebt haben. Begleitet wurden und werden die Texte in deutscher, englischer, französischer und luxemburgischer Sprache von Illustrationen des Luxemburger Künstlers Dan Altmann. Im November erscheinen sie versammelt in Buchform bei capybarabooks. Bestellen Sie jetzt! „This Hard Minett Land“ wird Ihnen dann sofort bei Erscheinen versandkostenfrei zugeschickt.
Susanne Jaspers & Denis Scuto (Hg./dir.)
This Hard Minett Land
Mit Illustrationen von Dan Altmann
ca. 256 Seiten
20 x 12 cm, Klappenbroschur
25,00 Euro
Erscheint im November 2022







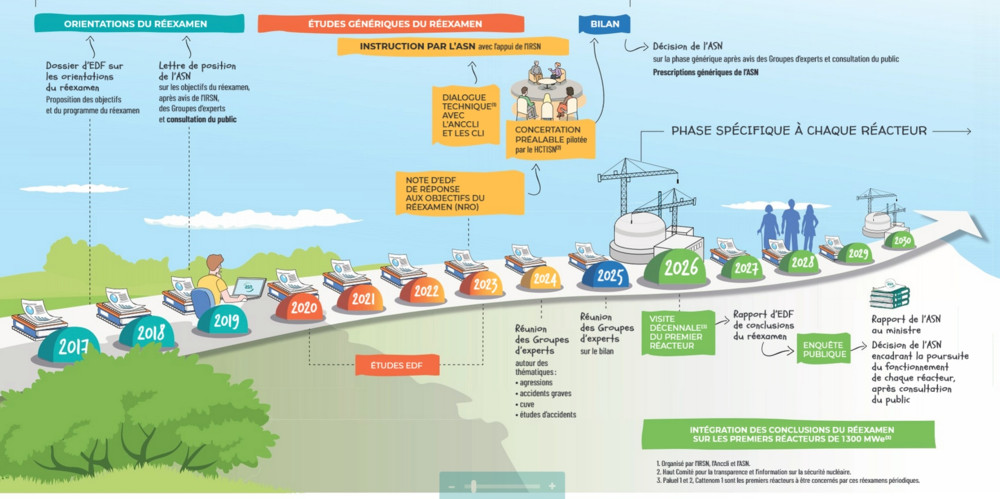


Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können