L’enfant terrible de la littérature française joue même là-dessus, puisque son alter ego fictionnel, Octave Parango, a souvent singé les loufoqueries auxquelles s’adonnait son créateur dans la vraie vie, quand celui-ci ne délaissait pas, le temps de deux livres à l’autofictionnalité (encore) plus assumée, l’abri de la fiction pour s’exposer nu au monde, comme quand il racontait sa garde à vue après qu’on l’eut arrêté à la suite de la consommation de rails de coke en présence de son ami l’écrivain Simon Liberati.
Et s’il publie ce livre – chez Albin Michel et non, comme à son habitude, aux Éditions Grasset –, c’est parce qu’un jour, l’auteur et sa fille ont découvert leur maison et voiture couverts d’insultes roses, quelqu’un y ayant tagué de surcroît la phrase „Ici vit un violeur“. Et parce qu’il pensait, à juste titre, qu’une confession en forme d’essai un peu provoc, dont presque la moitié fut d’ailleurs déjà publiée ailleurs, lui assurera une place en haut des ventes de livres (il ne s’est pas trompé), lui permettant de se remplir les poches tout en réussissant à se faire haïr encore plus par ses ennemis désignés – une certaine gauche et „les féministes“.
Car si on a saccagé sa maison, estime Beigbeder, ce serait parce qu’il s’est opposé à la pénalisation des clients de prostitués et, qu’en général, il aime la littérature qui provoque, qui fait mal, et qu’il s’oppose au wokisme, où l’on cherche sans cesse à émousser les façons dont l’humanité se représente dans ses productions culturelles, un peu comme si le fait de ne plus parler de ce qui fait mal dans les livres équivalait à l’effacer aussi dans le monde, sorte de vœu pieu qui découle de l’idée que, si les mots peuvent avoir un potentiel performatif, ne pas les utiliser pouvait empêcher que certaines choses se reproduisent. Quand dire, c’est faire, disait Austin; quand taire, c’est défaire, préconisent les wokistes d’aujourd’hui, contre lesquels Beigbeder s’insurge donc dans des confessions tout aussi nombrilistes que celles qui avaient le mérite d’être les premières, de Rousseau.
Et on ne reproche pas tant à Beigbeder de prendre le parti des réacs (même si l’on constate que, parmi les contemporains qu’il cite sans les fustiger, figurent Yann Moix et Sylvain Tesson, dont un récent essai à mis en lumière les liens avec l’extrême-droite) – mais on lui en veut bien plutôt d’avoir publié un livre inepte, où l’esprit de la provocation s’est lui-même émoussé et où l’auteur se perd en lapalissades et banalités, qu’il essaie en vain de faire passer pour des mots d’esprit à même de mettre en branle notre pensée critique.
Récit d’un homme qui cherche le sevrage après un chapitre dédié à un éloge paradoxal de la cocaïne, qui lui inspire les meilleures pages du livre et dont on sent qu’il maîtrise le sujet du bout de la narine, ses confessions relatent d’abord son séjour dans la cellule d’un couvent, puis son expérience dans une caserne militaire, où il s’enrégimente, les militaires et les religieux (mâles) lui inspirant respect et vénération là où Annie Ernaux, sur laquelle il s’acharne (car se défouler sur Annie Ernaux est presque devenu un rite de passage pour les écrivains de droite) quand il ne fantasme pas sur sa baisabilité, ne suscite qu’un mépris quasiment métonymique, puisqu’il voit en elle tout le mal que des féministes comme elle font subir au monde (le monde, dans sa vision du monde, c’est le monde des hétérosexuels mâles).
On y apprend donc, avec l’auteur, que „la drôle de guerre ne fut pas une partie de rigolade“, que „le silence français sur la colonisation est une absurdité“ et autres truismes dont on s’étonne qu’un homme de 57 ans ait été capable de les écrire, qu’on aurait bien plutôt attribué à un écolier qui découvre que le monde est mal fait. Cependant, ces passages sont bien moins offensifs que ce qu’il nous balance quand il commence à parler du désir hétérosexuel, pages lors desquelles, dans une généralisation abusive (l’expression prend ici un sens double), on lit que c’est „un miracle quotidien que davantage de femmes ne soient pas victimes d’agressions sexuelles“, Beigbeder faisant le portrait du mâle en prédateur infatigable, dont seule une femme nympho pourrait entrevoir un fragment de la puissance de sa libido, insinuant que tout homme qui ne voudrait pas, comme lui, baiser, voire violer toutes les femmes qui passent sur son chemin serait un fieffé menteur. Pour lui, c’est „la vérité de l’homme“, pour le lecteur, c’est, tout simplement, un peu consternant.
Avec ses „Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé“, Beigbeder publie moins un livre qu’une sorte de (très) long post un peu provoc tel qu’on en voit polluer à longueur de journée les réseaux sociaux, ce dans l’espoir de jeter un pavé dans la mare du politiquement correct, pour dire à quel point est devenu merdique ce monde dans lequel dire certaines choses est devenu problématique et où certains te lynchent quand tu oublies de genrer.
Malheureusement, plutôt que de l’ébranler, le monde, son pavé ne fait qu’un petit plouc agaçant, ridant à peine la mare stagnante du PC avant de couler au fond. Ne restera bientôt en mémoire qu’une couverture très laide où l’auteur, posant en philosophe mâle dont la tête émerge de l’eau, caresse sa barbe en un malicieux V de la victoire, comme si, ayant déjà calculé les chiffres de vente de ce pauvre petit livre, il savait que, peu importe ce qu’on en pensera, il ne pourra que gagner.
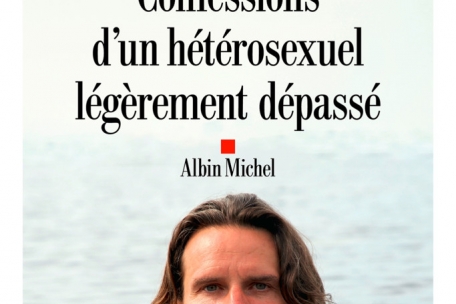










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können