TENDANCES DU CONTEMPORAIN (8): Histoire(s) d’une tumultueuse émancipation
De Jeff Schinker
L’Algérie est, depuis toujours, un des sujets phares de la littérature postcoloniale francophone, comme le montre l’œuvre d’une romancière comme Assia Djebar. Alors que l’Histoire semble être en passe d’accompagner de plus en plus la littérature afin d’assurer un travail de la mémoire qui, à l’ère du périssable sur Internet, paraît plus nécessaire que jamais, deux auteures racontent la guerre et l’indépendance algérienne en la rattachant à l’actualité et en choisissant, pour l’une, la saga familiale et, pour l’autre, l’histoire d’une aventure intellectuelle.
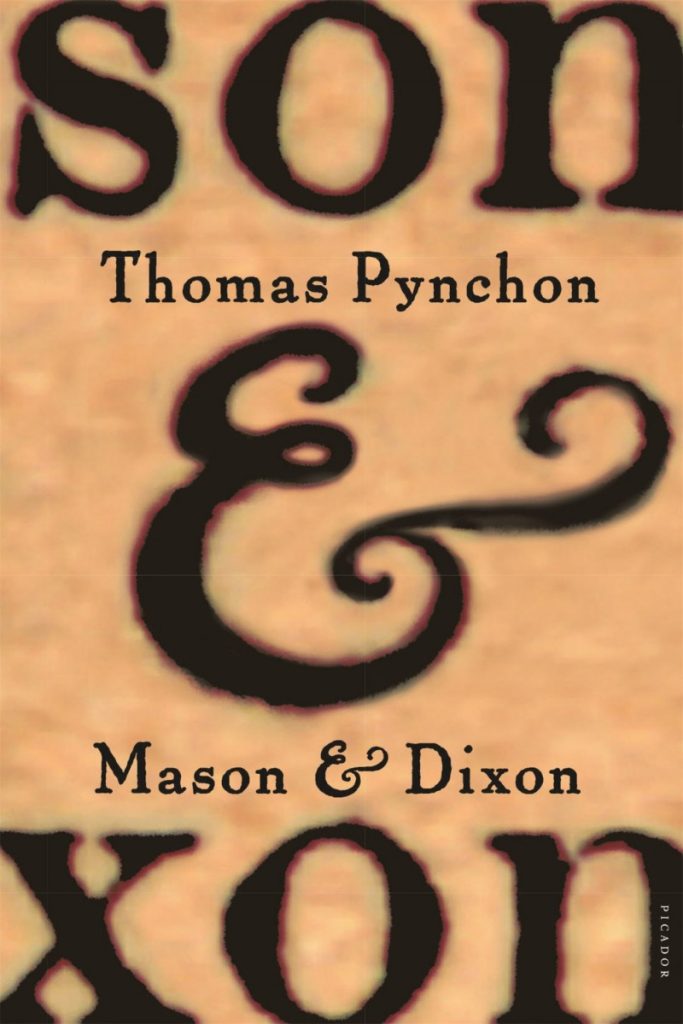 Dans „Mason & Dixon“, le roman le plus historiographique de Thomas Pynchon, on peut lire les lignes suivantes: „L’Histoire est soudoyée par, ou contrainte de servir des Intérêts qui à tout coup se révèlent indignes. Elle est trop innocente pour qu’on la laisse à portée d’un quelconque homme de Pouvoir, – qui ne peut s’empêcher de la toucher et tout le Crédit de cette dernière s’évanouit dans l’instant (…). Elle a bien plutôt besoin d’être l’objet des soins tendres et dignes des fabulistes et des contrefacteurs, des chansonniers et des originaux de tout calibre, des maîtres du Déguisement qui lui fournissent le Costume, la Toilette, le Port, ainsi qu’un Discours assez leste pour la tenir à l’abri des Désirs ou même la Curiosité des Gouvernements.“
Dans „Mason & Dixon“, le roman le plus historiographique de Thomas Pynchon, on peut lire les lignes suivantes: „L’Histoire est soudoyée par, ou contrainte de servir des Intérêts qui à tout coup se révèlent indignes. Elle est trop innocente pour qu’on la laisse à portée d’un quelconque homme de Pouvoir, – qui ne peut s’empêcher de la toucher et tout le Crédit de cette dernière s’évanouit dans l’instant (…). Elle a bien plutôt besoin d’être l’objet des soins tendres et dignes des fabulistes et des contrefacteurs, des chansonniers et des originaux de tout calibre, des maîtres du Déguisement qui lui fournissent le Costume, la Toilette, le Port, ainsi qu’un Discours assez leste pour la tenir à l’abri des Désirs ou même la Curiosité des Gouvernements.“
„L’art de perdre“ d’Alice Zeniter (Prix Goncourt des lycéens) et „Nos richesses“ de Kaouther Adimi (Prix Renaudot des lycéens) évoquent des destins laissés en marge de l’Histoire officielle car évoquant trop de tabous, trop de culpabilité du côté du pouvoir dominant: là où Alice Zeniter raconte l’épopée d’une famille de harkis tiraillée entre la France et l’Algérie, régie par un sentiment de non-appartenance où se glissera la honte d’avoir trahi ou le regret d’avoir, peut-être, fait de mauvais choix, Kaouther Adimi narre celle, en mode mineur, de la librairie-bibliothèque-édition „Les vraies richesses“, fondée par Edmond Charlot et dans les péripéties de laquelle furent impliqués des écrivains et intellectuels comme Albert Camus, Jean Giono ou André Gide.
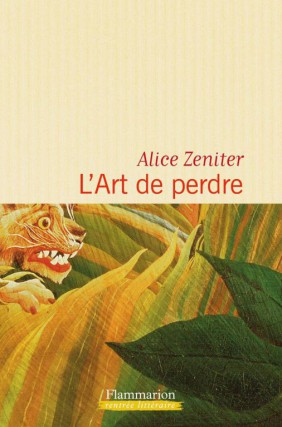 Et pour que ces histoires ne soient pas accaparées par le pouvoir et les vainqueurs, pour que ceux-ci ne puissent imposer leur version, ces romancières leur „fournissent le Costume, la Toilette, le Port“ du littéraire, ornant leurs recherches historiques d’entités fictionnelles et de structurations narratives.
Et pour que ces histoires ne soient pas accaparées par le pouvoir et les vainqueurs, pour que ceux-ci ne puissent imposer leur version, ces romancières leur „fournissent le Costume, la Toilette, le Port“ du littéraire, ornant leurs recherches historiques d’entités fictionnelles et de structurations narratives.
„L’Art de perdre“ d’Alice Zeniter commence par une scène fondatrice, un mythe familial fait pour se perpétuer, une découverte originelle chargée en promesses: Ali, le grand-père de Naïma, trouve, alors qu’il se baigne dans un fleuve, un pressoir qui marquera le début de la richesse familiale. La période de bonheur sera cependant d’assez courte durée, puisque Ali, après s’être engagé du côté français pendant la Deuxième Guerre mondiale, verra comment s’enveniment lentement les choses après le massacre de Sétif. Sceptique vis-à-vis de la violence des indépendantistes, il sera, en 1962, transféré en France où sa famille sera accueillie, avec nombre d’autres harkis, dans un camp à Rivesaltes, où la famille vivra dans des conditions de vie précaires. Bien des années plus tard, sa petite-fille Naïma, qui travaille dans une galerie d’art contemporain, sera forcée, à cause d’une exposition d’un artiste algérien mourant, de se confronter au passé familial qu’elle a si longtemps refusé d’affronter.
 Si le roman de Zeniter est structuré en trois parties correspondant chacune à un personnage et une génération (Ali, son fils Hamid et Naïma) et suivant donc l’ordre chronologique, celui d’Adimi est lui aussi divisé en trois narrations, qui pourtant s’alternent, se chevauchent et s’entremêlent: les carnets de Charlot narrent la genèse et les péripéties de sa librairie, sur quoi vient se poser l’histoire contemporaine de Ryad, chargé de venir faire le rangement dans l’ancienne librairie et de tout jeter, les deux récits étant complémentés par des passages historiques évoquant, par un „nous“ collectif non identifié, l’histoire de l’indépendance algérienne.
Si le roman de Zeniter est structuré en trois parties correspondant chacune à un personnage et une génération (Ali, son fils Hamid et Naïma) et suivant donc l’ordre chronologique, celui d’Adimi est lui aussi divisé en trois narrations, qui pourtant s’alternent, se chevauchent et s’entremêlent: les carnets de Charlot narrent la genèse et les péripéties de sa librairie, sur quoi vient se poser l’histoire contemporaine de Ryad, chargé de venir faire le rangement dans l’ancienne librairie et de tout jeter, les deux récits étant complémentés par des passages historiques évoquant, par un „nous“ collectif non identifié, l’histoire de l’indépendance algérienne.
Les racines du brouillard
L’histoire que raconte Zeniter – celle de la lente émancipation de l’Algérie, celle des luttes et des victimes que le combat pour l’indépendance fit, celle aussi de ce qu’on appelle l’intégration, parce qu’on se dit que mettre un seul mot sur un processus complexe, sans cesse renégocié, fait de bigarrures et de frustration, suffit à rassurer ceux qui n’en sont pas concernés – est d’une complexité atténuée par la façon dont l’auteure se focalise, avec brio et dans une langue souvent poétique, juste, poignante, sur le destin métonymique d’une famille algérienne.
L’un des sujets communs aux deux romans est le traitement du langage et de la littérature. Loin pourtant de cette littérature qui ne fait que parler un peu narcissiquement d’elle-même, le rapport à la langue, aux livres et à l’écriture est ici profondément ancré dans des réalités sociopolitiques. Chez Zeniter, c’est à travers l’apprentissage du français que se constituent des fissures générationnelles, puisque Hamid sera le premier membre de la famille à savoir lire et écrire le français: „Ce qui l’attire (…), c’est en réalité l’écriture, l’alphabet. Hamid n’a jamais divisé sa langue maternelle en mots, et encore moins en signes – c’est une substance étale et insécable, faite des murmures mêlés de plusieurs générations.“
 Cette intellectualisation s’accompagnera néanmoins d’un lent rejet de la famille et de son appartenance algérienne, Hamid ne gardant en tête de son pays d’origine que des scènes cauchemardesques et la vie dans les camps. La possibilité d’intégration semble se fonder sur des mécanismes de rejet des parents qui, à leur véritable arrivée en France dans un HLM, se font arnaquer: „On peut tout leur vendre: ils ne savent rien. Voire mieux: ils ont peur de ne pas savoir. (…) Ils ont peur de se mettre en marge de la société en aménageant mal leurs appartements.“ Zeniter évite les clichés et binarismes en montrant comment la révolte d’Hamid est cependant due à l’éducation (gauchiste) par ces mêmes Français dont la politique est à l’origine du déracinement que connaît la famille.
Cette intellectualisation s’accompagnera néanmoins d’un lent rejet de la famille et de son appartenance algérienne, Hamid ne gardant en tête de son pays d’origine que des scènes cauchemardesques et la vie dans les camps. La possibilité d’intégration semble se fonder sur des mécanismes de rejet des parents qui, à leur véritable arrivée en France dans un HLM, se font arnaquer: „On peut tout leur vendre: ils ne savent rien. Voire mieux: ils ont peur de ne pas savoir. (…) Ils ont peur de se mettre en marge de la société en aménageant mal leurs appartements.“ Zeniter évite les clichés et binarismes en montrant comment la révolte d’Hamid est cependant due à l’éducation (gauchiste) par ces mêmes Français dont la politique est à l’origine du déracinement que connaît la famille.
Chez Adimi, c’est dans les carnets de Charlot que se lisent les rapports de domination: quand Charlot ouvrira une succursale parisienne, on ne cessera de répandre des rumeurs relatives à sa faillite. Gallimard, Grasset et Seuil (chez qui le livre d’Adimi est publié) incarnent la métropole assoiffée, qui tente de récupérer (et récupérera, à force de mettre les moyens et les sous de leur côté) des auteurs publiés et en partie découverts par Charlot. On voit, à travers l’histoire de la librairie, comment, dans cette histoire d’émancipation, le moindre geste devient politique. C’est ce qui fait aussi l’amertume et le tragique de ces gens comme Ali, qui, comme Stevens dans „Les vestiges du jour“ d’Ishiguro, sont pris dans le tourbillon de l’actualité, et se trompent sans avoir eu l’intention de mal agir.
Pris ensemble, les romans d’Adimi et de Zeniter constituent une reconstitution fragmentée de l’histoire récente de l’Algérie, où les traumatismes sont évoqués par la bande, Zeniter choisissant l’angle des tensions générationnelles là où Adimi opte ou bien pour le prisme individuel de Charlot, ou alors pour ce si réussi „nous“ narratif. Ce „nous“ est polymorphe, malléable et peut, selon les passages, désigner toute la population de l’Algérie alors qu’ailleurs, il se limite à évoquer la communauté solidaire qui se forme autour de la librairie, comme quand la ville entière semble ne plus disposer de pots de peinture à vendre au jeune Ryad afin d’empêcher celui-ci de poursuivre son travail. Chez Zeniter, le lien à l’actualité, à travers le personnage de Naïma et sa liste des peurs (la peur de faire des fautes de français, d’être assimilée aux terroristes) et les analyses politiques comparant la situation politique et culturelle de l’intégration à celle des générations précédentes, est plus pertinent que chez Adimi.
 On remarquera, dans les deux romans, des références et des lieux communs, des ponts historiques qui sont plutôt des blessures, des ravages, des ruines: les deux romans sont marqués par les mêmes événements traumatisants, l’engagement, pendant la guerre, aux côtés des Français, la bataille de Monte Cassino, le massacre à Sétif, l’attentat du Milk Bar.
On remarquera, dans les deux romans, des références et des lieux communs, des ponts historiques qui sont plutôt des blessures, des ravages, des ruines: les deux romans sont marqués par les mêmes événements traumatisants, l’engagement, pendant la guerre, aux côtés des Français, la bataille de Monte Cassino, le massacre à Sétif, l’attentat du Milk Bar.
Côté style, il paraît un peu aberrant que ce soit „Nos richesses“ qui ait eu le „Prix du style“ (il faudrait faire un jour l’inventaire de tous les prix littéraires qui existent désormais en France) puisque son écriture limpide, simple, n’est certes pas sans beauté mais qu’elle véhicule, de par son côté elliptique, un certain pathos dont la langue de Zeniter est dénuée. Dans les deux cas, c’est grâce aux „soins tendres“ de ces „fabulistes“ et „contrefacteurs“ que l’histoire algérienne fait preuve de cette esthétique non alignée par quoi le patron de Naïma qualifie les oeuvres de la décolonisation.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können