La série des fragments d’Enrico Lunghi, articulé en 26 séquences narratives laconiques, se présente comme un inventaire éclaté, une mosaïque de micro-scènes qui ne s’organisent pas en récit linéaire mais en suite fragmentaire. Chaque titre – „Le condamné et la femme en noir“, „Le bébé et ses parents“, „Les fossoyeurs et le prêtre“, etc. – fonctionne comme un instantané, une vignette isolée qui s’ajoute aux autres pour dessiner un univers en morceaux.
Une mosaïque de figures
Ce qui frappe, c’est la récurrence de certaines figures: le voyageur, l’adolescente, le bébé, les fossoyeurs. Ces personnages reviennent, associés à d’autres, dans un mouvement de variation et de reprise qui donne au texte un rythme sériel. L’effet est celui d’un théâtre de figures où les protagonistes se croisent, se recomposent et rejouent des scènes multiples, comme des motifs dans une partition musicale. La plupart des fragments reposent sur des confrontations binaires: un personnage face à un autre, parfois un groupe, rarement seul. Cette structure en duos souligne l’importance de la rencontre et de la relation, plus que celle de l’individu isolé. Elle met en valeur les tensions, les oppositions ou les alliances possibles au cœur de l’existence.
Au-delà de la diversité apparente, ces figures ont une valeur allégorique. La femme en noir incarne la mort, les fossoyeurs et le prêtre renvoient au rituel funéraire, le bébé symbolise la naissance, le voyageur l’errance et la quête, l’adolescente l’entre-deux fragile de la transition. Chacun est moins un personnage qu’un archétype, une force existentielle mise en scène.
(…) le voyageur (…) aurait donné le peu qui lui restait pour avoir encore le plaisir, de temps à autre, de philosopher ainsi sans ambages avec un ami. Lui qui aurait aimé vivre en rendant hommage à la vie savait qu’il terminerait la sienne en aidant les autres à mourir
Par ce jeu de fragments, de répétitions et d’associations, Lunghi construit un monde crépusculaire où la vie et la mort, l’origine et la fin, se répondent sans cesse. „Chroniques d’un monde avant“ apparaît ainsi comme une poétique de la fragmentation et de l’allégorie: non pas un récit suivi, mais un théâtre d’ombres où se rejoue la condition humaine dans sa nudité essentielle.
Une uchronie critique
L’ouvrage de Lunghi peut être lu comme une uchronie, c’est-à-dire un récit qui imagine un autre temps, un „non-temps“ (u-chronos) où l’histoire aurait pris un cours différent. Contrairement à l’utopie, qui invente un espace, l’uchronie invente un temps parallèle. Ici, Lunghi ne décrit pas un futur daté ni une catastrophe précise, mais installe une perspective fictive où notre présent est déjà révolu. Ce procédé permet de lire notre monde comme s’il appartenait aux archives d’une civilisation disparue. L’uchronie devient ainsi un instrument de critique: elle nous contraint à regarder notre époque avec le recul que nous avons d’ordinaire sur les sociétés antiques. De plus, le dispositif choisi par l’auteur n’est pas seulement narratif, il est aussi méthodologique. La préface adopte la forme d’un faux appareil savant: fragments „traduits“, „classés“, „complétés“ par des titres ajoutés. Ce mimétisme rappelle le travail des philologues face aux textes anciens.
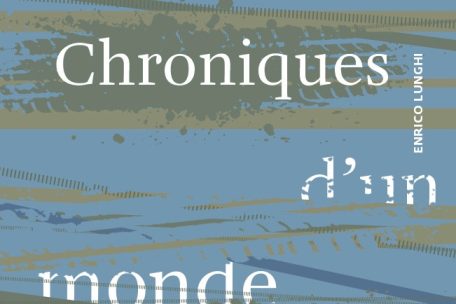
Enrico Lunghi, „Chroniques d’un monde avant. Fragments classés“, Hydre Editions, 2025 Source: Hydre Editions
Le titre, quant à lui – „Chroniques d’un monde avant“ – installe une rupture temporelle. Le lecteur contemporain découvre son propre monde raconté comme s’il appartenait déjà au passé. L’homo sapiens est présenté comme une espèce disparue, observée avec le recul d’un regard venu d’ailleurs, par des „éditeurs“ qui rassemblent des fragments inachevés. Ce décalage bouleverse notre rapport au présent: ce que nous croyons stable ou naturel devient matière à étonnement. Notre civilisation se retrouve relue comme une collection de vestiges dont la signification reste incertaine.
Notons au demeurant que la préface joue un rôle déterminant dans ce dispositif. Elle adopte la forme d’un faux appareil critique et philologique: elle présente un „auteur inconnu“, des textes „inachevés“, „intraduisibles“ ou „invérifiables“. Elle insiste sur le fait que les fragments ont dû être „traduits“ et „classés“, avec l’ajout de titres et d’italiques. En d’autres termes, elle mime l’attitude des éditeurs savants confrontés à des manuscrits antiques lacunaires. Ce choix a plusieurs conséquences. D’abord, il brouille la fonction d’auteur: Enrico Lunghi s’efface derrière ce dispositif fictif, laissant place à un „éditeur“ imaginaire. Ensuite, il installe une double médiation: le lecteur n’accède jamais directement au texte, mais toujours par l’intermédiaire de fragments déjà sélectionnés, interprétés et réorganisés. Enfin, il confère au recueil une aura d’authenticité, comme si nous avions affaire à une véritable archive retrouvée.
Présent et vestiges
Si Lunghi présente son recueil comme une archéologie fictive, c’est bien de nous-mêmes qu’il s’agit. Le dispositif repose sur un paradoxe: nous lisons notre propre présent comme si nous étions déjà disparus. Cette inversion du regard oblige à envisager notre monde non plus dans sa logique immédiate, mais comme une strate d’histoire, comme une ruine déjà classée dans les archives d’un futur incertain. Il ne s’agit pas seulement d’un jeu littéraire, mais d’une véritable épreuve critique. Car voir notre monde comme déjà disparu, c’est prendre conscience de sa contingence: rien ne garantit sa survie, ni même son intelligibilité future. L’archéologie imaginaire proposée par Lunghi n’est pas une fantaisie gratuite, mais une manière de nous confronter à notre vulnérabilité collective.
En définitive, avec cet opuscule, Enrico Lunghi nous invite à pratiquer une étrange gymnastique du regard: penser notre présent comme une ruine et nous-mêmes comme une espèce disparue. Derrière le jeu littéraire, une question vertigineuse surgit: que restera-t-il de nous? Et, plus encore, qui saura encore nous comprendre? En feignant de nous archiver, Lunghi nous tend un miroir sans complaisance. Ironique, mélancolique, mais salutaire.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können