Né en 1953 à Differdange, Nico Helminger est l’une des voix majeures de la littérature luxembourgeoise contemporaine. Romancier, dramaturge, poète et récipiendaire, en 2008, du prix Batty Weber pour l’ensemble de son œuvre, il s’est imposé comme une figure inclassable, à la croisée du lyrisme et de l’expérimentation linguistique. Avec „Geckegen Hunneg“ („Miel fou“), recueil poétique publié en luxembourgeois, il poursuit une exploration exigeante et radicale de la langue comme instrument de saisie – et parfois d’impuissance – face au monde.
La langue comme terrain de fracture et de résonance
La langue, dit-il, est le premier accès de l’enfant au monde, un moyen de rendre l’incompréhensible tangible. Mais ce projet se heurte à une question essentielle: notre monde contemporain, fragmenté, aliéné, est-il encore saisissable par les mots? C’est à cette tension que répond „Geckegen Hunneg“, en brisant volontairement les règles du langage, en ouvrant la syntaxe, en déroutant le lecteur. Le texte devient éclaté, discontinu, mais c’est dans cette discontinuité même que s’entend une vérité poétique plus profonde. On retrouve dans ces poèmes une mélancolie mélodieuse, où passent discrètement les échos de grandes voix du passé – de Ryōkan à Rilke, de Hölderlin à Herbeck. Cette mélancolie n’est pas figée: elle s’accompagne d’une ironie subtile, d’un jeu avec les mots qui révèle les contradictions et les absurdités d’un monde „verréckt“, comme devenu fou. Helminger conjugue ainsi gravité et légèreté, méditation et sarcasme, pour donner corps à une poésie à la fois fragile et lucide.
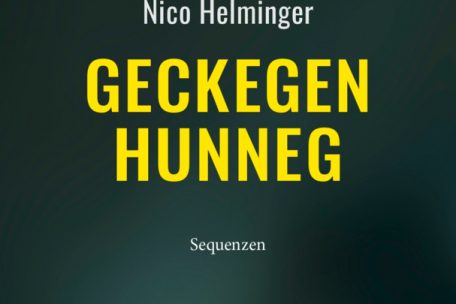
Les différentes sections constitutives du recueil condensent tout un univers d’images qui orientent la lecture. Elles agissent comme de petites portes d’entrée poétiques, parfois énigmatiques, qui disent beaucoup sur le rapport du poète au langage, à la mémoire et au monde. En effet, chacun de ces titres fonctionne comme une balise, un seuil symbolique qui prépare le lecteur à un certain climat poétique: l’évocation de l’enfance, du rêve ou du mythe ne se donne jamais de manière frontale, mais à travers un mot ou une expression qui ouvre un espace de résonances multiples. Ce procédé confère au recueil une structure fragmentaire et polysémique: au lieu de guider par un discours explicatif, Nico Helminger invite à l’interprétation, à l’association libre, à la projection de ses propres images intérieures.
Les titres comme seuils poétiques
Ces sections, par leur pouvoir suggestif, révèlent aussi un questionnement plus profond sur le rôle du langage. Nommer, c’est toujours donner une orientation, mais aussi poser les limites de ce qui peut être dit. Or, chez Helminger, le mot n’enferme pas: il trouble, il détourne, il provoque un décalage. Les titres – par exemple „Geckegt Liicht“ („Lumière folle“), „Tëntegebitt“ („Contrée d’encre“) – témoignent de ce double mouvement: ils fixent une image, tout en l’ouvrant vers l’inconnu. Enfin, ce jeu d’intitulés éclaire la visée du recueil: interroger la mémoire collective et individuelle, explorer l’enfance comme origine du rapport au monde, revisiter les récits fondateurs pour y déceler l’écho de notre présent. Ainsi, les sections ne sont pas seulement des divisions thématiques: elles sont autant de seuils symboliques qui invitent à repenser la relation du lecteur au langage poétique et à la réalité elle-même. Ensemble, ces titres tissent un fil conducteur: ils mettent en tension l’intime (l’enfant, le lit, la besace) et l’universel (la légende, la lumière), dans un langage qui hésite entre l’onirisme et la gravité, entre le jeu de mots et la blessure du monde.
„Figuren aus Bettgezei“ est un titre onirique, qui suggère le monde de l’intime, des rêves – les figures pouvant être fantasmatiques, nées du tissu, comme dans ces imaginaires nocturnes où tout prend vie. Par ailleurs, dans la section „Kand beim Numm“, l’évocation de l’enfance comme lieu d’origine du langage et de l’identité. Nommer l’enfant, c’est à la fois l’arracher à l’anonymat et l’inscrire dans un tissu symbolique qui le précède. Le nom fonctionne comme un premier ancrage: il fixe une appartenance, trace les contours d’une identité sociale et familiale, et, en même temps, ouvre une trajectoire singulière. Mais au-delà de cette fonction de désignation, il porte aussi une mémoire collective: il rappelle les générations antérieures, les mythes, les figures que l’on fait revivre en les réattribuant. Dans ce geste inaugural, Helminger semble interroger la puissance et l’ambiguïté du langage: donner un nom, c’est déjà orienter le devenir de l’enfant, mais c’est aussi enfermer son être dans une forme prédéterminée. Le poète suggère ainsi que l’identité naît du langage autant qu’elle s’y heurte, qu’elle se constitue dans cet entrelacs de mémoire héritée et de parole neuve. Ce titre simple et direct met en lumière ce moment fondateur où l’humain entre dans le monde par le langage, dans une tension permanente entre liberté et héritage.
Hauch war den Numm / vum éischte Mënsch, / Otem, dee geholl gouf : Brudder, / erschloe vu sengem Brudder, / bis haut / wësse mir net vill méi
„Tëntegebitt“: derrière ce titre se dessine une métaphore de l’écriture conçue comme un territoire à la fois obscur et fertile. L’encre y est plus qu’un simple instrument: elle devient une matière première, dense, presque organique, dans laquelle le poète plonge pour modeler des formes, tracer des signes et approcher l’indicible. Cette „contrée“ est à la fois un espace de création et d’errance, un lieu où l’on s’aventure sans carte, porté par la seule force du langage. L’obscurité évoquée par l’encre n’est pas seulement celle de la nuit ou du mystère, mais aussi celle des zones de l’expérience humaine qui résistent à la clarté, qui échappent à la nomination directe. Pourtant, c’est précisément dans cette obscurité que gît la fécondité: écrire, c’est donner une visibilité fragile à ce qui restait enfoui, c’est transmuter en poème ce qui, autrement, resterait muet. Helminger suggère ainsi que la poésie est un travail sur les lisières du dicible, un passage constant entre l’ombre et la lumière, le silence et la parole. En choisissant ce titre, il fait de l’écriture une véritable géographie intérieure: un territoire mouvant, ouvert aux explorations, où chaque mot n’est pas seulement signe mais trace, empreinte, promesse d’un sens à déchiffrer.
Ce dernier opus est donc un recueil qui exige du lecteur une disponibilité, une écoute fine: il ne propose pas une lecture linéaire, mais une expérience. Expérience d’un monde où le langage vacille, mais où, dans ce vacillement, surgit encore une beauté singulière. Avec cet ouvrage, Nico Helminger confirme son rôle de poète essentiel, qui interroge sans relâche les possibilités – et les limites – de la parole poétique.

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können