En 2008, 277.900 personnes de nationalité luxembourgeoise vivaient au Luxembourg sur une population de 483.800 habitants (soit 57,3% de Luxembourgeois). Si l’on ajoute les Luxembourgeois ne résidant pas dans le pays, c’est-à-dire les Luxembourgeois de l’étranger en 2008, un nombre estimé à l’époque à environ 20.000 personnes, on arrive à environ 300.000 personnes de nationalité luxembourgeoise en 2008. De 2009 à 2022, il y a eu un total de 108.806 acquisitions de nationalité luxembourgeoise (naturalisations, options, ré-acquisitions, double droit du sol – ici les chiffres pour 2009 et 2022 manquent encore –, simple droit du sol).2
Un tiers, soit 36.256 nouveaux Luxembourgeois, vivant pour la grande majorité à l’étranger, le sont devenus grâce à la ré-acquisition en tant que descendants d’un ancêtre qui était Luxembourgeois en 1900.
Les 72.550 personnes qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise par d’autres voies, à savoir la naturalisation, l’option (par déclaration), le double droit du sol et le droit du sol simple conditionnel, représentent également un nombre très élevé en termes absolus et relatifs. Au 1er janvier 2022, il y avait 341.200 personnes de nationalité luxembourgeoise sur une population de 645.400 habitants (soit 52,9% de Luxembourgeois). Entre 2009 et 2022, 63.300 nouveaux citoyens luxembourgeois se sont ajoutés. L’émigration récente de milliers de résidents luxembourgeois vers les régions voisines (province belge de Luxembourg, Lorraine française, Sarre et Rhénanie allemandes), en raison des prix élevés de l’immobilier au Luxembourg, explique en grande partie la différence entre les 63.300 nouveaux citoyens luxembourgeois résidents et les 72.550 nouvelles acquisitions. Si l’on ajoute à ces 72.550 les ré-acquisitions par le biais de l’article de ré-ethnicisation (36.256), on arrive à un chiffre total de 108.806 nouvelles acquisitions, soit une augmentation de plus d’un tiers par rapport aux 300.000 de 2008.
Cette augmentation considérable a été rendue possible par les ré-acquisitions d’une part, mais aussi par une augmentation significative des naturalisations et des options, comme le souligne l’évolution des vingt dernières années: de 2002 à 2008, il y a eu environ 1.000 naturalisations et options par an. De 2009 à 2017, cette moyenne est passée à 3.500. De 2018 à 2022, ce chiffre est remonté à plus de 6.000 naturalisations et options par an en moyenne.
Je voudrais expliquer sommairement la genèse historique de la révolution copernicienne de la nationalité luxembourgeoise en prenant soin de souligner d’entrée mon lien personnel avec le sujet.
Luxembourgeois, mais pas pour l’Etat
J’appartiens à une catégorie spécifique de Luxembourgeois. Luxembourgeois de naissance dans les faits et dans notre esprit, nous ne l’étions pas pour la loi luxembourgeoise, pour l’Etat luxembourgeois, comme nous le réalisions dans notre jeunesse, par le passeport étranger que nous portions sur nous et que nous devions montrer lors de nos voyages. Nous étions nés dix ans ou, comme moi, vingt ans après la guerre, de mère luxembourgeoise et de père italien – ou, pour d’autres, de père allemand ou suisse –, mais une loi luxembourgeoise de 1940 effaçait juridiquement notre identité luxembourgeoise pour ne nous concéder que l’identité étrangère.
Cette loi de 1940 discriminait les femmes luxembourgeoises. Elle enlevait leur nationalité d’origine, luxembourgeoise, à une grande partie d’entre elles, à celles mariées à des Allemands, à des Italiens, à des Suisses. Six ans plus tôt, en 1934, une autre loi venait juste de donner ce droit de garder leur nationalité en cas de mariage aux femmes luxembourgeoises. Ce fut à la suite des premières luttes menées pour l’émancipation des femmes dans un domaine, le droit de la nationalité, où elles avaient avant tout un devoir, celui de suivre la condition du père puis du mari. Les luttes des femmes dans les années 1920 furent transposées au Luxembourg par le député socialiste René Blum dans une proposition de loi et une mesure, adoptée en 1934: le droit de la femme de conserver sa nationalité luxembourgeoise en cas de mariage ou de la recouvrer si elle l’avait perdue par le mariage.
Par la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois, ce droit fut de nouveau enlevé aux femmes luxembourgeoises épousant un étranger si la nationalité de leur mari leur était acquise obligatoirement en vertu de la loi étrangère (ce fut le cas notamment pour la législation italienne, allemande, suisse). Cette même loi de 1940 abolissait le double droit du sol au profit de l’exclusivité du droit du sang et supprimait même la plupart des possibilités d’option prévues depuis le Code civil de 1803. Cette loi introduisait également la possibilité de déchéance de la nationalité.
L’Etat luxembourgeois mit trente-cinq ans à réintroduire le droit de la femme de conserver ou de recouvrer sa nationalité en cas de mariage par simple déclaration, par la loi du 26 juin 1975 sur la nationalité. Ma mère est redevenue Luxembourgeoise seulement sept ans plus tard, en 1982. L’Etat lui avait enlevé sa nationalité lors de son mariage en 1964, mais n’avait pas cru bon de l’avertir en 1975 qu’elle pouvait la recouvrer. Nul n’est censé ignorer la loi … Le droit de transmettre sa nationalité luxembourgeoise à ses fils mineurs fut seulement attribué par une autre loi luxembourgeoise, en 1986, pour les enfants nés après le 1er janvier 1969. Trop tard pour ses trois fils nés en 1964, 1965 et 1967. De mon côté, j’ai donc dû attendre d’avoir l’âge de 18 ans pour devenir légalement en 1983, par une procédure d’option, ce que j’étais en fait depuis ma naissance: Luxembourgeois. Et pour avoir enfin le droit de porter le maillot de l’équipe nationale de football des „Roude Léiwen“ des moins de 21 ans.
J’ai repensé à mon histoire personnelle, mais aussi à mes recherches sur l’histoire des migrations en lisant l’ouvrage provocateur, très remarqué et recensé dans la presse internationale, „Citizenship“ („Nationalité“), paru dans la série du MIT Press Essential Knowledge, du juriste Dimitry Kouchenov, spécialiste du droit de la nationalité et du droit de l’Union européenne. Kouchenov y analyse selon ses propres termes „l’histoire de la nationalité non pas comme un récit de libération, de dignité et de construction de la nation, mais bien d’auto-satisfaction, d’hypocrisie et de domination“. Il rappelle que la nationalité, ce „droit d’avoir des droits“ (Hannah Arendt) fut et reste souvent un outil légal qui justifie le contraire, l’exclusion, l’humiliation et la violence.
Au Luxembourg, dans l’après-guerre, le droit de la nationalité justifie l’exclusion de la communauté nationale des femmes luxembourgeoises qui épousent des étrangers et de leurs enfants, mais aussi l’exclusion de la fonction publique des fonctionnaires luxembourgeois qui épousent une Allemande. Il justifie l’humiliation des résistants non-luxembourgeois à qui on refuse une reconnaissance officielle et l’indemnisation des dommages de guerre, voire dont on séquestre les biens. Il justifie la violence à l’égard des victimes étrangères de la Shoah à qui le Ministère de la Justice interdit de revenir dans le pays qui était devenu leur patrie dans l’entre-deux-guerres ou à l’égard des travailleurs saisonniers étrangers que l’Etat luxembourgeois expulse en cas de mariage.
Du régime insulaire au régime expansif
C’est donc effectivement une révolution copernicienne que cette chronique décrira succinctement: le passage d’un droit de la nationalité luxembourgeois restrictif, appelé „régime insulaire“3, restrictif à l’égard à la fois des immigrants et de leurs descendants, des étrangers au Luxembourg, mais aussi à l’égard des émigrants et de leurs descendants, des Luxembourgeois à l’étranger, vers un droit de la nationalité inclusif, appelé „régime expansif“, à l’égard des immigrants et des émigrants. Cette révolution s’est faite avant tout par deux lois sur la nationalité, celles de 2008 et celle de 2017.
Pendant un demi-siècle, des années 1940 aux années 1990, l’acquisition de la nationalité était rendue difficile pour les immigrants et leurs descendants: par de longues durées de résidence, 15 ans jusqu’en 1986, puis 10 ans jusqu’en 2001 pour les naturalisations, par des droits d’enregistrement élevés. Depuis 1940, on exigait de l’étranger une „assimilation suffisante“, un terme supprimé seulement en 2008, alors que l’Unesco le demandait depuis 1959. Pour les Luxembourgeois à l’étranger, la législation sur la nationalité prévoyait encore en 1986 pas moins de huit cas de perte de la nationalité: le Luxembourgeois à l’étranger qui prend une nationalité étrangère, ses enfants mineurs, l’enfant luxembourgeois adopté par des étrangers, le Luxembourgeois à l’étranger et possédant une nationalité étrangère qui y vit plus de vingt ans, s’il ne fait pas de déclaration qu’il veut garder la nationalité luxembourgeoise, etc. Enfin, la loi faisait jusqu’en 1975 de femmes luxembourgeoises au Luxembourg des étrangères en cas de mariage avec un étranger et empêchait jusqu’en 1986 les femmes de transmettre la nationalité luxembourgeoise.
Les causes d’un revirement complet
Ce revirement complet est lié à plusieurs facteurs. Mentionnons en premier lieu des facteurs européens voire internationaux.
Un premier facteur ou plutôt deux facteurs combinés furent un moteur puissant qui a poussé à la libéralisation du droit de la nationalité. Comme l’a formulé Christian Joppke, c’est une forte immigration marquant la fin du 20e siècle et le début du 21e dans un contexte historique particulier qui favorise l’inclusion plutôt que l’exclusion: le contexte d’une culture mondiale des droits humains.4 Les législations sur la nationalité recherchant une homogénéité ethnique et les politiques d’immigration bafouant les droits humains les plus élémentaires qui accompagnèrent la construction de l’Etat-nation au 20e siècle ne sont plus considérés comme légitimes dans les pays démocratiques à l’ère de l’universalisation des droits humains.
La nouvelle tolérance de la double ou multiple nationalité fut un deuxième facteur. À l’époque des guerres mondiales, puis de la guerre froide, la double allégeance à deux patries devait absolument être évitée. Après la chute du Mur de Berlin et avec l’approfondissement de l’intégration européenne, la Convention européenne sur la nationalité du Conseil de l’Europe de 1997 reconnaissait „qu’en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes de l’Etat que ceux des individus doivent être pris en compte“ et invitait les Etats européens à trouver des solutions dans le domaine de la pluralité des nationalités. Comme tous les Etats européens avaient entretemps introduit la transmission de la nationalité non seulement par le père mais aussi par la mère, la double nationalité était déjà devenue une réalité sociologique sur le terrain.
Enfin, troisième facteur, depuis le Traité de Maastricht de 1992, une citoyenneté européenne se superposait dans l’Union européenne aux citoyennetés nationales. De nombreux droits y sont attachés: la liberté de circulation, de résidence, d’études, de travail, la non-discrimination sur la base de la nationalité, le droit de vote aux élections municipales et européennes, le droit de protection diplomatique, le droit de pétition auprès du Parlement européen.

Avant le Luxembourg, ses pays voisins ouvrèrent leur droit de la nationalité, la Belgique en introduisant le double droit du sol (1984) et l’acquisition de la nationalité par simple déclaration après une résidence de sept ans (2000) et l’Allemagne en introduisant le droit du sol conditionnel (1999), alors que la France resta fidèle au droit du sol en l’adaptant en 1998. Comme toujours, la classe politique luxembourgeoise s’est inspirée de ces voisins. À la base de la nouvelle loi de 2008 se trouve un rapport des professeurs de droit belges Francis Delpérée et Michel Verwilghen, présenté en 2004 au gouvernement et réalisé à la demande du ministre de la Justice de l’époque, Luc Frieden, portant sur la double et multiple nationalité au Grand-Duché de Luxembourg. Le politologue français Patrick Weil, spécialiste du droit de la nationalité de la France, a également conseillé le gouvernement.
L’originalité du Luxembourg
Une originalité du Luxembourg réside dans le fait que la libéralisation du droit de la nationalité à partir de la loi de 2008 s’est réalisée dans un large consensus entre forces politiques de la droite et de la gauche, à l’exception du parti populiste ADR. Dans les autres pays européens, les réformes de la nationalité ont été et sont des moments où les partis se sont divisés et continuent de se diviser selon un clivage droite-gauche. En Allemagne, c’est un gouvernement de gauche (SPD/Grüne) qui a introduit le droit du sol conditionnel. L’actuel gouvernement (SPD/FDP/Grüne) espère introduire la double nationalité contre la résistance du CDU/CSU. Christian Joppke décrit ainsi ce clivage: „La gauche politique, fidèle à sa vocation universaliste, soutient généralement des lois de la nationalité dé-ethnicisées, qui abaissent le seuil des exigences pour l’acquisition de la nationalité pour les immigrants. En revanche, la droite politique, davantage favorable à l’,être‘ qu’au ,devenir‘, soutient généralement des lois de la nationalité ré-ethnicisées, qui renforcent les liens avec les membres à l’étranger, même au-delà de plusieurs générations nées à l’étranger. La question de savoir si c’est la nationalité dé-ethnicisée ou ré-ethnicisée qui l’emporte est alors une question de majorité politique à un moment et dans un lieu donnés.“
La raison majeure de cette originalité luxembourgeoise apparaît très bien dans les débats qui ont eu lieu avant le vote de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. Premièrement, depuis les années 1990, le Luxembourg se définit officiellement comme un pays d’immigration. Deuxièmement, avec le passage du pays industriel à la capitale européenne et à la place financière et avec le boom économique qui l’a accompagné, la proportion d’étrangers est passée de 18% en 1970 à plus de 40% en 2008. Troisièmement, cette immigration est de plus en plus une immigration de personnes hautement qualifiées et représente la source principale des grandes performances de l’économie luxembourgeoise et du haut niveau de vie de la population.
Dans son avis sur le projet de loi du 8 mai 2007, la Chambre de Commerce rappelle que deux tiers des créateurs d’entreprise et deux tiers de la main d’œuvre (résidents et frontaliers) sont des étrangers. Il souligne aussi le déficit démocratique luxembourgeois vu „le trop grand décalage entre l’importance de la contribution des étrangers à la prospérité de l’économie luxembourgeoise et la faiblesse de leur représentation politique“. Ces deux éléments, la contribution décisive des étrangers à la „success story“ luxembourgeoise et le déficit démocratique sont relevés également dans le discours du rapporteur de la loi, Laurent Mosar (CSV), le 15 octobre 2008, pour expliquer l’ouverture plus grande de la nationalité aux étrangers.
La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise
La nouvelle loi du 23 octobre 2008 a profondément transformé la législation sur la nationalité dans le sens d’une ouverture, marquant un revirement complet d’une politique identitaire de la nationalité à une politique d’intégration.5 La double ou multiple citoyenneté est rendue possible pour les résidents étrangers au Luxembourg tout comme pour les Luxembourgeois à l’étranger. La ré-acquisition de la nationalité luxembourgeoise pour les anciens Luxembourgeois vivant à l’étranger n’est plus subordonnée à la perte de leur nationalité étrangère. Le double droit du sol automatique est réintroduit, presque 70 ans après avoir été aboli. Par cette mesure, l’enfant, né au Grand-Duché de parents non-luxembourgeois dont un des parents (père ou mère) est déjà né au Grand-Duché, possède la nationalité luxembourgeoise. Avec la France et l’Espagne, le Luxembourg est aujourd’hui le troisième pays de l’Union européenne à appliquer le double droit du sol automatique.6 Il faut néanmoins préciser que, contrairement à la double nationalité, le double droit du sol a été introduit à l’initiative non du ministre en charge Luc Frieden (CSV), mais à la suite d’un amendement du Parti socialiste, alors que les Verts avaient déposé un amendement demandant un droit du sol simple.
Les traditions politiques restèrent donc visibles en 2008, la gauche parvenant à introduire une mesure „dé-ethnicisante“, facilitant l’acquisition pour les immigrants et leurs descendants, comme le double droit du sol. La droite du CSV, de son côté, introduisit une mesure „ré-ethnicisante“ originale, facilitant la ré-acquisition pour les Luxembourgeois à l’étranger, même au-delà de plusieurs générations, une mesure qui passa inaperçue lors des débats en 2008, mais eut un grand impact par la suite: Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle, même né à l’étranger, d’un ancêtre luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 peut recouvrer la nationalité par déclaration (art. 29).
Ces aspects d’ouverture de la loi de 2008, pour les immigrants tout comme pour les émigrants et leurs descendants, furent toutefois contrebalancés par des mesures restrictives. Ces mesures restrictives concernaient les années minimales de résidence pour obtenir la naturalisation (passant des 5 ans de la loi de 2001 à 7 ans), la suppression des procédures d’option pour les enfants et les conjoints ainsi que l’introduction d’épreuves de langue et de cours civiques obligatoires. Il est important de noter que l’obligation de prouver la connaissance de la langue luxembourgeoise représente un obstacle supplémentaire qui est difficile pour beaucoup d’étrangers dans un pays avec une culture linguistique multilingue comme le Luxembourg où l’alphabétisation se fait à travers l’allemand et la principale langue de communication utilisée dans la vie professionnelle est le français – et de plus en plus l’anglais – et non le luxembourgeois.
Avec une immigration nette de près de 10.000 personnes par an et une population en constante augmentation, la pression pour libéraliser la législation sur la citoyenneté est restée très forte après 2008. (à suivre)
1 Un grand merci pour l’aide précieuse apportée dans ces recherches à Joëlle Gilles, préposée du Service de la Nationalité au Ministère de la Justice, Laurent Hirtz, préposé adjoint, et Christian Paler, gestionnaire dirigeant. Merci également à François Peltier, responsable de l’unité Population du Statec, et à Sylvain Besch, chercheur au Cefis (Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales) pour les statistiques complémentaires fournies.
2 Ne sont pas inclus dans ce chiffre de 108.806 les enfants mineurs de parents qui ont acquis ou ré-acquis la nationalité luxembourgeoise ainsi que les Luxembourgeois dits „de plein droit“ (art. 7 de la loi de 2017), c’est-à-dire les personnes nées avant le 19 avril 1945 sur le territoire luxembourgeois et leurs descendants en ligne directe masculine qui se voient accorder automatiquement la nationalité en vertu du droit du sol. Pour ces catégories, il n’existe pas de chiffres complets et fiables.
3 Vink, Maarten & Bauböck, Rainer, Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of citizenship regimes in Europe, in: Comparative European Politics, 11(5), 2013, p. 621–648.
4 Joppke, Christian, Citizenship between de- and re-ethnicization, in: European Journal of Sociology/Archives européennes de sociologie, 44(3), 2003, p. 429-458.
5 Vink, Maarten/De Groot, Gerard-René, Citizenship Attribution in Western Europe: International Framework and Domestic Trends, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 2010, 36/5, p. 713-734, DOI: 10.1080/13691831003763914; Vink, Maarten, Migration and Citizenship Attribution: Politics and Policies in Western Europe, Abingdon/Oxon, 2011.
6 Parcours des ressortissants de pays tiers vers la nationalité dans l’UE. Rapport de synthèse de l’étude du Réseau européen des migrations (REM) 2019, Juillet 2020, https://emnluxembourg.uni.lu/wp-content/uploads/sites/225/2020/07/5_Rapport_de_synthese_Parcours_vers_la_nationalite_FR.pdf

 De Maart
De Maart





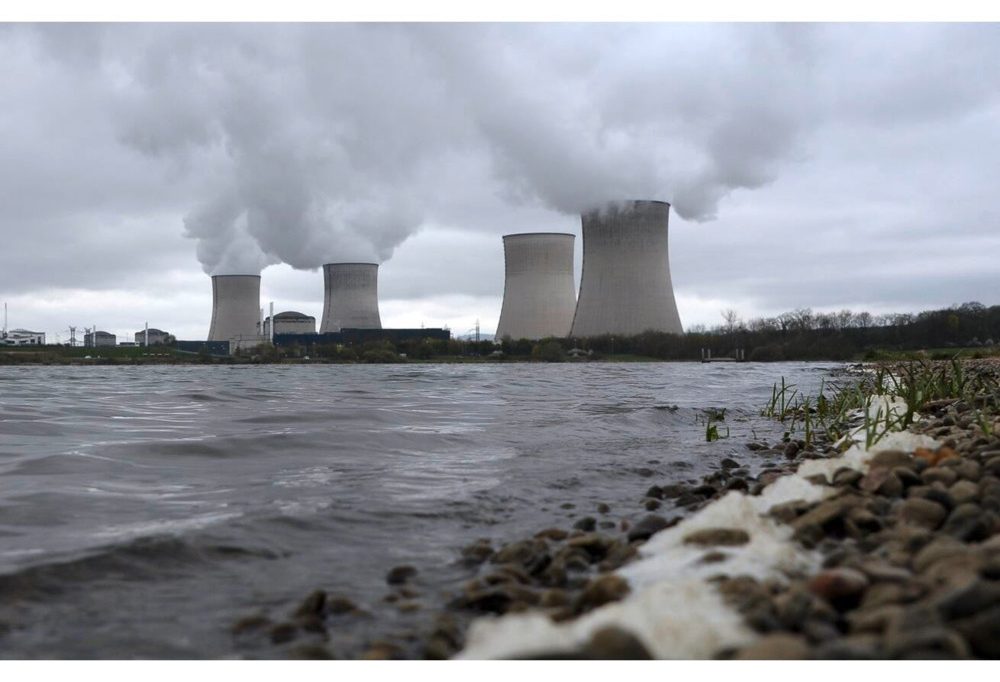

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können