Catt
Née dans un village du nord de Wendland en Basse-Saxe, Catharina Schorling a choisi, pour nom de scène, son diminutif, Catt, et sa musique pourrait justement se définir en tant que miniature. Non pas que Catt élabore une pop dénuée d’ambition, pas du tout, il faut prendre le terme „miniature“ en tant que synonyme de „hauteur d’enfant“, mais aussi, pourquoi pas, en tant que vignettes d’un temps englouti. Au-delà de l’ouvrage écrit en 1667 par John Milton, le „paradis perdu“ renvoie à l’enfance et à tout ce qui s’y rattache, comme l’insouciance et l’éblouissement, mais également les vertiges devant le monde adulte. „On ne guérit pas de sa jeunesse“, écrit Léon-Paul Fargue dans „Le Piéton de Paris“ (1939), jusqu’à ce que cet aphorisme soit repris en chanson par Jean Ferrat, „Nul ne guérit de son enfance“ (1991), puis légèrement modifié par Oxmo Puccino, „Personne ne guérit de son enfance“ dans „L’Enfant Seul“ (1998). Et Catt ne fait pas exception: davantage que Wendland ou aujourd’hui Berlin, elle habite son enfance.

Sur la pochette de „Why, Why“ (2020), la musicienne ferme les yeux, comme si elle cherchait à replonger dans ce qui serait tant un monde qu’un état. Si l’Allemagne est bien le pays de Kraftwerk, qui se traduit par „centrale électrique“ et qui joue un son „motorik“, du côté de Catharina, c’est plutôt l’épure de la nature qui est sollicitée. S’il faut aller à l’essentiel des paysages, les titres sont à l’avenant, „Strange Lands“, „Sea II“, mais il s’agit aussi de partir de la lune, qui donne le nom de son premier EP („Moon“, 2019), pour arriver au soleil, qu’elle tient dans sa main sur la pochette, cette fois-ci, de „Change“ (2023).
Transformation
Au vu du titre, „Change“, il est question d’évolution. Ce n’est pas une histoire de métamorphose de personnages façon David Bowie – qui, lui, en tant que caméléon, est l’interprète de „Changes“, avec un s – mais de se voir grandir, la musique en guise de miroir auditif et pour notre propre reflet, c’est la transformation de l’introspection en action. Catt connaît la musique depuis ses premiers cris, elle maîtrise les instruments avec aisance, le piano et le trombone, comme si elle les avait toujours eus entre les mains, comme des jouets qui, en fait, n’ont pas d’âge. Ses notes dévalent les pentes; ces pentes ressemblent à des flash-backs. Pour citer un morceau, „Spell Me Free“ est né à partir d’une tristesse que Catt dit avoir portée en elle; au bord de l’eau, elle a laissé couler ses pleurs et ses yeux n’ont, finalement, fait qu’imiter la nature. En exergue du roman „Les Bonbons chinois“ (2000), Mian Mian écrit: „Ce livre est fait des larmes que je n’ai pas pu pleurer“ – par analogie, la musique de Catt est faite des pleurs qu’elle a pu harmoniser.
Joué avec un piano qui appuie sur la boule au ventre, „Sea II“ est pourvu de ralentissements pour calmer un peu l’essoufflement. S’il y a d’autres piano-voix, tel que „Curve A Line“, ou d’autres envolées intimistes, un titre comme „Patterns“ fait frapper des pieds et fait claquer des mains, le piano sonne quasiment cabaret, là où il est désaccordé sur „Willow Tree“. Pour rester au cœur de la nature, c’est l’arc-en-ciel qui surgit après la pluie au fond des yeux. „Mirror“ devient alors une promenade guillerette, alors que „Jungle of Abundance“ est luisant par ses cuivres. Le piano est paisible sur „You Came Through A Star“, une chanson où la voix est doublée pareille à un écho qui surgit dans un jardin secret, en plus des chœurs doux qui ont l’allure de l’espoir. Les angoisses sont ravalées comme les larmes, même l’éclaboussure d’une guitare piquante, dispersée çà et là, ne pourra faire de l’ombre au paradis retrouvé.
Osees
Le début des années 2000 renvoie au „retour du rock“, avec The Strokes, The White Stripes ou The Libertines, ainsi que toute la déferlante de groupes „à guitares“, alors que la décennie d’avant est marquée par le post-modernisme, le rock emmêle ses cordes dans l’électronique – et vice versa. Parallèlement à la démocratisation d’internet, il s’agit de la jouer brut, c’est le retour à la source où s’abreuver de tourbillons acides afin que l’ivresse électrique monte au cerveau, jusqu’à ce que la tête danse, tout en approuvant, par des headbangings qui jamais ne laissent la place à l’ennui. Osees se pose là, mais ne s’arrête pas là, au sens où le groupe ne s’arrête pas.
Le vrai démarrage s’effectue au milieu de la décennie, en 2006, avec „The Cool Death Of Island Raiders“. Et, depuis, c’est un rendez-vous annuel, immanquable, soit un disque qui, à chaque fois qu’il provoque un sursaut d’une main de maître, rappelle l’existence d’une formation ni plus ni moins vitale, au point de contredire ceux qui clament en début de siècle ou aujourd’hui que le rock est mort. Avec Osees, il est peut-être même trop vivant, vivace autant que vibrant. À l’instar de ses compagnons de route (Black Lips, Ty Segall), qui ne sont pas dans la même voiture, mais qui suivent la même trajectoire – le garage, pour mieux en sortir – Osees va de l’avant à l’intérieur d’une machine à voyager dans le temps, les oreilles a priori fixées dans le rétro.

Le groupe vient de John Dwyer, tête pensante et chantante, multi-instrumentiste qui, depuis la fin des années 1990, reprend les bonnes vieilles bases du garage pour passer le cap du nouveau siècle. À peine sorti de son adolescence à Providence (Rhode Island), John tourne le dos à l’école direction les salles de concerts et les états altérés de la conscience. Après avoir accumulé les petits boulots, il veut en découdre. En 1997, il déménage à San Francisco et, avec son acolyte Jeff Rosenberg, John forme Pink & Brown, un groupe de punk hardcore qui fait tellement de bruit qu’il finit par le faire connaître. Dwyer s’agite dans tous les sens, il multipliait déjà les projets – Coachwhips, Dig That Body Up, Yikes – une jambe dans le garage, l’autre dans le métal indus, et avec Osees encore, il est question de secouer les tympans autant que le corps.
Un groupe qui donne envie
Quand il file en solo, c’est même la bougeotte en ce qui concerne le nom du groupe, comme pour amplifier un brouillard de larsens et de pédales d’effets, la formation répond aux noms d’OCS, Thee Oh Sees, Oh Sees. Dwyer n’est jamais rassasié de disques et de concerts, quand il n’enregistre pas des démos à gogos, à croire qu’il passe plus de temps pratiquer la musique qu’à ne pas en faire, à croire même que son souffle et son pouls sont maintenus par l’électricité statique; pour lui arrêter de jouer, c’est arrêter de vivre. Mais il n’est pas question de pratiquer le rock par-dessus la jambe, l’illumination est encore mieux capturée dans l’urgence; comme on dirait de quelqu’un qu’il se regarde écrire, Dwyer ne s’écoute pas jouer; son rock est foisonnant et trépidant.
Depuis le premier album précité, encadré par de la freak folk, Osees mélange à son garage lo-fi et psychédélique du free jazz, du space rock, du hard rock, le tout saupoudré par un feeling funky. S’il y a des relents de Can ou de Suicide, il y a des bouts de Brian Jonestown Massacre (un morceau comme „Dead Energy“). Le krautrock s’agite aussi avec „The Virologist“, qui dure et qui dure (presque quinze minutes) ou à travers son projet Damaged Bug. On y trouve encore de la pop saturée, du mellotron, du saxophone, des orgues, des synthés, et puis le field recording qui laisse la vie se faufiler. Pour consolider le tout, une voix bave et escalade les aigus, complétée par celle de Brigid Dawson, devenue la moitié mélodique de John Dwyer et les mains du clavier et du tambourin.
S’il faut bien tenir la note, le groupe n’est pas en perte de vitesse dans les années 2010, comme l’attestent les très bons disques „Warm Slime“ (2010) ou „Floating Coffin“ (2013). Et c’est là le moment d’aller vers les déviations progressives, comme sur „Henchlock“, un morceau qui fait exploser les compteurs avec plus de vingt minutes de virtuosité. Depuis 2020? Six albums en plus d’une tournée, évidemment, qui s’étire jusqu’à jeudi soir à la Kulturfabrik. Voilà un groupe qui donnerait envie de citer à son sujet le plus gros tube d’un combo, The Strokes, avec qui il serait aujourd’hui impossible de le comparer – le morceau, c’est „The End Has No End“.

 De Maart
De Maart

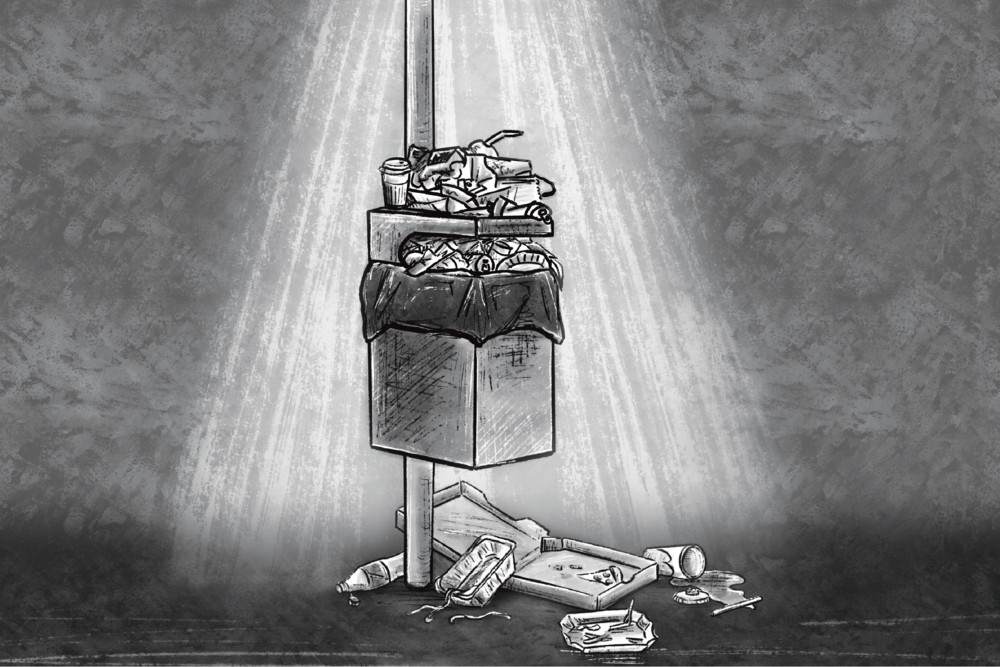





Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können