Tageblatt: Avez-vous l’impression d’avoir dévoilé un secret de famille, voire d’Etat?
François Noudelmann: C’est à la fois un secret de famille et un secret d’Etat parce que Cadillac, petit village de la Gironde, abrite un hôpital psychiatrique et le „Cimetière des oubliés“. On y voit les noms de tous ceux qui ont été enterrés, dont mon grand-père Chaïm. En faisant une enquête sur ce lieu, j’ai levé un secret de famille qui a sans doute été enfoui, parce qu’on ne peut pas dire qu’il y a des fous dans sa famille, mais aussi parce que mon grand-père est quelqu’un qui a émigré depuis la Lituanie pour fuir les pogroms.
Arrivé en France, il s’est engagé dans l‘armée pour pouvoir devenir français et, malheureusement, il a reçu une bombe au gaz moutarde. Il est devenu fou et il a passé 22 ans dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, en faisant une enquête sur cette personne, je parle de quelqu’un dont dans la famille on n’a jamais voulu parler, mais je parle aussi de quelqu’un qui est mort de faim dans un hôpital en 1941, et là, c’est un secret national. Depuis quelques années seulement, les historiens montrent que, pendant la guerre en France, on a fait mourir les fous. Était-ce une intention comme en Allemagne avec l’eugénisme – le fait d’éliminer des personnes qui ne sont pas normales – ou tout simplement avait-on considéré que c’était des bouches inutiles?
En tout cas, il y a eu 40.000 malades mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Certains sont célèbres comme Camille Claudel, mais la plupart des anonymes qui sont dans ce cimetière et fosses communes.
Vous êtes philosophe et vous vous êtes lancé dans l’écriture d’un premier roman intime. Pourquoi?
J’ai écrit des essais et, souvent, parlé de choses abstraites tout en évoquant des thèmes qui me tenaient à cœur de manière intime. Mais, souvent, on se réfugie derrière les grandes idées et concepts et, là, pour traiter de la question de l’identité, de la généalogie, je me suis dit „bas les masques“.
Je pars et parle de moi cette fois-ci et j’espère que cela aura une portée universelle. Je joue le jeu de l’enquête familiale mais, de toute façon, je ne pourrai jamais atteindre la vérité. Il faut passer par le roman parce que j’ai besoin d’imagination. Pour dire l’itinéraire incroyable de cet homme, Chaïm, il faut que je l’imagine.
Je n’invente pas, je prends les faits comme, par exemple, les traitements utilisés dans l’hôpital psychiatrique, la présence de femmes, les loisirs… et, à partir de là, je propose aux lecteurs des images de ce personnage incarné. Il faut qu’on puisse vivre les choses à travers mon grand-père et, ensuite, à travers mon père. J’ai besoin qu’on les voit vivre, aimer, souffrir.
Votre grand-père puis, votre père, ont choisi le silence …
C’est l’histoire de la relation des pères à leur fils et pour ce qui est de ma famille, une relation assez contradictoire parce que ce sont des pères qui n’ont jamais rien voulu transmettre. Moi, j’ai hérité du refus d’hériter. Mon grand-père est mort dans la solitude et, forcément, n’a rien transmis. Mon père, lui, a connu cinq années de guerre en tant que juif en Pologne. Quand il est revenu de la guerre, il n’a jamais parlé de ce qu’il avait vécu.
J’ai voulu savoir, je lui ai demandé de me raconter sa guerre. Et pendant dix heures, il me raconte, une fois pour toutes. Cet enregistrement je l’ai fait à l’âge de vingt ans. Ensuite, j’ai complètement refoulé l’histoire de mon père puisqu’il s’est suicidé. J’ai voulu laisser cette histoire derrière moi. Je suis parti à New York. Là, pour moi, il s’agit de réintégrer cette histoire familiale.
Aujourd’hui, sa deuxième femme, qui est ma mère, ne savait même pas que mon père avait vécu tout ça. C’est une génération qui, très longtemps, s’est tue parce qu’elle avait l’impression que c’était inaudible. Pour moi, c’est une manière aussi de leur faire un tombeau et de raconter la vie de ces oubliés, des choses qu’ils auraient pu communiquer et dont l’histoire n’a jamais été dite et reconnue. Ce sont des hommes dont les cendres sont imprégnées de la terre française mais il n’y a pas de sépulture. Mon livre joue ce rôle-là.
La francité et la folie sont-elles liées?
Dans mon cas oui. Mon grand-père était fou de la France parce c’est le pays où les intellectuels ont défendu un juif français, Alfred Dreyfus. Donc pour mon grand-père et pour beaucoup d’autres la France, c’est le paradis. Et il y va. Il est devenu fou à cause de et pour la France. Il s’est battu en 14-18 sous l’uniforme français.
Par la suite, il a transmis sa passion de la France à son fils Albert, mon père, qui était totalement assimilé. Jusqu’au jour où, soudain, il lui arrive une trahison. Au moment où les soldats français se sont faits prisonniers, les Allemands demandent à ce qu’on dénonce les juifs. Un camarade français dénonce mon père et c’est cinq ans de survie. Il y a une espèce d’amour à la folie de la France chez Albert, qu’il a vécue avec passions et trahisons.
Et pourtant votre père a été totalement assimilé …
Pour ces juifs-là, c’est l’assimilation. Il faut tout faire pour s’intégrer, effacer ses origines et appeler leurs enfants par des prénoms français. Je m’appelle François. Il y a vraiment une volonté de ne pas regarder le passé, uniquement le futur. Ils ont même considéré qu’ils n’avaient pas de passé. Moi, au fond, je réhabilite le passé. On ne peut imaginer qu’on vient de rien. On a un passé et en même temps, je ne pense pas m’identifier totalement à ce passé. J’en parle grâce à Cadillac.
Aujourd’hui, certains revendiquent l’assimilation totale par, notamment, l’interdiction de prénoms arabes …
Je pense effectivement qu’un certain nombre de juifs surtout de l’Europe de l’Est ont cherché l’assimilation, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Même en Allemagne, les juifs allemands sont plus royalistes que le roi. Il y a vraiment une volonté de gommer les origines pour s’intégrer.
Sociologiquement, il faut respecter les itinéraires des uns et des autres. Certains ont éprouvé la nécessité de s’assimiler, d’autres ont voulu conserver quelque chose de leur identité et ensuite, il y a les jugements politiques. Moi j’observe simplement ce qui s’est passé dans ma famille, je ne juge pas et ce n’est certainement pas un modèle. Les croisements, les métissages, les créolisations, c’est ce qui fait la vie.
Et donc, on prend des cultures, on s’imprègne des cultures des autres. Les relations entre les différences, ce n’est pas de gommer ce qu’on est pour devenir l’autre ou bien refuser l’autre pour affirmer ce qu’on est. C’est l’échange qui est beau et enrichissant. J’observe effectivement que mon père a été dans une logique d’assimilation totale, mais moi, par exemple, je reconnais qu’il y a des choses qui passent à travers les générations sans qu’on s’en rende compte. Donc quelque chose pour moi, du judaïsme, de la judéité, a été transmis. J’admets qu’on ne naît pas de rien. Il y a des choses qui reviennent. Je crois qu’il faut à la fois admettre ce qu’on est, mais aussi accepter de changer. Je vis dans un pays très multiculturel. Il y a une sorte de vie très cosmopolite dans la ville de New York, on est tous new-yorkais. Des gens extrêmement différents arrivent à entrer en relation. On ne va pas obliger à prendre un prénom. Je crois en l’échange, en la possibilité de faire relation avec l’autre. J’aime les différences pour échanger, pas pour s’affirmer, ni s’affronter.
L’identité française parcourt l’ensemble de votre roman …
Je n’écris pas un livre politique. Je raconte l’histoire de trois générations: d’un étranger qui vit en France, d’un Français, jusqu’à un Français de l’étranger, c’est moi. C’est l’histoire d’un grand arc sur 100 ans ou comment l’identité française et l’identité juive se sont entremêlées dans ces espoirs fous de devenir Français comme tout le monde. C’est une histoire franco-française et de juifs qui ont voulu devenir totalement français. Cela a été vécu de la même manière en Allemagne et en Autriche, les juifs ont voulu vraiment devenir totalement allemands, autrichiens. En France, on est obsédé par l’identité française. On a eu il n’y a pas longtemps un ministère de l’Identité nationale (de l’Immigration, de l’Intégration et du Développement solidaire, de 2007 à 2010, ndlr), cela me sidère.
Avez-vous le sentiment d’avoir „renoncé“ à la France en partant à l’étranger?
La première partie du roman parle de mon grand-père, la deuxième de mon père. Dans la troisième partie, je parle de mon expérience et de quoi j’hérite. Le „je“ avec plein d’interrogations: le sentiment de ne jamais être vraiment à ma place, de ne pas en être, parfois de l’imposture, d’une place que je ne mérite pas … De très nombreux personnages me disent avoir vécu cela. Cette expérience n’est pas communautaire, liée seulement aux juifs, mais qui concerne tous les immigrés et aussi des gens qui ont traversé plusieurs milieux sociaux, les „transclasses“. Mes parents n’ont jamais fait d’études, ils n’ont pas connu les codes sociaux. Je les ai découverts à travers les relations sentimentales de mon père et donc j’essaie de montrer comment, dans une société, on traverse des milieux – ce qui n’est pas toujours facile – et comment le fait d’accéder à un milieu intellectuel américain, on garde quelque chose du sentiment des exilés.
Je vis aujourd’hui à New York. J’enseigne la littérature française. Et, au fond, à l’étranger, je sens ce que c’est d’être français et je réfléchis à l’identité française. Si je parle de la judéité, ce n’est pas que la judéité des juifs, je pense que tout le monde peut partager cette expérience de ce que j’appelle la judéité, faute de mieux, mais qui est l’expérience de la traversée des cultures et des milieux sociaux. Ce livre, en fait, témoigne d’une expérience qui est partageable et partagée par des tas d’enfants et petits-enfants de migrants quels qu’ils soient. Je reçois des lettres de petits-enfants d’immigrés espagnols, italiens, sénégalais, marocains qui se reconnaissent dans ce que j’ai écrit. C’est un bonheur.
Vous êtes professeur d’université à New York. Que vous inspire et comment vivez-vous la „cancel culture“?
Ce sont des remous très intellectuels. Je ne suis pas sûr que cela corresponde à quelque chose de très profond dans la société, mais plus largement dans les universités, dans les médias, les lieux culturels. Je crois qu’il faut entendre la revendication des minorités, de ceux qui considèrent qu’on ne les a pas reconnus, qu’on ne parle pas de leur culture. Et donc je suis favorable à ce qu’on intègre des cultures dites minoritaires. En revanche, je suis extrêmement défavorable à l’idée de soustraire, d’annuler des œuvres, déboulonner des statues. Il faut reconnaître l’histoire et il faut additionner et pas soustraire. Vous voulez qu’on parle d’un auteur qui n’a jamais été écouté? Eh bien oui, on va l’écouter, mais ne demandez pas qu’on annule Schubert ou Flaubert. C’est hors de question. Personnellement, je n’ai pas ressenti cette pression. Mais il faut être vigilant parce que, effectivement, je sais que dans d’autres universités très proches, ces questions d’annulation se posent. C’est un débat à la fois intéressant et inquiétant. Il faut s’y confronter et essayer d’entendre, de comprendre, sans forcément tout accepter.
*Parutions récentes: „Un tout autre Sartre“, Ed. Gallimard, 2020; „Edouard Glissant, l’identité généreuse“, Ed. Flammarion, 2018; „Le génie du mensonge“, Ed. Max Millo, 2015.
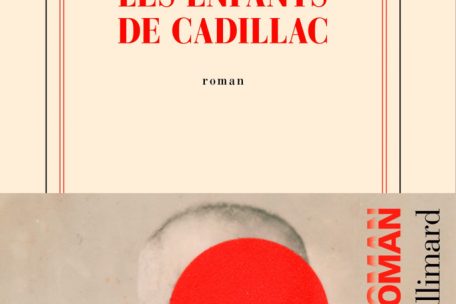

 De Maart
De Maart







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können