7. November 2025 - 15.15 Uhr
Atelier MuGi.luEntre scandale et audace: Une Fräulein et une veuve enseignent la danse dans les années 1930
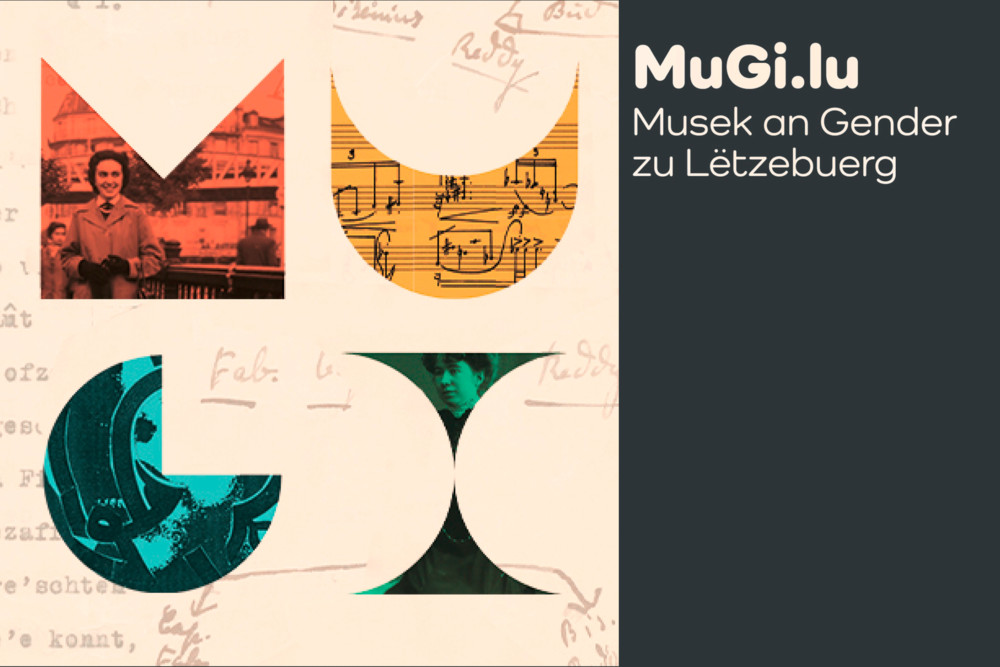
„Die Mayo hatte ihr langes rotes Kleid bis über die Knie hochgenommen und tanzte allein einen cancanisierten Rumba, dem etwas wie negerhafter Rausch entströmte. Den Kopf weit zurückgebogen, flatterten die mandelförmigen Augen unter halbgeschlossenen Lidern einladend umher. Irgendwie wirkte sie nackt und unanständig trotz Gelenkigkeit und unzweifelhafter Grazie.“ Cette présentation de la rumba apparait dans un feuilleton publié par Der Landwirt le 8 septembre 1936. La danse d’origine cubaine fait fureur en Europe au début des années 1930, mais comme d’autres danses nouvelles avant elle, elle a une aura sulfureuse. Et quelle audace a-t-il fallu à deux professeures de danse pour l’enseigner au Grand-Duché? La presse luxembourgeoise, numérisée par la Bibliothèque nationale et accessible sur eLuxemburgensia.lu, permet de creuser cela.
Encore une danse nouvelle
La soif des publics pour des danses nouvelles date au moins du début du 20e siècle. Un article de L’Indépendance luxembourgeoise, paru le 2 mai 1911, débute par „Encore une danse nouvelle, Mademoiselle“, d’après le refrain d’une chanson de Mayol: „plus il y a de modèles nouveaux, plus on veut en inventer. Quand on n’en trouve plus, quand l’imagination est à court, on les emprunte aux temps passés, ou aux pays étrangers, et leur saveur exotique n’est pas sans charmes.“ Ainsi la rumba n’est pas plus scandaleuse que le furent le tango ou le fox-trot avant elle.
C’est à ces trois danses qu’un journaliste réfère dans la Luxemburger Zeitung du 19 avril 1932. Il commente de façon ironique l’interdiction des danses „immodestes“ par un évêque français: „Regardez donc ce couple qui gigote dans l’arène. A quoi peut-il songer, le jeune homme qui sent s’écraser contre sa poitrine un double trésor ferme et dodu? A quoi rêve-t-elle, la jeune fille, quand la caresse du mâle, irritante et brûlante, enveloppe son épaule, pétrit son dos, effleure ses jambes? En faut-il tant pour émouvoir ce que l’habitude appelle: les cœurs? […] Allons ne nous faisons pas d’illusions: la danse, surtout la danse moderne, est une possession simulée.“
Les publics se familiarisent en tout cas avec ces danses nouvelles lors de fêtes dansantes, généralement dans des hôtels, restaurants ou cafés. Les établissements de l’entre-deux-guerres sont souvent des lieux multifonctionnels, disposant parfois d’une piste de danse et scène à l’italienne. S’y installent des écoles de danse, dont les cours précèdent ou s’intègrent aux thés dansants et bals hebdomadaires. Sites de consommation cosmopolites, on s’y frotte aux danses nouvelles. Les enseignant·e·s se positionnent comme des intermédiaires qui traduisent et domestiquent l’altérité qu’elles représentent.

Défendre sa légitimité
„Da über den ‚RUMBA‘ irgendwo skeptische Töne geflötet werden, teile ich zur allgemeinen Aufklärung folgendes über diesen Modetanz mit: (…) Die rhythmische Basis liegt tendenziös im Spanischen, während das melodiös Gehaltene eine typische amerikanische Färbung aufweist und somit ein ‚Original‘ von Tanz bildet. Mithin ist keine Rede von einer Irreführung durch Kombinierung veralteter Tänze oder selbst erfundener Verrenkungen“, explique Mademoiselle Annemie (Anne-Marie) Wendling, une coiffeuse d’Esch-sur-Alzette (Escher Tageblatt, 1.10.1931). Elle vient d’une famille d’artisans, d’inventeurs et de commerçants et en hérite le sens de la publicité et leur flair pour les nouvelles modes.
MuGi.lu
MuGi.lu (Musique et Genre au Luxembourg) est un projet de recherche de l’Université du Luxembourg. Il cherche à archiver et présenter des documents biographiques et des œuvres musicales sous l’angle du genre sur la plateforme https://mugi.lu. Le but est de montrer comment la vie musicale au Luxembourg a été influencée par des relations de pouvoir. Ces contraintes sont liées au genre sexuel des personnes, mais aussi – de façon intersectionnelle – à d’autres traits (milieu social, appartenance ethnique, etc.). Dans cette nouvelle série nous invitons des chercheur·e·s associé·e·s à explorer leur sujet (ici la danse) sous cet angle.
Si Wendling se présente en autorité, c’est qu’en tant que femme, elle doit défendre sa légitimité à enseigner, contrairement aux Tanzmeister qui dominent le métier depuis la fin du 19e siècle. Elle est en rivalité avec l’un deux: Charles Copriwa, son ancien partenaire de danse, tailleur de métier. Copriwa insiste depuis leur séparation sur son statut de Tanzmeister formé à Vienne. Il a conservé leurs créneaux de cours à l’Hôtel de la Poste, rue de l’Alzette, tandis qu’elle s’est retrouvée sans local. Pleine de ressource, Wendling en fait état dans la presse: „Allen Interessenten zur gefl. Kenntnis, dass ich an dem Tanzunternehmen COPRIWA-WENDLING nicht mehr beteiligt bin und von nun an PRIVATSTUNDEN im eigenen Tanzsalon sowie ausser dem Hause erteile“ (Escher Tageblatt, 24.1.1931). Un mois après cette annonce, elle trouve refuge auprès de la veuve Grethen, qui tient le dancing Paris-Palace, également rue de l’Alzette.
La carrière face au mariage
Dans ses réclames, elle rappelle qu’elle s’est formée auprès du Ballettmeister P. Bootz à Saarbrucken. Il lui semble difficile de s’émanciper totalement d’une garantie masculine. Elle enseigne „alle modernen Tänze“ dans différents établissements jusqu’à ce que sa carrière s’arrête abruptement avec son mariage à un serrurier en 1938. En cela, son parcours se distingue de celui de Maisy (Marguerite) Weber, plus connue comme la veuve d’Edy (Edouard) Rausch, dont la carrière commence avec le mariage. Mais Weber aussi semble avoir été formée par un Tanzmeister: son propre mari. C’est avec lui qu’elle donne des cours à partir de 1920, avant d’en donner seule dans ces mêmes lieux après le décès prématuré de Rausch en 1928. Est-ce cette relative „liberté“ qui lui permet de continuer sa carrière? Un détour par l’histoire de la famille Rausch fournit d’autres éléments de réponse.
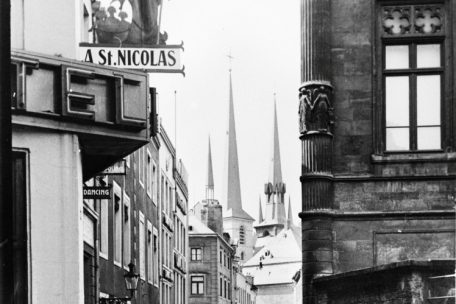
Edy Rausch (1894-1928) a appris la danse auprès de ses propres parents. Après le décès de son père, l’adolescent donne des cours ensemble avec sa mère, principalement à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette. A 21 ans, il s’établit comme Danzmeeschter en ville-haute, „Héléchgêschtstrôs (beim Konsèrwatoar)“, et prétend que ce n’est que chez lui que l’on apprend „de’ néist Dènz“ (les danses les plus récentes) (D’Natio’n, 1.11.1916). Il épouse Weber en 1920 alors qu’il commence à diriger le Métropole Dancing, rue de la Porte Neuve. Par la suite, il enseigne à l’Hôtel Cresto, face à la gare d’Esch-Alzette, et dans la capitale à l’Hôtel de Luxembourg, rue de l’Eau, ainsi qu’à son domicile, avenue Monterey. Son épouse semble être sa partenaire attitrée. Une fois veuve, celle-ci s’appuie sur la réputation et les partenariats de la famille Rausch. Elle ouvre des cours réguliers de rumba, biguine et quick-step à l’Hôtel de Luxembourg. On trouve ensuite des traces de ses cours dans divers hôtels du pays et toujours à l’avenue Monterey, jusqu’en 1952.
Suivre la trajectoire de ces danseuses éclaire les dynamiques genrées de l’enseignement de la danse dans l’entre-deux guerres. Les termes par lesquels elles sont désignées révèlent des différences statutaires: l’une est une Fräulein, l’autre l’épouse puis veuve d’un maître de danse. Aucune des deux ne se déclare maîtresse de danse – une appellation qui n’émergera au Grand-Duché qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Comment ces femmes ont-elles vécu le fait d’enseigner la scandaleuse rumba et de „gigoter dans l’arène“? L’analyse de presse ne permet pas de répondre à cette question. Ce qu’elle montre, néanmoins, c’est l’ingéniosité et la résilience avec laquelle ces enseignantes s’engagent professionnellement dans la danse, déployant un art de la réclame et un sens du commerce, et mobilisant de tutelles masculines tout en s’en affranchissant.



 De Maart
De Maart






Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können