Depuis la libération, la politique intérieure luxembourgeoise était secouée par les tensions entre le gouvernement et l’Unio’n. Rassemblant les principales organisations de résistance, de la droite catholique aux communistes, auréolée du prestige de la lutte contre l’occupant, comptant près de 15.000 adhérents et disposant même d’une force paramilitaire, la Miliz, l’Unio’n avait longtemps cru qu’elle accèderait au pouvoir – ou qu’elle y serait du moins associée.
Dès son retour d’exil, fin septembre 1944, le gouvernement s’était toutefois efforcé d’affaiblir ce potentiel rival. Il avait pour cela pu compter sur une bonne partie de l’administration. Ceux des fonctionnaires qui étaient restés en poste jusqu’à la fin de l’occupation – la majorité – rejetaient la vision radicale de l’épuration prônée par l’Unio’n. Forcément elle les visait directement. L’Unio’n les percevait en effet comme des lâches et des opportunistes. Elle n’avait pas une vision plus flatteuse du gouvernement en qui elle voyait le représentant de ces partis d’avant-guerre qui avaient selon elle failli et abandonné les Luxembourgeois.
Confrontation
En octobre 1944, le gouvernement avait commencé par reprendre le contrôle des centres d’internement créés par l’Unio’n et dans lesquels celle-ci détenait plus de 3.000 personnes accusées de collaboration. Début novembre, il avait dissous la Miliz, dont une partie des hommes avait été incorporée dans la gendarmerie en tant qu’auxiliaires. Certains dirigeants de l’Unio’n avaient alors commencé à dénoncer l’action du gouvernement, mais la bataille des Ardennes avait mis fin pour un temps fin aux querelles intérieures.
Elles n’en reprirent que plus tard, avec une vigueur accrue. Le 22 février 1945, accusant le gouvernement d’avoir échoué sur la question de l’épuration, l’Unio’n fit placarder à travers le pays une affiche exigeant sa démission. Le gouvernement réagit en promettant de réunir une Assemblée consultative, où seraient représentées toutes les forces politiques du pays, et en annonçant la création d’un ministère chargé du ravitaillement et d’un autre chargé de l’épuration. L’Unio’n ne mit pas pour autant fin à sa campagne, mais cette fois-ci les journaux proches des partis au pouvoir commencèrent à se retourner contre elle. Le 9 mars 1945, le Luxemburger Wort publia ainsi une mise au point: „1. D’Regirong huet am e’schten Resistenz gemâch, we’ der nach nit vill dat verstan hun. 2. Et gët organise’ert [Resistenz], 3. et gët Resistenz am énzelnen. 4. Glëcklecherweis huet d’ganzt Land mat der organise’erter Resistenz geschafft. An et wir am beschten, de Geescht vun der gesamter Lëtzeburger Resistenz, we’ se sech zo’ London, zo’ Lëtzeburg an am Preiseland gewiesen huet, ge’w triomphe’eren an Enégkét an et ge’f ëmschloen zo’ engem Geescht vu solidarescher Rekonstruktio’n!“1
La gestation du mythe national
En plein conflit entre l’Unio’n et le gouvernement, le Luxemburger Wort posait ainsi les jalons de ce mythe national qui resterait prédominant dans le pays des années 1950 aux années 2010: le gouvernement en exil avait été le premier à résister, il l’avait fait en accord avec la résistance intérieure, cette dernière n’avait pas uniquement été portée par des organisations, mais par toute une nation unie dans la lutte contre l’occupant. L’objectif, d’ailleurs assumé, de ce récit était de préserver l’unité du pays. Il allait y parvenir en marginalisant deux groupes.
Le premier était celui des collaborateurs, qui n’y avaient pas leur place et se retrouveraient forcément réduits à une minorité de criminels, de marginaux et d’Allemands naturalisés avant la guerre. Le second était celui des résistants, désormais dépeints comme des extrémistes réclamant pour eux quelque chose qui appartenait à la nation tout entière. Dans le mythe national, la résistance n’était plus une action organisée, mais un „esprit“, une vertu collective propre à tous les Luxembourgeois.
Si le peuple tout entier avait résisté, „pourquoi un Ministre de l’Epuration?“, demanda un certain „d’Artagnan“ le lendemain dans le quotidien de l’Unio’n: „En ajoutant aux 100% de notre population entière, comme s’exprimaient si bien ces messieurs, les quelque 10 à 15% de collaborateurs et d’inciviques, nous arriverons bel et bien à une population de 110 à 115%.“2
Une accusation suggérée
Au début du mois d’avril 1945, suite au discours prononcé par le Premier ministre Pierre Dupong devant l’Assemblée consultative, l’Unio’n mit pour la première en doute un autre élément important du mythe national en gestation: „A senger déclaratio’n sét dén hèr staatsminister, d’regirong hätt an der nuecht vum 9. op den 10. Mé e gudd iwerluegten an am viraus prépare’erte plang ausgefe’ért. Op dese plang grad eso’ gudd prépare’ert wor, kënnt é bezweiwelen, wann é bedenkt, datt e minister3 – an net de schlechsten – net matt fort ko’m. Iwerlét én sech d’sâch richteg, kënnt én e’schter mengen, et wir an der Géschterstonn vum 10. Mé an den heiser, wo’ d’memberen vun der regirong gewunnt hun, e besschen hals iwer kapp gâng, an dat wir och eng explicatio’n fir dat, wat sech soss am land zo’gedroen huet. De chef vun der évacuatio’n a vum luftschutz évacue’ert sech a seng familje fir d’e’scht, verschieden députe’erter, burgerméschter a schèffen mâchen sech durch d’bascht.“4
L’auteur de cet article ne se contentait pas de réfléchir à voix haute sur ce qui s’était passé le jour de l’invasion. Avancer que le plan d’évacuation du gouvernement n’était pas abouti revenait à le rendre responsable du chaos qui était advenu, des souffrances ainsi engendrées, mais aussi de tout ce qui avait suivi. Si les Allemands avaient pu annexer si facilement le pays, n’était-ce pas parce que l’État luxembourgeois s’était écroulé en raison de l’impréparation de son gouvernement?
Une accusation explicite
Cette accusation était extrêmement grave. Tellement grave qu’elle n’était encore que suggérée. L’Unio’n n’avait pas encore besoin de faire exploser cette bombe. Elle était encore suffisamment puissante et le prouva encore le 10 mai 1945 lorsque, deux jours après la capitulation sans conditions du Reich, elle fit défiler dans les rues de Luxembourg plus de 10.000 de ses adhérents. En réalité, ce fut sa dernière démonstration de force. Le mouvement commença ensuite à décliner. Au mois de juillet, l’accusation suggérée au mois d’avril fut explicitement formulée dans les pages du journal D’Unio’n:
„Le 10 mai 1940, le Gouvernement a pris la fuite, une fuite méticuleusement préparée d’avance et dans tous ses détails […] On avait oublié cependant une chose […]: le règlement de la succession administrative du pays. Le Gouvernement en fuite n’avait conféré des pouvoirs ni donné des instructions à ceux qui, à sa place, ont dû assumer l’administration centrale.“5
Ce fut cependant la dernière fois que ce sujet fut abordé. La paix était revenue, la situation politique intérieure commençait à se normaliser. Depuis son instauration, l’Assemblée consultative était devenue la principale tribune de l’opposition au gouvernement. Au mois d’août, ce qui restait de l’Unio’n donna naissance à un parti politique classique, le Groupement Patriotique et Démocratique (GPD).
1 „Inländische Presseschau“, in: Luxemburger Wort, 9 mars 1945, p. 1.
2 „Chez Dupong… tout est bon !??“, in: D’Unio’n, 10 avril 1945.
3 Le ministre en question était Paul Margue qui, pris de cours par la rapidité de l’avance allemande, avait dû faire demi-tour le 10 mai 1940 alors qu’il tentait de rejoindre la Belgique avec sa famille.
4 „La critique est salutaire“, in: D’Unio’n, 7 avril 1945, p. 1.
5 „Une réponse et deux nouvelles questions“, in: D’Unio’n, 16 juillet 1945, p. 1.

 De Maart
De Maart



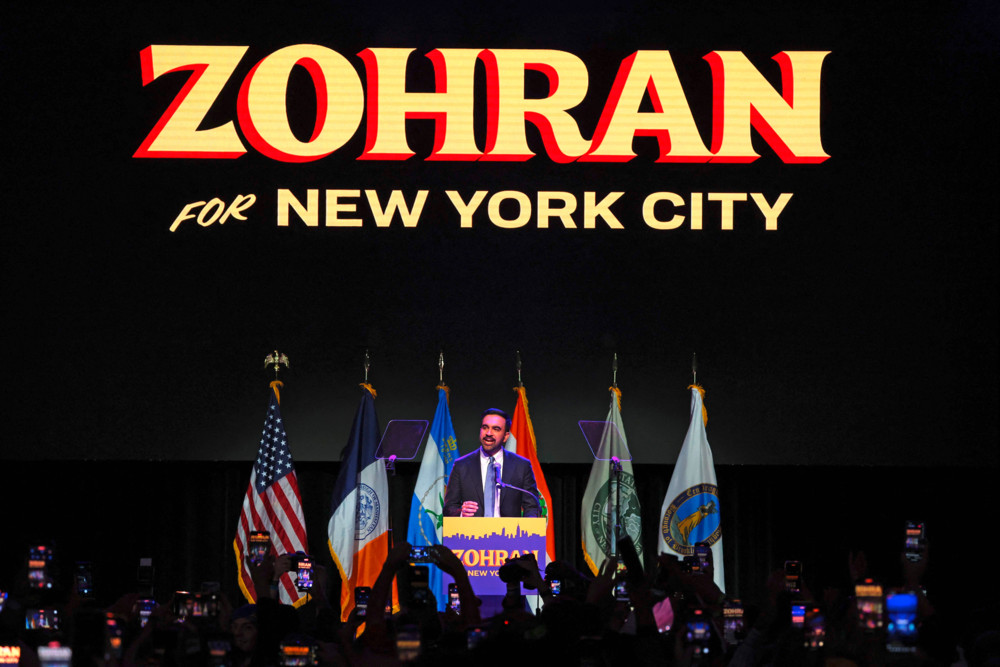



Wer übernimmt denn jetzt die Verantwortung für das von Herrn ARTUSO beschriebene bösartige, (verbrecherische?) staatliche Unrecht? MfG, Robert Hottua, Unrechtsopfer
Guten Tag Herr ARTUSO, wieviel Gefängnisse gab es denn für 3.000 gefangene vermeintliche Kollaborateure, wer hat diese Gefangenen bewacht und wo waren die Gefängnisse? MfG, Robert Hottua