Il y a quelques semaines, la Chambre des députés a adopté une motion, introduite par un ancien élève du soussigné (clin d’œil!), ayant comme sujet la défense de la démocratie. Mais attention: il ne s’agissait pas de venir au secours de la démocratie dans notre propre pays où le nombre de citoyens appelés à participer aux joutes électorales ne cesse de baisser proportionnellement, mais le souci principal de nos députés concernait la démocratie dans le reste du monde.
Loin de moi de penser que la démocratie, ses valeurs, ses fonctionnements et les droits humains fondamentaux se portent bien mondialement, bien au contraire, mais le fait de fermer les yeux, à une telle occasion, sur les (dys)fonctionnements criants de notre système démocratique chez nous laisse quand même un goût d’inachevé. Il est certes de notoriété qu’il est plus fastoche de s’occuper des grands principes chez un voisin ou dans le monde que de se regarder dans la glace pour voir ce qui se passe devant notre propre nez.
On ne peut s’empêcher de constater, par exemple, que le nombre d’électeurs, proportionnellement, ne cesse de baisser depuis des années, de sorte qu’on risque bientôt de connaître une situation qui ressemblera plus à une forme d’apartheid qu’à une forme de démocratie qui mérite encore ce nom.
Je pense d’abord au droit de vote de nos concitoyens étrangers pour les élections législatives, refusé notamment par une grande majorité de votants luxembourgeois à l’occasion du référendum constitutionnel de 2015. A noter, subsidiairement, que les raisons et les leçons de cette défaite cuisante n’ont jamais été discutées, analysées, évaluées et c’est bien dommage … On a vite tourné la page et on est passé à la suite de l’ordre du jour. Tôt ou tard, le sujet reviendra sur la table, probablement sous une autre forme, nonobstant le référendum dont le résultat n’a pas de valeur pour l’éternité.
Voilà un biais qui me permet de remettre à l’ordre du jour un deuxième sujet qui a été également recalé lors du référendum déjà évoqué. Je veux parler de l’âge minimum relatif au droit de vote. Dans mon ancienne vie de parlementaire, en 1997 (sic), j’avais élaboré une proposition de loi dans ce sens avec mon collègue de l’époque, le regretté Marc Zanussi. On pourrait pratiquer le copier-coller et reprendre sur le métier cette initiative parlementaire aujourd’hui, à quelques détails près. Avis aux amateurs!
Mais avant de proposer un cheminement pour arriver au but, il s’avère nécessaire de procéder d’abord à une analyse de la situation.
Aujourd’hui pour posséder le droit de vote actif, c’est-à-dire prendre part activement à un scrutin national ou local, on doit avoir 18 ans, et pour le droit de vote passif, c’est-à-dire pour être candidat, il faut avoir 21 ans.
Attention: prenons le cas d’un jeune qui aura ses 18 ans, le jour qui suit la date des élections, qui n’a donc pas été appelé à participer au vote. Il doit attendre cinq ans supplémentaires (pour les élections nationales), pour pouvoir aller voter pour la première fois. Il aura dès lors 23 ans le jour de sa première participation active aux élections. Pour le scrutin communal, il faudra attendre l’âge de 24 ans pour ce faire dans ces mêmes conditions.
Donc dans la pratique, pour beaucoup de jeunes, la date de leur première participation active (ou passive) peut se situer des années après l’âge limite officiel. Entretemps, beaucoup ont déjà terminé leurs études post-secondaires ou commencé une activité professionnelle ou créé même une famille.
La jeunesse: un groupe cible intéressant
Citons quelques réflexions tirées de la proposition de loi évoquée plus haut: „Pour aborder le problème d’une manière plus générale, on ne peut esquiver le débat et se poser des questions sur la jeunesse d’aujourd’hui et sur sa participation et son intégration plus poussée dans la société d’aujourd’hui. Le danger d’une exclusion, voire d’une ghettoïsation politique d’une partie de la jeunesse ne peut être ignoré, le risque d’une réelle fracture sociale existe. (…)
Pour le marché des articles de consommation, la jeunesse constitue un groupe-cible très intéressant, car elle dispose d’un certain pouvoir d’achat et leurs habitudes de consommation sont encore très fluctuantes, donc facilement influençables. Pour un certain nombre d’acteurs de la société, la jeunesse ne constitue pas seulement un groupe passif par définition ou un groupe de consommateurs qui dispose d’un certain pouvoir d’achat, mais ils désirent les voir participer plus activement à la gestion de la société. (…)
Les jeunes eux-mêmes appliquent d’autres critères. Ainsi un père de famille de 22 ans se définit-il d’une manière différente qu’un ,single‘ de 24 ans. Une jeune fille de 16 ans qui doit s’occuper de l’éducation de ses frères et sœurs parce qu’un des parents est décédé ou défaillant, possède une vue de la société différente qu’une jeune fille de 25 ans qui n’a pas encore mené une vie autonome parce qu’elle n’avait pas la possibilité de le faire ou parce qu’elle n’éprouvait pas encore la nécessité.
D’une manière générale des enquêtes effectuées dans certains pays européens ont montré que l’intérêt à la chose publique, à la gestion de la société, donc à la politique, croît quand les jeunes connaissent déjà des liens très forts avec la société tels l’entrée dans la vie active, le mariage et la décision d’avoir des enfants. Si aucun de ces trois éléments n’entre en jeu, l’intérêt pour les problèmes de la société est fort peu développé ou très limité.
Au lieu de laisser une grande partie de la jeunesse au bord de la touche en ne les considérant pas comme des citoyens à part entière, la question de trouver des voies et moyens pour faciliter leur intégration dans la société d’aujourd’hui est posée.“
Un déséquilibre qui interroge
Autre phénomène inquiétant dans ce contexte, le déséquilibre dû à la pyramide des âges de l’électorat en faveur des classes d’âge plus élevées qui trouve son explication dans le fait que les êtres humains, surtout dans nos sociétés très développées, deviennent de plus en plus âgés, ce qui a comme conséquence que le nombre et le poids des électeurs âgés ou très âgés n’a eu de cesse d’augmenter au fil du temps. Donc logiquement, les problèmes liés aux personnes âgées et leur impact politique deviennent de plus en plus importants, comparés à ceux des catégories plus jeunes, relégués au second plan.
D’autres arguments qui plaident pour …
On peut se poser la question de savoir pourquoi on refuse à une grande catégorie de jeunes le droit de vote alors qu’on leur donne la possibilité de faire le permis de conduire et de piloter une voiture ou une moto, idem le droit de se marier et/ou d’avoir des enfants, d’ouvrir un compte bancaire, de contracter un prêt bancaire, de signer des contrats, de créer une association sans but lucratif, voire même une société à responsabilité limitée ou une société anonyme, d’avoir une activité professionnelle, de voyager seul à travers le monde, d’être indépendant des parents, etc., etc.
Pourquoi ce manque de confiance vis-à-vis des jeunes, cette attitude recroquevillée sur des valeurs et réglementations anciennes dépassées par l’évolution de la société? Pourquoi vouloir refuser un droit démocratique élémentaire à d’autres, pourtant déjà adultes pour la plupart et pleinement engagés dans la société?
Rétropédalage ou comment manger son chapeau?

Le gouvernement actuel n’a aucune volonté politique ou intérêt quelconque d’aborder le sujet d’un perfectionnement de la démocratie ou d’un élargissement du corps électoral. De toute façon il est rébarbatif à toute forme de changement, sauf s’il s’agit de détricoter notre législation sociale. Au Luxembourg, la majeure partie des électeurs sont des concitoyens âgés, donc potentiellement plutôt conservateurs, rétifs à toute forme de changement, préférant camper sur des positions anciennes et bien connues, ayant peur de lendemains qui ne chanteront peut-être pas. Il y a quelques années, un ancien jeune, d’un des partis gouvernementaux, devenu entretemps député, s’était emparé du sujet de l’abaissement de l’âge minimum relatif au droit de vote et l’a articulé politiquement. Or, il a fallu déchanter rapidement. Son courage politique était inversement proportionnel à son ambition politique. Très vite, pour ne froisser personne, il a renié ses anciennes positions lorsqu’il s’est agi de devenir député et secrétaire général du parti. Dorénavant, il fallait hurler avec les loups pour avancer …
Avoir des positions politiques pointues ou faire carrière, il faut choisir des fois!
Dommage …

 De Maart
De Maart
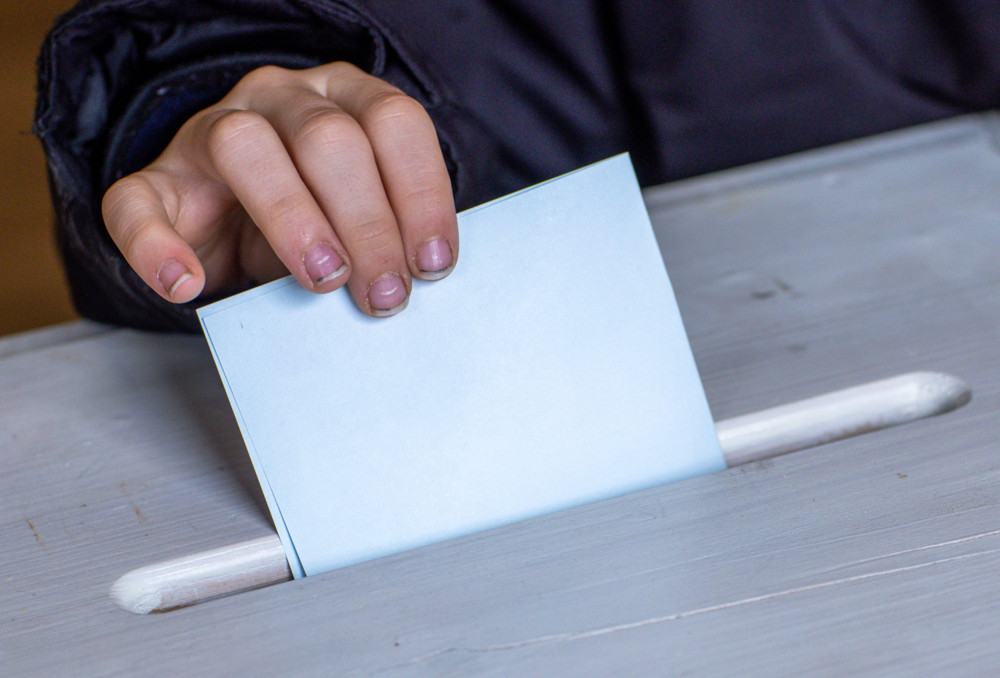


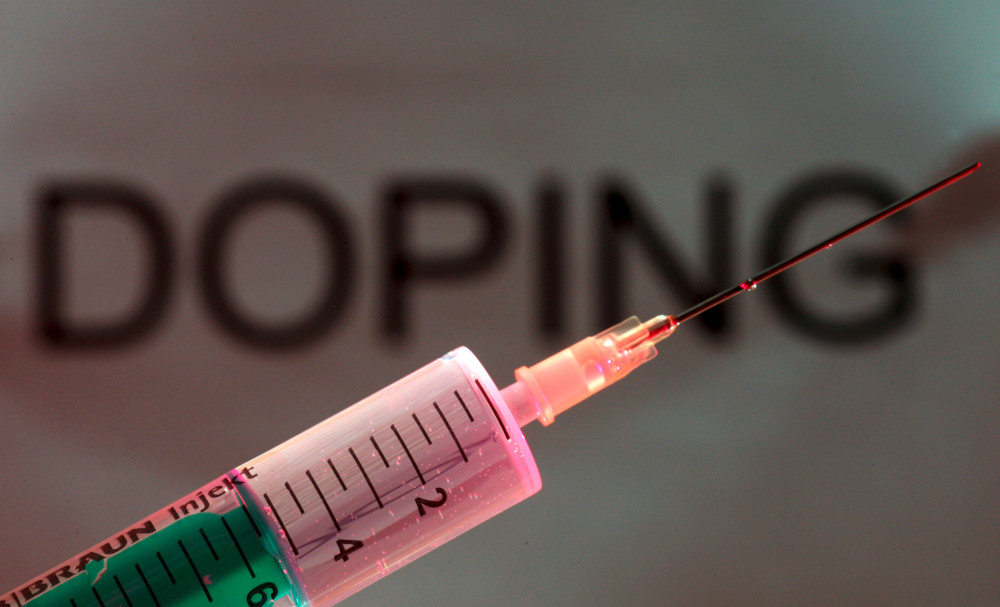



Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können