Début 1944, les Allemands étaient sur la défensive sur l’ensemble des fronts, mais ne se déclaraient nullement vaincus. Dans le sud de l’Italie, ils avaient arrêté l’avancée du corps expéditionnaire allié, notamment à la hauteur de l’antique monastère de Monte Cassino où des combats particulièrement féroces faisaient rage. A l’Est, ils avaient dû lever le siège de Léningrad, mais reculaient en bon ordre.
Le Reich tenait toutefois en puisant dans ses dernières réserves. Pour compenser ses pertes militaires, il en était réduit à envoyer au front des réservistes, généralement âgés et peu aguerris, qui jusque-là n’avaient eu à assumer que des tâches de maintien de l’ordre dans les territoires occupés. Il était aussi obligé de mobiliser des hommes qui étaient pourtant indispensables pour assurer la production d’armes.
La main-d’œuvre servile soviétique
Ce manque d’hommes se fit notamment ressentir au Luxembourg, où les autorités allemandes confièrent des responsabilités croissantes aux pro-allemands les plus convaincus, y compris dans les tâches de répression. Cela était d’autant plus nécessaire que les „catégories à risque“ étaient désormais plus nombreuses.
Pour continuer à faire tourner l’économie luxembourgeoise, et en tout premier lieu garantir la production d’acier, stratégique pour l’effort de guerre allemand, les autorités allemandes avaient recours au travail servile. Des centaines de prisonniers de guerre soviétiques et d’„Ostarbeiterinnen“ – de très jeunes femmes originaires d’URSS – furent contraints de travailler dans les mines et les aciéries.
Le régime nazi se méfiait de ces forçats qu’elle percevait comme des „sous-hommes“ en raison du danger „d’infection raciale“ qu’ils faisaient peser sur les „Volksdeutsche“ luxembourgeois, mais aussi du risque de les voir s’échapper et marauder dans les campagnes.
Réfractaires et déserteurs
Une autre catégorie à risque était celle des réfractaires à l’enrôlement forcé, dont le nombre avait explosé depuis le printemps précédent. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas refusé d’emblée de porter l’uniforme allemande ni plongé immédiatement dans la clandestinité, mais profité d’une permission pour déserter. Ceux-là avaient reçu une instruction militaire, certains avaient même l’expérience des combats. En décidant de déserter, ils emportaient avec eux leurs armes de service. Un épisode indique que cela était plutôt la règle que l’exception.
En août 1944, deux Luxembourgeois pro-allemands âgés de 22 ans, Jean G. et Nicolas S., tentèrent d’infiltrer un réseau d’aide aux déserteurs pour le compte de la police allemande. Leur contact à l’intérieur du réseau, Pierre P., commença à nourrir des doutes à leur sujet au cours d’une de leurs conversations. Pour s’assurer qu’ils étaient bien ceux qu’ils prétendaient être, il ne vit pas de moyen plus évident que de leur demander „où ils avaient laissé leurs armes“ (wo sie ihre Waffen gelassen hatten)?1)
La prise en charge de milliers de réfractaires et déserteurs, pour certains armés et aguerris, apporta à la résistance luxembourgeoise une dimension militaire qu’elle n’avait pas eu. Cette militarisation de la résistance alla cependant de pair avec celle de la collaboration.
Une organisation paramilitaire pour les nazis luxembourgeois
Le Politische Leiterstaffel fut créé en février 1944. C’est du moins de cette période que datent les premières adhésions connues2). Seuls des individus que les autorités allemandes considéraient comme absolument fiables pouvaient adhérer à cet „escadron des cadres politiques“. En pratique il s’agissait du dernier carré de pro-allemands qui, ayant exercé une fonction d’encadrement au sein de l’une des organisations du régime national-socialiste, avaient permis à ce dernier de tenir la population jusque-là3).
Les hommes du Politische Leiterstaffel se voyaient remettre une carte de membre sur laquelle il leur était rappelé qu’ils devaient une obéissance absolue aux Kreisleiter, les dirigeants de l’administration nazie au niveau régional. Instruits au maniement des armes, ils étaient équipés comme des soldats de la Wehrmacht, portant notamment fusils et casques de fer.
Dans le Kreis de Diekirch ils étaient environ 704. Une estimation prudente pour les quatre Kreis du Luxembourg donnerait donc un effectif de 300 membres, mais le véritable chiffre était probablement plus élevé puisque le Kreis de Diekirch était l’un des moins peuplés et celui où la proportion de pro-allemands était la plus faible.
Les missions du Politische Leiterstaffel
Le Politische Leiterstaffel avait pour mission d’épauler l’administration civile et la police allemandes dans le maintien de l’ordre. Ses membres prenaient notamment part à de véritables battues organisées pour rattraper des fugitifs. L’une de celles-ci eut lieu en août 1944 dans la forêt de Bous. Deux prisonniers de guerre soviétiques furent abattus à cette occasion5). De telles opérations visaient aussi les repaires de déserteurs et de réfractaires. Certaines dégénérèrent en véritables batailles rangées.
Au printemps 1944, des soldats allemands positionnés dans des fortins de la ligne Siegfried dominant la vallée de l’Our, dans les Ardennes, remarquèrent que de la fumée s’échappait au-dessus des sapins de la forêt de Heinerscheid, du côté luxembourgeois. Le 23 avril 1944, le bourgmestre pro-allemand Wolter, accompagné de son fils et de quelques gendarmes allemands, partit reconnaître les lieux. Une fois sur place, il aperçut des déserteurs et ouvrit le feu. Ceux-ci ripostèrent.
Dans la nuit du 24 au 25 avril, un contingent de la gendarmerie allemande et du Politische Leiterstaffel ferma tous les accès à la forêt. L’assaut, donné vers 11.00 h, fut repoussé. Un Luxembourgeois du nom de Weber trouva la mort, d’autres assaillants furent blessés. Des renforts arrivèrent quelques heures plus tard. Vers 14.30 h les positions des réfractaires furent détruites à l’explosif. Les cinq combattants trouvèrent la mort6).
Une minorité acculée
La nature de la résistance luxembourgeoise fut transformée par l’arrivée des déserteurs. Le Luxembourg d’avant-guerre était un pays neutre où la conscription n’existait pas. Faute d’expérience militaire, la résistance s’était concentrée sur des tâches de contre-propagande, de renseignement et d’aide aux victimes du régime. Désormais, elle pouvait compter sur des milliers d’hommes armés, disséminés à travers le pays.
Il serait abusif d’affirmer qu’en 1944 la résistance luxembourgeoise se mua en résistance armée. Les dirigeants des mouvements firent leur possible pour l’empêcher, jugeant qu’il était irresponsable de passer à un stade de violence supérieure, au risque de représailles sanglantes, alors que la défaite de l’Allemagne ne faisait plus grand doute. Simplement la possibilité de recourir aux armes n’était plus chose impossible.
Les Allemands en étaient conscients et leurs auxiliaires luxembourgeois plus encore. Ils étaient désormais armés parce que leurs adversaires l’étaient aussi. Ces armes que les Allemands leur avaient confiées allaient leur servir à défendre leur vie. Le Politische Leiterstaffel n’était pas qu’une unité supplétive, mais la milice d’autodéfense d’une minorité acculée.
1) Archives nationales de Luxembourg (ANLux), Fonds Epuration (EPU) 367, chefs d’accusation et jugement à l’encontre de Johann G./Nikolaus S./Katharina G.
2) Voir notamment: ANLux EPU 367, chefs d’accusation et jugement à l’encontre de Johann G./Nikolaus S./Katharina G.; ANLux, Fonds Affaires politiques (AP) A13 (Luxbg.), dossier Angelo A.
3) Le dossier ANLux EPU 383 contient un exemple de questionnaire que devaient remplir les aspirants ainsi que le texte du serment qu’ils devaient prononcer.
4) ANLux AP E20 (Diekirch II), témoignage d’Elsy S. recueilli le 22 mai 1945 par la police de Diekirch.
5) ANLux AP D33 (Diekirch II), dossier Peter Bernhard D.; ANL EPU 369, chefs d’accusation et jugement à l’encontre d’Anton-Isidor K.; ANL EPU 372, chefs d’accusation et jugement à l’encontre de Joseph M.
6) ANLux, Fonds Documentation historique Deuxième Guerre mondiale (DHIIGM) 64, Questionnaire et réponses sur les bunkers au Luxembourg/témoignages divers sur les bunkers (Hondsbësch, etc.).

 De Maart
De Maart


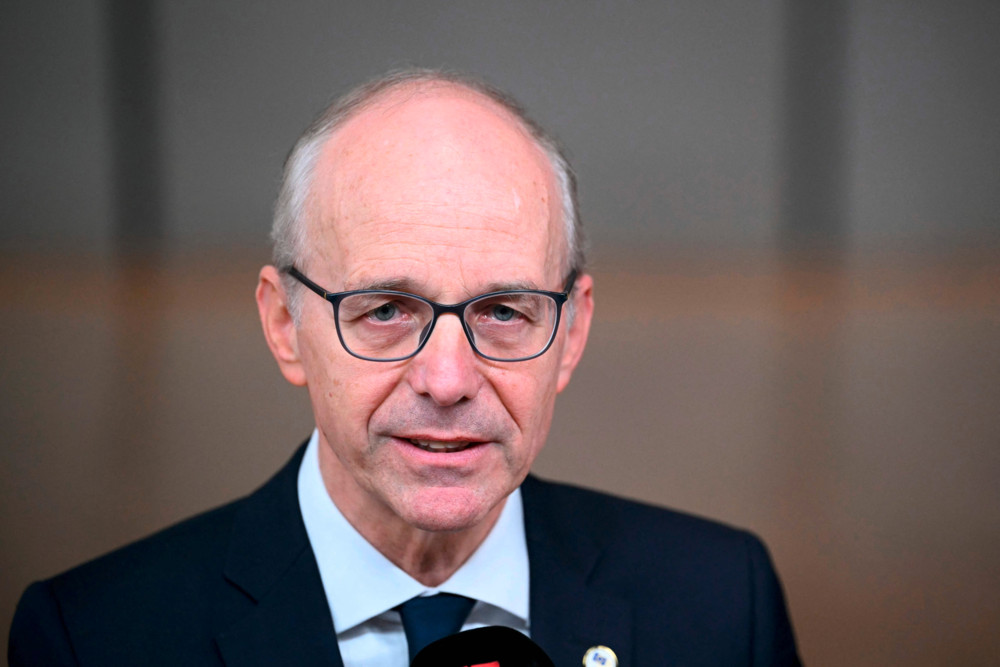

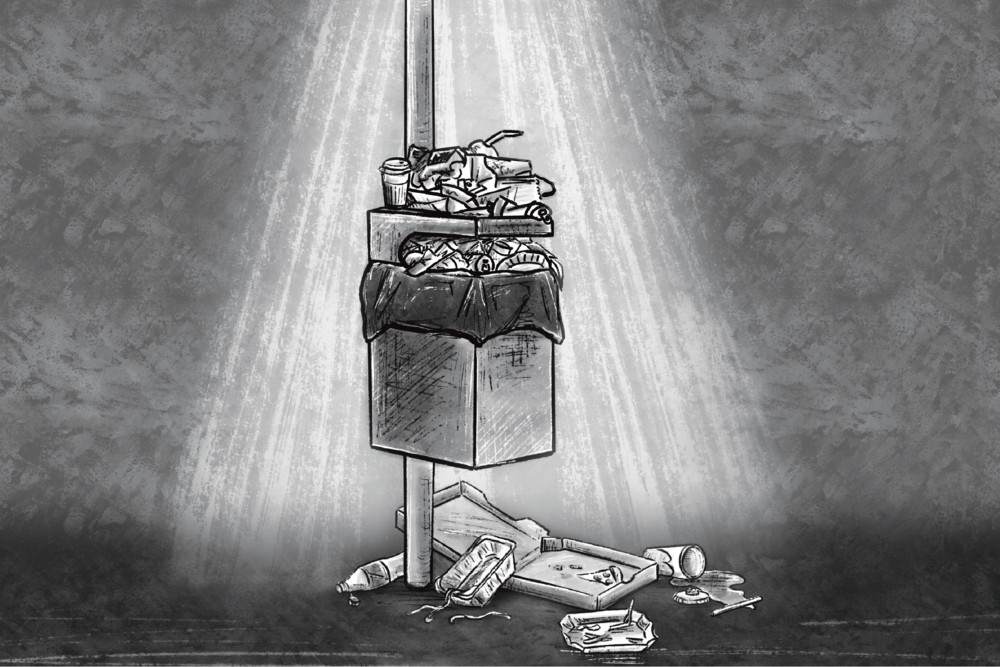


Ist es richtig, die Vorgeschichte der "Politischen Leiterstaffel" im Norden Luxemburgs mit diesem Text zu beschreiben?
▪ Weihnachtsabende und Gautage. (Emile KRIER, Volkstumspolitik in Luxemburg von 1933 bis 1940, Seite 87f) (…) Am 9.1.1933 sollte die Führerbesprechung der NSDAP in der Gesandtschaft stattfinden. An dieser Versammlung wird wahrscheinlich auch der Auslandskommissar der NSDAP für die Niederlande, Major A.R. WITTE, dessen Kompetenzen auch auf Luxemburg ausgedehnt wurden, teilgenommen haben, da er an dem Tage in Luxemburg weilte. In der 1. Hälfte des Monats Januar weilte Major WITTE einige Tage in Luxemburg und traf dort u.a. mit dem abgesetzten Landesgruppenleiter HILDEBRAND und Staatsminister BECH zusammen. In beiden Gesprächen bildete die Ausweisung HILDEBRANDs aus dem Großherzogtum ein zentrales Gesprächsthema. Während seines Aufenthaltes war WITTE Gast des deutschen Gesandten mit dem er auch Deutschtumsfragen erörterte. Der Gesandte stand ihm, wie er später schrieb, "mit wertvollen, unentbehrlichen Ratschlägen zur Seite", was ihm die Inangriffnahme seiner Arbeit in Luxemburg sehr erleichterte. Diese Gespräche hatten bei WITTE, wie er in einem Dankschreiben an den Gesandten am 12. 1. 1934 schrieb, den Eindruck hinterlassen, daß "jetzt die Hoffnung auf eine ruhige Entwicklung der Landesgruppe Luxemburg und des Deutschtums im Geist Adolf Hitler's besteht. In Luxemburg ging die Entwicklung der NSDAP nicht so "ruhig" weiter, wie WITTE erwartete. Bis in die luxemburgische Presse waren Gerüchte über die Schwierigkeiten - einen "ungeheuren Krach" unter den Nazis, wie das 'Escher Tageblatt' schrieb - durchgesickert. Dieselbe Presse berichtete über die Aktivitäten der NSDAP in Ettelbrück, wo ein von ungefähr 400 Personen besuchter Weihnachtsabend stattgefunden hatte, und in der Woche vom 7. bis zum 13. Januar 1934 die Deutschen sich zu einem "Gautag" trafen. Das wichtigste Zentrum der NSDAP und der "Deutschen Kolonie" im Norden Luxemburgs befand sich in Diekirch. Hier hatten die Reichsdeutschen ebenfalls 1933 zu Weihnachten einen Weihnachtsabend und zu Fastnacht einen Ballabend organisiert. An diesen zwei Veranstaltungen durften nur Reichsdeutsche nebst Familie teilnehmen. In Diekirch trafen sich jeden Samstag zwischen 50 und 70 Nationalsozialisten aus Diekirch und Umgebung zu geschlossenen Versammlungen, zu denen Luxemburgern der Einlaß verweigert wurde. Für die Luxemburger gedacht, fand am 14.1.1934 im Volkshaus in Luxemburg ein Vortrag von Prof. KÜHNEMANN über "Deutschlands Weg und Schicksal im Lauf der Geschichte" statt, in dem dieser in einem geschichtlichen Überblick aufzuzeigen versuchte, "wie Deutschland von Urzeiten her schon diesen Rassestaat (des Nationalsozialismus) wollte." Der Vortrag stieß aber bei den meisten Luxemburgern auf Ablehnung. (…)
MfG
Robert Hottua