„Samedi dernier, j’ai interrogé, dans mon bureau, le nommé Schartz René, actuellement Diderich René, né à Wasserbillig le 21 mars 1923. Quoique l’intéressé n’ait fréquenté d’autres écoles que deux années d’école primaire supérieure, il est très intelligent et bon observateur.“
Visiblement, Bodson ressentait le besoin de légitimer sa source auprès de ses collègues – peut-être aussi de se rassurer lui-même. Le fait qu’il en était réduit à espérer quelque lumière sur la situation au Luxembourg d’un jeune enrôlé de force de 21 ans en disait long sur sa déconnexion et celles des autres ministres avec le pays occupé.
Un gouvernement déconnecté
Au moment où le gouvernement en exil découvrait le Rapport Schartz1), les Alliés venaient de débarquer en Normandie. Même si à ce moment rien n’était encore écrit, il devait se préparer à un éventuel retour et, avant toute chose, se faire une idée du pays qu’il allait retrouver. Les informations de Schartz étaient donc précieuses. Bodson espérait peut-être qu’à l’avenir elles soient complétées ou corrigées grâce aux témoignages d’autres enrôlés de force capturés par les Alliés:
„Les renseignements reproduits donnent une image de la vie, telle qu’elle a pu être observée dans une petite localité luxembourgeoise; en outre, je tiens à remarquer que les informations s’arrêtent seulement en 1943 et possèdent pour nous toujours un caractère d’actualité. […] Je suis d’avis que des interrogatoires pareils contribuent à augmenter notre information et à nous rendre à même de prendre les mesures indispensables à la reconstruction du pays.“
La situation politique selon Schartz
A Schartz, qui avait quitté Wasserbillig en mai 1943, Bodson posa prioritairement des questions d’ordre économique et politique. Au sujet de l’attitude du conseil municipal et des fonctionnaires de la commune de Wasserbillig le jeune homme lui avait notamment fait cette réponse:
„Quoique toutes ces personnes adhèrent de force à la VdB pour pouvoir continuer à exister, on peut dire que leur attitude en général ne laisse pas à désirer et qu’ils sont de bons Luxembourgeois.“
Au niveau national, toute l’administration luxembourgeoise avait été liquidée, même si l’ancien personnel était majoritairement resté en poste. Du point de vue politique, les conditions étaient „très dures“. Quiconque voulait travailler devait adhérer à la VdB, ou à l’une des nombreuses „Gliederungen“ – c’est-à-dire les organisations annexes du parti nazi.
Schartz indiqua cependant aussi que les Allemands „n’étaient pas vindicatifs“, citant l’exemple d’un certain M. Atten, marchand de vélos de 50 ans, qui le jour de l’invasion avait tiré sur les Allemands. Ces derniers l’avaient brièvement emprisonné, puis relâché. Tout ce qu’ils exigeaient, c’était que les Luxembourgeois acceptent le fait accompli et ne s’opposent pas à l’„Aufbauwerk“ du régime nazi dans leur pays.
Collabos sans être traîtres?
D’après Schartz, la majorité des habitants de Wasserbillig était „bien-entendu“ germanophobe. Les traîtres étaient rares et l’adhésion à une organisation nazie autre que la SS pas forcément un geste d’adhésion à la politique de l’occupant. Les gens faisaient par exemple la distinction entre „De’ letzeburger SA“ et „De’ preisesch SA“. L’un des sous-chefs de la SA luxembourgeoise, un aubergiste, avait mis une salle de son établissement à la disposition de ses hommes ainsi que de sa clientèle, pour leur permettre d’écouter régulièrement les émissions de la BBC.
La dénonciation existait, mais elle était surtout le fait „d’Allemands établis au Grand-Duché avant l’invasion et de certains garçons très jeunes, condamnés par l’adhésion forcée à la HJ.“ Schartz nomma aussi trois enrôlés volontaires. L’un était selon lui „un gangster, de mère allemande“; le deuxième „un voleur avec plusieurs condamnations, apatride, mais considéré comme Luxembourgeois selon la conception des Allemands“; le dernier „un buveur, originaire de Wasserbillig, mais ayant travaillé dans une brasserie à Bascharage“.
Les Allemands recrutaient aussi pour la police, après avoir démis ou déplacé en Allemagne les anciens gendarmes et policiers luxembourgeois. Il était ici probablement question de la Hilfspolizei, une police auxiliaire constituée par le régime nazi dans le Luxembourg occupé.
Une forte hausse des salaires
Schartz fut ensuite longuement interrogé par Bodson sur l’état d’approvisionnement de la population et sur son pouvoir d’achat. Le jeune homme se basa sur un exemple qu’il connaissait bien, celui de l’usine Cerabati, l’un des gros employeurs de sa ville d’origine:
„Quoique les prix de gros de Cerabati par exemple n’aient été augmentés que de peu, les salaires ont suivi une courbe ascendante verticale. L’ouvrier le moins payé de Cerabati, un homme ne sachant se servir que d’un bras, célibataire, occupé à balayer l’usine, gagne 138 RM (NdA: reichsmarks – l’équivalent de 32 € de 20222)) net après déduction de toutes les charges et impôts. […]. Les autres salaires sont en conséquence: le salaire le plus bas payé par Cerabati à un ouvrier travaillant 3 heures par jour et étant célibataire est de 180 RM (NdA: 41,8 €) net par mois. Beaucoup, et surtout les mariés, atteignent la somme de 230 RM (NdA: 53,48 €) par mois et souvent plus. Inutile de dire que les salaires des employés et fonctionnaires des administrations sont plus élevés encore.“
Les prix avaient doublé depuis l’avant-guerre. Au moment du départ de Schartz, le beurre coûtait 1,80 RM (0,41 €) la livre, la viande 0,90 RM (0,2 €) par livre en moyenne. Cela dit, la carte de ravitaillement, établie pour 4 semaines et donnant accès à toutes les denrées essentielles rationnées, consommait au grand maximum 15 RM (3,48 €).
Les portefeuilles sont bien garnis et personne ne manque d’argent
Les salaires étaient bons – et le chômage était tombé au plus bas à cette période de l’occupation –, les prix raisonnables – mais il n’y avait pas grand-chose à acheter, la production étant orientée en priorité vers les besoins de l’armée allemande – donc la population avait tendance à thésauriser ou à investir dans le foncier:
„Les gens possèdent des quantités considérables d’argent. […] Tout le monde garde l’argent en poche. Les portefeuilles sont bien garnis et personne ne manque d’argent. Tout le monde cherche par contre à acheter. Ainsi les dettes n’existent plus, tout ce qui est achetable est acheté. […] Le père Schartz a acheté deux vergers dont l’un appartient à un Allemand […]. Les Allemands de la frontière vendent leurs terrains en territoire luxembourgeois et les Luxembourgeois les achètent. En outre, le père Schartz a fait remettre à neuf ses installations et sa maison pour une somme de 500 RM et il a acheté des objets pour environ 1 500 RM. Son numéraire n’étant pas épuisé, il continue d’acheter, et surtout il achète des denrées au marché noir.“
A en croire Schartz, même les adolescents avaient désormais les poches pleines argent. Au lieu de jouer aux quilles pour 15 sous, comme avant la guerre, ils misaient 1,5 RM en début de partie pour finir à 5 RM et plus. En plus des reichsmarks, beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart, possédaient des devises luxembourgeoises qu’ils avaient soigneusement mises de côté. L’oncle de Schartz avait par exemple caché 7.000 francs.
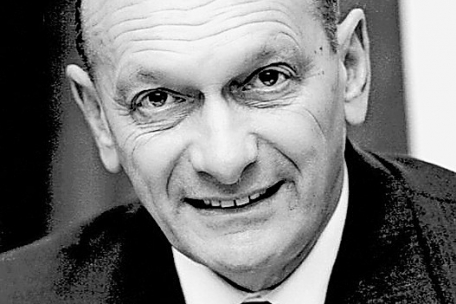
Photo: archives Editpress
L’ambiguïté l’emporte
Dans ce portrait de la société luxembourgeoise en mai 1943, tracé par un jeune enrôlé de force capturé plusieurs mois plus tard par les Alliés, le clair-obscur dominait. Il n’y avait quasiment aucun traître au Luxembourg – ceux qui tombaient dans cette catégorie étaient des Allemands, des criminels et des marginaux –, pourtant, bon gré mal gré, les fonctionnaires étaient restés en poste et les entreprises tournaient. Les SA écoutaient la BBC, mais n’en portaient pas moins l’uniforme de l’occupant.
L’ambiguïté l’emportait, jusque dans la réalité économique et sociale. Les produits de consommation manquaient dans les commerces, les denrées alimentaires étaient rationnées, les prix avaient fortement augmenté – mais en fin de compte moins vite que les salaires. Le numéraire était abondant et avait permis à beaucoup de se désendetter et même d’étendre leur patrimoine. Artificiellement parée des atours de la Volksgemeinschaft, la société d’après-guerre était déjà reconnaissable.
1) Archives nationales de Luxembourg (ANLux), Fonds Affaires étrangères (AE) Gouvernement en exil (Gt Ex) 323, Rapport Schartz, pièces 0004-0009
2) Ce calcul est basé sur les taux de change historiques des devises allemandes, de 1810 à 2022, fournis sur le site de la Bundesbank: https://www.bundesbank.de/resource/blob/615162/5a2ab631c106f9a6438899323321ec31/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waehrungen-data.pdf (dernière consultation: 18.5.23)

 De Maart
De Maart







Guten Tag Herr Artuso,
die von der Realität abgekoppelte luxemburgische Regierung im Exil hat laut dem lux. Historiker Emile KRIER eine Vorgeschichte:
"Die deutsche Kultur- und Volkstumspolitik in Luxemburg von 1933-1940 zeigte eindeutig imperialistische Züge und schreckte vor der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Luxemburgs nicht zurück. Neu waren die Methoden und die Intensität der deutschen Bemühungen; in den 20ger Jahren hatte die Gesandtschaft nur zaghaft versucht die Deutschen in Luxemburg zu organisieren und die Luxemburger zu beeinflussen. Sie trugen dazu bei, in Luxemburg Freunde für Deutschland zu gewinnen, deren Dienste dem Dritten Reich insbesondere nach der Besetzung des Landes zugute kamen. Die deutsche Kultur- und Volkstumspolitik offenbarte auch die Führungsschwäche und außenpolitische Konzeptlosigkeit der Luxemburger Regierung, die es nicht verstand, der versuchten Beeinflussung des Großherzogtums durch das Dritte Reich entschieden entgegenzutreten, sondern sich, pointiert ausgedrückt, von Deutschland vorschreiben ließ, wie sie die souveränen Rechte des Großherzogtums wahrzunehmen habe."
(Emile KRIER, Deutsche Kultur- und Volkstumspolitik von 1933-1940 in Luxemburg, 1978, Seite 611)
MfG
Robert Hottua