Le „Sonic Visions“, dont nous avions décortiqué la programmation musicale et analysé le nouveau site ce lundi, n’est pas simplement un énième festival de musique comme il y en a plein au Luxembourg. Sous la pointe de cet iceberg sonore, en pleine journée, se déroulent chaque année des conférences sur divers aspects de la scène musicale locale ou internationale. Les questions soulevées lors des conférences auxquelles nous avons pu assister(1) ont tous eu comme préoccupations centrales l’avenir de l’industrie musicale et les changements massifs, irrémédiables et inaltérables de la révolution digitale, dont la rapidité semble avoir à la fois de quoi s’inquiéter et de quoi se réjouir. Les modifications suscitées par la révolution technologique qu’est Internet sont à inscrire dans trois domaines bien précis: l’évolution du journalisme, la création artistique et les modèles économiques.
Quel futur pour le journalisme de musique?
Le temps des magazines institutionnels tels Q, Uncut ou Mojo en Angleterre, le Musikexpress, la Visions ou la Spex en Allemagne ou encore les Inrocks ou autres Rock & Folk (classique, mais un peu suranné) en France n’est certes pas révolu (tous les journaux évoqués lors de la conférence „What’s the Story” existent encore) mais leur rôle a changé. L’imprimé n’a plus le primat, car il est lent et a le désavantage de ne pas pouvoir proposer d’hyperliens.
![]() Comme l’indique Vic Galloway (qui fait un travail précieux pour la BBC), ces magazines ne sont plus les régulateurs des hypes, qui se créent désormais sur des sites comme Pitchfork, Drowned in Sound, Stereogum ou encore DIY(2). Fini donc le temps où un hebdomadaire comme le NME propulsait à lui seul un groupe comme les Arctic Monkeys.
Comme l’indique Vic Galloway (qui fait un travail précieux pour la BBC), ces magazines ne sont plus les régulateurs des hypes, qui se créent désormais sur des sites comme Pitchfork, Drowned in Sound, Stereogum ou encore DIY(2). Fini donc le temps où un hebdomadaire comme le NME propulsait à lui seul un groupe comme les Arctic Monkeys.
Daniel Koch, rédacteur en chef du magazine Intro, affirme que les vieux formats en Allemagne vont plutôt bien – pour preuve, les vieux mastodontes ont survécu au passage à l’ère digitale, même s’il admet qu’il a fallu (et qu’il faut toujours) batailler ferme – et que ses textes les plus lus sont ceux qu’il écrit pour Apple Music (voilà, les petits descriptifs qu’Apple nous propose quand on s’apprête à télécharger ou streamer les compositions d’un artiste, c’est à des journalistes qu’ils les commandent). On est loin, s’accordent Galloway et Koch, de l’âge d’or du journalisme de musique, quand des rumeurs de fêtes encocaïnées faisaient la ronde.
Pour Galloway, il y a quelque chose de très frustrant à ce que la chasse gardée des découvertes musicales soit désormais souvent réservée à de jeunes hipsters qui détiennent un blog et qui créent la sensation alors que le savoir analytique et comme encyclopédique de certains critiques musicaux est en quelque sorte mis entre parenthèses. Selon lui, cela pourrait être en partie le résultat d’hommes politiques comme Trump, qui ont disséminé l’idée qu’il ne faut plus faire confiance en les experts.
Daniel Koch pense qu’il faut quelque peu relativiser de tels propos: un jour, la Spex réimprima son premier numéro et il fut déçu de voir à quel point c’était mal fait. Aujourd’hui, dit Koch, les premiers pas de jeunes critiques – qui mèneront, peut-être, ultérieurement, à la professionnalisation – sont tout simplement plus visibles, ce qui amène ceux qui sont rodés par le système „à l’ancienne“ à les juger plus sévèrement.
Peter „Withoutfield“ Ohnacker du blog „Blogrebellen“ considère quant à lui qu’il faut parfois laisser la musique parler pour elle – dans ce cas-là, deux phrases suffisent. On a là évidemment deux méthodologies qui s’affrontent: si Internet propose aux gens d’écouter immédiatement ce qu’on leur recommande, le travail précieux des critiques passionnés restera, espérons-le, quelque chose de précieux à cause de leur pouvoir à évoquer la musique par des mots, à donner envie d’écouter quelque chose en séduisant par la parole, à faire preuve de pirouettes de références que les machines ne sauront imiter.
Autre défi de la modernité pour les musiciens: les relations avec la presse deviennent de plus en plus difficiles puisque les radios et journaux, confrontés à un monde musical sursaturé depuis la démocratisation des moyens de production et d’enregistrement, peuvent vite passer à côté d’eux. Katharina Lange, qui travaille pour „Alternative Distribution Alliance“, le véritable défi, pour rendre attentif un journaliste au travail d’un musicien qu’il ne connaît pas, consiste à se démarquer. A l’âge des mails, il est devenu difficile de percer puisque la plupart des journalistes ou bloggeurs connaissent un raz-de-marée de courriels qui leur parviennent chaque jour, de sorte à ce qu’ils n’ont même plus le temps ne serait-ce que de les parcourir(3).
Dans ce contexte, Yves Stephany, qui travaille pour la radio 100,7, dit rencontrer moins de difficultés à entrer en contact avec les petits labels – ce sont plutôt les gros labels qui passeraient outre la 100,7, estimant que le Luxembourg est un marché trop petit pour qu’il vaille la peine qu’on s’y intéresse(4).
Vic Galloway estime qu’il est important d’avoir, de nos jours, un manager PR, mais qu’il faut se méfier de ceux qui, par exemple, prennent 5.000 euros à un artiste pour faire ensuite un travail bâclé. „S’il vous prennent 5.000 euros pour qu’à la fin, vous êtes joués trois fois à la radio et que vous avez une petite recension dans un magazine, eh bien, vous vous êtes fait escroquer. Tout ça, vous auriez pu le faire vous-mêmes. Et ça ne vous aurait pas coûté un rond. Car le tout, de nos jours, est de connaître les journalistes. Nous journalistes, nous ne pouvons plus tout écouter. Du coup, on a certains „radio pluggers“, dont c’est le job de promouvoir des artistes à la radio, à qui on fait confiance.
Quel futur pour les machines parmi les hommes (et vice versa)?
![]() Il y a un peu plus d’un an, le groupe anglais 65daysofstatic sortit „No Man’s Sky“, une B.O. infinie pour un jeu vidéo infini. Conséquence: le groupe lui-même ne réussira jamais à entendre toutes les possibilités combinatoires de mise en œuvre des séquences musicales qu’il a composées.
Il y a un peu plus d’un an, le groupe anglais 65daysofstatic sortit „No Man’s Sky“, une B.O. infinie pour un jeu vidéo infini. Conséquence: le groupe lui-même ne réussira jamais à entendre toutes les possibilités combinatoires de mise en œuvre des séquences musicales qu’il a composées.
Cette question de la musique procédurale n’était qu’un des volets évoqués lors de la conférence intitulée „Artists in 2020: A Scenario“, qui s’occupait des défis futurs que les musiciens auront à affronter. Les possibilités nombreuses que les ordinateurs nous proposent ont de quoi effrayer, mais l’ensemble des intervenants a affirmé que l’ordinateur ne saura jamais être qu’un outil – on est loin de l’imaginaire de la science-fiction où la machine prend son emprise sur l’homme même si, évidemment, notre dépendance aux outils technologiques est devenue une sorte de truisme de l’ère numérique.
Ainsi, Pierre Barreau, qui a co-fondé la startup AIVA(5), estime que l’avantage de tels processus compositionnels, c’est que la machine peut garantir une plus grande variabilité. Pour la bande sonore d’un film, on a des thèmes qui reviennent au cours des deux heures que dure le film, explique-t-il. Pour un jeu vidéo qui peut garantir une durée de jeu bien supérieure, le recours à une intelligence artificielle pourrait éviter que la musique accompagnatrice ne se limite à des boucles sonores toujours identiques. En fin de compte pourtant, c’est l’être humain qui gardera la mainmise.
Autre point où les machines seraient en train de constituer un danger pour l’homme: les recommandations générées selon les écoutes personnelles, qui pourraient, si elles fonctionnaient de manière efficace, mettre au chômage pas mal de gens dont le métier consiste à vous conseiller de la bonne musique.
Vic Galloway est d’accord avec Yves Stéphany, qui dit ne jamais rien découvrir d’intéressant sur Spotify. „Je pense que les algorithmes ne me comprennent pas. La machine me dit que, parce que j’aime tel ou tel artiste, il se pourrait que j’aime aussi tel ou tel autre musicien. Eh bien, il s’avère que non.“ Benji Rogers, initiateur du projet „Dot Blockchain Music“, se rappelle une entreprise appelée „The Yams“, qui avait fait l’expérience de proposer des playlists – là encore, on a de nouvelles machines à buzz qui dépassent potentiellement le travail des journalistes – en leur soumettant par chat des titres qu’on aimait. La playlist qui en résultait s’appuyait sur une présélection faite par des machines (Benji Rogers aime x, donc il se pourrait qu’il apprécie aussi la sélection n des artistes et chansons suivantes), présélection filtrée ensuite par un curateur humain.
„Quand, dans la playlist, il y a un choix étrange, l’on se dit que la machine a foiré. Mais quand on sait qu’un humain a fait le choix, l’on s’interroge sur les raisons du choix avant de le condamner. Je me rappelle qu’il y avait une incongruité dans le choix de mon curateur, que j’ai alors interrogé sur les raisons de sa sélection. Il m’a dit qu’il avait choisi le morceau parce qu’il avait le même producteur qu’un titre que j’appréciais.“ On touche là à quelque chose de l’ordre de la différence entre machine et homme: certaines recommandations à faire ne sont pas rationalisables, ne pourront, on l’espère, jamais l’être. Rogers nous explique qu’il faudrait ne plus parler d’intelligence artificielle mais de „système d’intelligence“. Un tel système peut traverser trois stades: une phase d’apprentissage, où il assiste l’homme (et vice versa) suivie d’une phase augmentée qui débouche sur une autonomie certaine. La machine apprend, retient et applique, mais à tous les stades, l’homme détient le contrôle. Vendredi soir, on a pu voir cette interaction sur le vif avec une démonstration de la musicienne Imogen Heap, qui a développé des gants (les „Mi.Mu Gloves“) lui permettant de composer sur scène un titre – ces gants multifonctionnels permettent de composer tout un titre, de l’accompagner avec de la percussion (l’artiste, équipée de ses gants, mime des gestes de batteur et produit ainsi un beat, qu’elle enregistre pour le faire jouer en boucle), de le développer par strates de boucles modifiables à souhait.
Quel futur pour le musicien sur le marché?
![]() Les ventes de CDs sont en chute libre et l’ère au cours de laquelle un label signait un artiste pop à grosses ventes afin de pouvoir légitimer financièrement la signature de neuf ou dix groupes indés de qualité est révolue (on se rappelle que le groupe de postcore Thrice fut un jour signé par Island Records, qui publient Justin Bieber). Aujourd’hui, le musicien, la plupart du temps, doit de plus en plus acquérir des bases de l’entrepreneuriat alors même que, bien souvent, il n’a pas vraiment envie de les acquérir, ces connaissances.
Les ventes de CDs sont en chute libre et l’ère au cours de laquelle un label signait un artiste pop à grosses ventes afin de pouvoir légitimer financièrement la signature de neuf ou dix groupes indés de qualité est révolue (on se rappelle que le groupe de postcore Thrice fut un jour signé par Island Records, qui publient Justin Bieber). Aujourd’hui, le musicien, la plupart du temps, doit de plus en plus acquérir des bases de l’entrepreneuriat alors même que, bien souvent, il n’a pas vraiment envie de les acquérir, ces connaissances.
Raison pour laquelle Benji Rogers, figure de proue de l’innovation en termes d’économie musicale, estime que la plupart des outils doivent être développés afin que même le bassiste le plus perdu dans les vapes de la marijuana puisse les comprendre. „Et je sais de quoi je parle, renchérit-il, puisque ce bassiste, il jouait dans mon groupe. Non, sans déconner, en développant une app, on s’est dit qu’il faudrait peut-être inclure des boutons lumineux, parce que ce bassiste réagissait aux trucs un peu flashy.“ Pour Rogers, certains musiciens à succès – il cite Taylor Swift, Beyoncé et Frank Ocean – le sont en partie parce qu’ils sont des entrepreneurs doués. Et parce qu’ils sont aux commandes.
Selon Benji Rogers, le pouvoir d’une entreprise comme Amazon vient du fait qu’elle élabore une nébuleuse de code autour de chacun d’entre nous. Amazon et Google élaborent un système de préférences autour de nous: les deux entreprises ont bien compris que le pouvoir véritable de l’âge d’information était (oh miracle) la détention d’informations.
Autrement dit: Si je connais tes préférences, je connais ce que tu vas avoir envie d’acheter et je peux mieux parler à ton inconscient d’acheteur. Une archéologie du savoir numérisée, combinée à une psychanalyse de la libido du consommateur.
Du coup, pour Rogers, afin de pouvoir avoir une part du gâteau – et donc de survivre en tant que musicien dans un monde où l’on ne gagne plus ses sous avec la vente de disque – il importe de collectionner autant que faire se peut des informations relatives à la fanbase (réelle ou potentielle) d’un musicien ou d’un groupe.
„Si quelqu’un vous demande de jouer un concert gratuit dans un bar, explique-t-il lors de la conférence „Creative (Music) Industry in Luxembourg: Situation and Needs“, je lui répondrais o.k. – sous condition qu’il vous permette de recueillir autant d’informations que possible sur vos fans. Des adresses mail, des numéros de téléphone, peu importe, du moment que vous pouvez directement communiquer avec eux. Il faut vous mettre dans la tête le constat suivant: la plupart des gens, dans leur vie, ne font pas ce qui leur plaît. Alors que vous, musiciens, vous vivez vos rêves. Du coup, les gens veulent être comme vous. Votre boulot, c’est de faire en sorte que les gens soient excités par l’activité quotidienne qui est la vôtre. Pour y arriver, il faut être en contact direct avec eux.“ C’est sur de tels prémisses que Rogers fondit „PledgeMusic“, un site web lancé en 2009 qui favorise le contact direct avec les fans et, par conséquent, permet la prévente de produits de musiciens auprès d’un public potentiel. Récemment, Rogers s’est intéressé à la technologie Blockchain. Partant du constat qu’il y a 1,2 millions de streaming par jour rien qu’aux Etats-Unis, que les morceaux de musique sont des fichiers et que ces fichiers sont et vont partout, Rogers a découvert qu’il n’y a pas d’endroit (virtuel) public ou privé où l’on puisse vérifier les droits de propriété de ces fichiers. Pour ce prouver, Rogers prend une vidéo Youtube qu’il convertit en fichier MP3. Il l’ouvre sur iTunes pour renommer ensuite malicieusement le titre en „Benji’s Great Song“. „Eh hop, j’ai créé, sur la Cloud d’Apple, une nouvelle réalité virtuelle“, conclut Rogers.
Dans l’industrie d’aujourd’hui, on a ainsi tout un tas de bases données centralisées entre lesquelles il y a peu prou d’échanges. La technologie Blockchain, qu’on peut s’imaginer comme une sorte de registre de propriété décentralisé, qui profite d’Internet pour être mise à jour de façon automatique, permettrait d’insérer toutes sortes de données de propriété dans le fichier même, la mise à jour automatique favorisant les interactions. Le résultat en est que les droits d’auteurs seront inscrits dans le média lui-même, ce qui accélérera le processus de paiement des artistes et garantira une transparence inouïe, limitant les détournements illicites et la manipulation possible par une ou plusieurs centrales détentrices de pouvoir.
Parlant de la situation luxembourgeoise, Tom Baumert du „House of Entrepreneurship“ affirme qu’il ne rencontre guère d’artistes ou de musiciens, qui les contactent souvent pour des questions de sécurité sociale – comme de jeunes musiciens doivent payer leur sécu, que ça peut leur coûter dans les 500 euros et qu’ils n’ont pas un revenu énorme, il s’agit là d’un problème récurrent. Marc Lis, qui représentait vendredi dernier la „Luxembourg Creative Industry Cluster“, regrettait qu’il n’y ait pas de statistiques permettant d’évoluer la valeur de l’industrie musicale au Grand-Duché. L’un des constats souvent répétés – et qui s’applique d’ailleurs à toute la scène culturelle luxembourgeoise – est que le marché du pays est trop petit – et qu’il n’est pas évident de percer à l’étranger, même si le bureau d’export „Music L :X“ a multiplié les efforts ces dernières années. Pour Benji Rogers, l’on peut contrecarrer cela en arrêtant de penser en dimensions de limitations spatio-physiques. L’espace, de nos jours, est infini. Pour Rogers, il faut exploiter cette infinitude en pensant à vendre des places (virtuelles) à travers le monde. Reste néanmoins le constat que, plus on profite de cette expansion infinie du monde de la Toile, plus on sature un marché dans lequel il deviendra encore plus difficile de s’individualiser. Le risque étant double: d’abord, dans cette survalorisation de l’interaction avec le fan, le temps consacré à la composition est perdu. Ensuite, il y a des artistes qui, tout simplement, n’ont pas envie de (ou de compétences pour) se faire manager et entrepreneur parce que, en fin de compte, ils sont avant tout des musiciens.


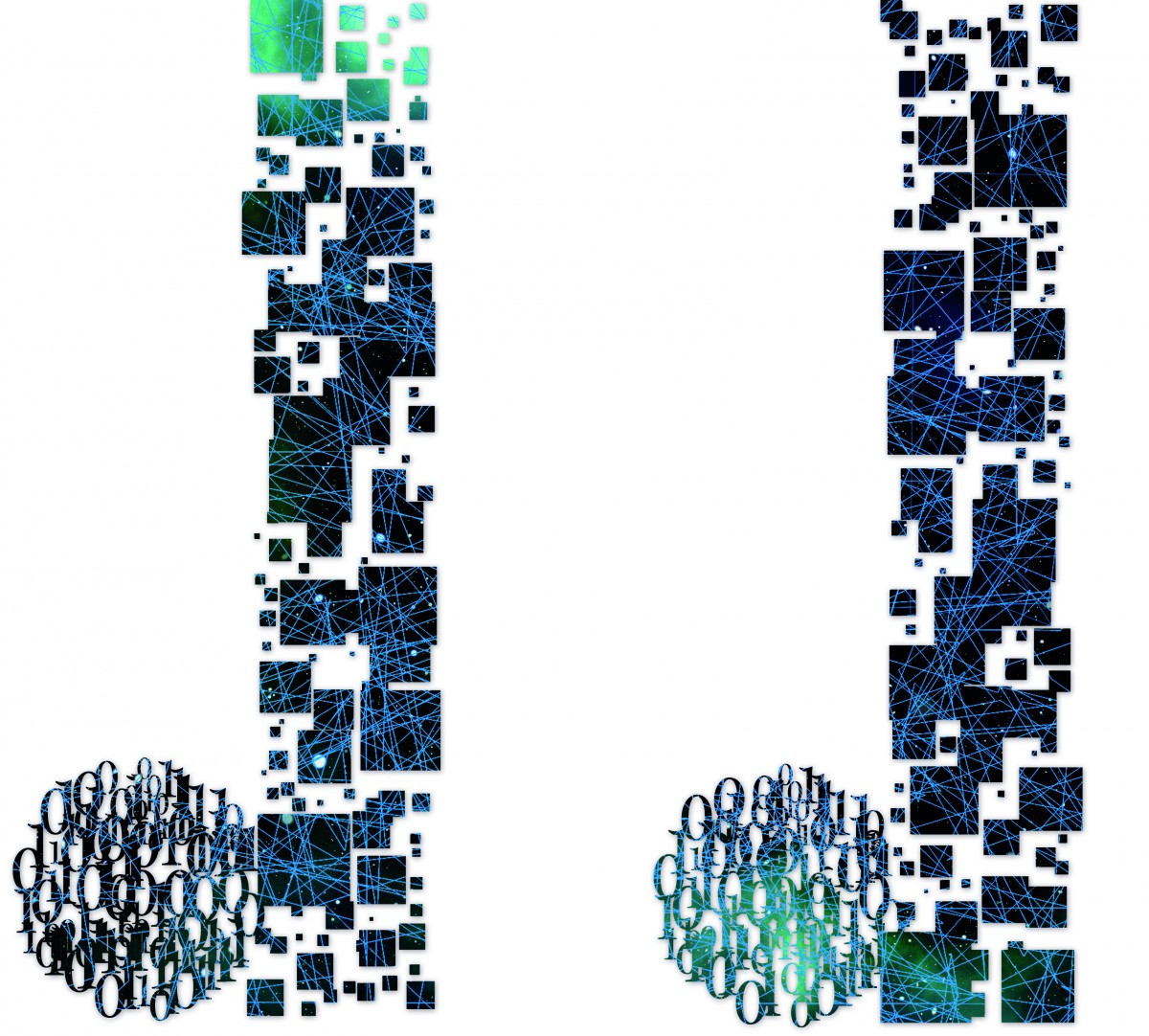







Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können