La question est devenue d’actualité, depuis que les députés di Bartolomeo et Biancalana ont adressé en novembre dernier une question parlementaire au ministre d’Etat, dans laquelle ils se font porte-parole de l’Association des Amis des Brigades internationales (ABIL) qui avait demandé dès 2018 à ce qu’une plaquette commémorant l’engagement au service de la liberté des volontaires de la Guerre d’Espagne puisse être apposée au Monument du Souvenir. Dans leur question parlementaire les deux députés ont d’ailleurs évoqué le précédent de la plaquette apposée en l’honneur des militaires luxembourgeois engagés volontaires dans la guerre de Corée en 1950-1953. A ce jour, l’autorisation d’apposer la plaquette en l’honneur des combattants de la guerre de Corée demeure inexpliquée. Dans sa réponse du 17 décembre 2020 à la question parlementaire susmentionnée, le ministre d’Etat Xavier Bettel se range à l’avis du comité exécutif du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui avait statué en conclusion qu’il ne trouve pas opportun l’apposition d’une plaquette supplémentaire au Monument du Souvenir. L’attention portée sur les combattants volontaires de la Guerre d’Espagne interpelle l’historien. Qui étaient ces „Spueniekämpfer“? Qu’est-ce qui a pu motiver leur décision de s’engager dans les Brigades Internationales? Quelle est la signification historique de leur engagement?
Qui sont les volontaires de la Guerre d’Espagne?
L’Espagne des années 1930 était un pays déchiré par d’âpres conflits sociaux et politiques. A la mi-juillet 1936, le général Franco perpétra un putsch militaire, avec le soutien de milices d’extrême-droite, contre le gouvernement légitime de la gauche républicaine. D’emblée le soulèvement militaire d’une grande partie de l’armée espagnole put compter sur l’appui de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, qui ne tardèrent pas à fournir des armements aux forces rebelles, puis à leur venir en aide par l’envoi sur place de corps expéditionnaires. Alors que les démocraties occidentales arrêtaient une politique de non-intervention dans la guerre civile espagnole.
En réaction à la progression des forces rebelles en direction de Madrid se constituaient alors à partir de septembre 1936 les Brigades Internationales formées de combattants volontaires étrangers, prêts à épauler les unités populaires républicaines dans leur lutte contre les putschistes. Les premiers départs de volontaires du Luxembourg eurent lieu au début du mois de novembre 1936. Par petits groupes ces volontaires, dont la plupart sont originaires des villes industrielles du bassin minier, franchissent la frontière franco-luxembourgeoise pour rallier l’Espagne en train. Combien sont-ils? Qu’est-ce qui motive leur décision de s’engager dans les Brigades Internationales? Selon l’historien Henri Wehenkel qui a publié une étude fouillée sur l’histoire des volontaires de la Guerre d’Espagne partis du Luxembourg, le chiffre d’une centaine de volontaires peut être retenu.
A première vue, il semble malaisé de saisir à notre époque les motivations qui ont pu inspirer de jeunes gens à quitter entre 1936 et 1938 leur famille, leur domicile, leur emploi, pour aller se battre pour une cause politique dans un pays situé à l’autre bout de l’Europe. Etaient-ce tous des idéalistes ou bien étaient-ils plutôt poussés par l’esprit d’aventure? C’est surtout la motivation politique qui entre en compte chez ceux qui ont été amenés à expliquer leur décision. Les uns invoquent l’engagement pour la liberté du peuple espagnol, d’autres la défense de la démocratie, de même que la lutte pour les droits sociaux de la classe ouvrière. Nous ne pouvons vraiment saisir les motivations profondes de cet engagement que lorsque nous prenons en considération la grande précarité sociale à laquelle bien de ces volontaires sont confrontés à l’époque: salaires trop bas pour nourrir décemment une famille, licenciements du fait des listes noires du patronat ou bien à cause de la crise économique, crise du logement. Et puis bien des immigrés d’origine italienne ou allemande ont connu la violence des mouvements d’extrême-droite dans leur pays natal qu’ils ont quitté pour se réfugier au Luxembourg.
Tel est le cas des futurs brigadistes internationaux Otto Blüder ou encore des juifs Nathan Steinberg et Johann Sauerwein. Pourtant, même au Luxembourg ces travailleurs immigrés ne sont pas à l’abri des tracasseries et de la surveillance policière des autorités du pays. Le gouvernement du ministre d’Etat Joseph Bech fait surveiller par sa police politique les milieux d’immigrés et peut à tout moment ordonner l’expulsion de telle personne fichée pour une prise de position antifasciste ou bien connue pour ses sympathies socialiste, communiste, ou anarchiste. Sous la menace d’une expulsion qui peut intervenir à tout moment, certains immigrés antifascistes préfèrent prendre les devants et s’engager dans les Brigades Internationales.
Le ministre d’Etat Joseph Bech et les combattants des Brigades internationales
Le gouvernement Bech voit cependant d’un mauvais oeil l’engagement de volontaires luxembourgeois et d’immigrés étrangers au sein des Brigades internationales, puisque le ministre d’Etat entend suivre une politique officielle de stricte neutralité sur le plan de la politique étrangère et observer le principe de la non-intervention dans la guerre civile espagnole, nonobstant l’engagement militaire de l’Italie fasciste et e l’Allemagne nazie au côté des putschistes espagnols. La répression à l’encontre des sympathisants de la République espagnole se durcit à partir du printemps 1937, lorsque Bech fait adopter la loi du 10 avril 1937 „destinée à empêcher la participation d’étrangers à la guerre civile d’Espagne“. Les volontaires des Brigades internationales s’exposent désormais à des poursuites judiciaires et ils encourent une peine de prison pour avoir combattu en Espagne. Des brigadistes venus du Luxembourg participent aux batailles décisives de la Guerre d’Espagne, qu’il s’agisse de la défense de Madrid au début de 1937, des batailles de Brunete et de Teruel durant la seconde moitié de cette même année ou bien encore de la bataille de l’Ebre en été 1938. L’échec de l’offensive républicaine sur l’Ebre signifie à la fin la défaite du camp républicain dans cette terrible guerre civile. Les combattants des Brigades internationales vont alors quitter l’Espagne. Pour les brigadistes venus du Luxembourg, le bilan s’avère proportionnellement très lourd: 18 combattants ont perdu la vie en Espagne, une trentaine y ont été blessés, dont certains grièvement.
Le retour des volontaires au Luxembourg ne signifie pas pour autant la fin des déboires et tracasseries. Bien au contraire! Certains combattants de la Guerre d’Espagne pour lesquels une mesure d’expulsion avait été ordonnée avant 1936 se voient refuser le retour au pays, même s’ils y ont femme et enfants. Tel est notamment le cas du Dudelangeois Libertario Tassi. D’autres volontaires vont être arrêtés à leur retour et condamnés pour avoir enfreint la loi de 1937 portant interdiction de participer à la guerre civile d’Espagne. Même si les peines prononcées par les tribunaux ne sont plus mises à exécution après l’entrée des socialistes au gouvernement, il n’en demeure pas moins que la surveillance policière ne cesse pas, comme l’attestent les rapports de police.
Parmi les premières victimes de la terreur nazie
C’est précisément sur la base de ces rapports de police luxembourgeoise tombés aux mains de la Gestapo nazie après l’invasion du pays par l’armée hitlérienne que la police nazie réussit à identifier les combattants d’Espagne et à en arrêter la plupart dès le mois d’août 1940. Les combattants de nationalité italienne vont être remis par la Gestapo aux autorités fascistes italiennes qui les déporteront sur les îles de relégation situées en mer Adriatique et dans le golfe de Naples. Les volontaires luxembourgeois de la Guerre d’Espagne arrêtés par la Gestapo vont pour la plupart être transférés dans un premier temps à la prison de Trèves, puis déportés en camp de concentration. Tel est aussi le cas cruel de Pierre Goetz, invalide de la Guerre d’Espagne qui y a perdu une jambe et que les nazis vont déporter au KZ de Dachau. L’ouvrier Jean Betten, de Schifflange, et le mineur eschois Pierre Tuschong ne vont pas survivre au KZ de Dachau, le mineur Anildo Briscolini perdra la vie au KZ de Mauthausen, le mineur Georges Tholl d’Esch-sur-Alzette, sera exécuté au camp de Natzweiler, Marcel Cesarini, de Dudelange, sera tué au camp d’Auschwitz. Il faut bien constater que les volontaires de la Guerre d’Espagne ont été tout particulièrement victimes de la terreur nazie et qu’ils ont payé un lourd tribut à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale pour leur engagement au côté du camp républicain dans la guerre civile espagnole.
Les pionniers de la lutte antifasciste
Il y a maintenant une trentaine d’années que le journaliste Paul Cerf a rendu attentif au fait qu’à son avis les actes et gestes de résistance contre le régime de terreur nazie n’ont pas débuté avec l’invasion du pays par l’Allemagne hitlérienne en mai 1940. Cerf était d’avis qu’il fallait considérer comme résistants tous ceux qui ont secouru des réfugiés politiques et des victimes de la politique raciale nationale-socialiste avant le 10 mai 1940, tout comme ceux qui se sont opposés à la loi-muselière, au „Maulkuerfgesetz“ du gouvernement Bech en 1936-1937, de même que les volontaires qui se sont „engagés dans les Brigades internationales en Espagne et combattirent contre le général félon Franco, soutenu par les Allemands et les Italiens. C’étaient des résistants!“
Les combattants volontaires de la Guerre d’Espagne ont été les pionniers de la lutte contre le fascisme et le régime de terreur nazie. Leurs mérites ont finalement été officiellement reconnus en 1997, puis en 2003 à l’occasion de l’abrogation de la loi de 1937 portant sur l’interdiction de participer à la Guerre d’Espagne. Il n’existe donc pas de raison valable à ce que cette reconnaissance officielle ne puisse figurer au Monument du Souvenir de la „Gëlle Fra“. Surtout qu’à notre époque, où nous voyons que les libertés fondamentales, les droits politiques et sociaux des citoyens, de même que l’Etat de droit, sont de plus en plus menacés de par le monde par des régimes autoritaires, il devient chaque jour plus urgent de se souvenir de l’exemple qu’ont pu donner les pionniers de la lutte antifasciste des années 1930. Une petite note optimiste pour finir: aux dernières nouvelles, le ministre d’Etat vient de prier le Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale de reconsidérer la demande exprimée par les députés di Bartolomeo et Biancalana.
Henri Wehenkel, „D’Spueniekämpfer – volontaires de la Guerre d’Espagne partis du Luxembourg“, CDMH, Dudelange 1997
Serge Hoffmann, „Le Grand-Duché face à la guerre civile espagnole (1936-1939)“, in Galerie 8 (1990) n°4, 553-571

 De Maart
De Maart



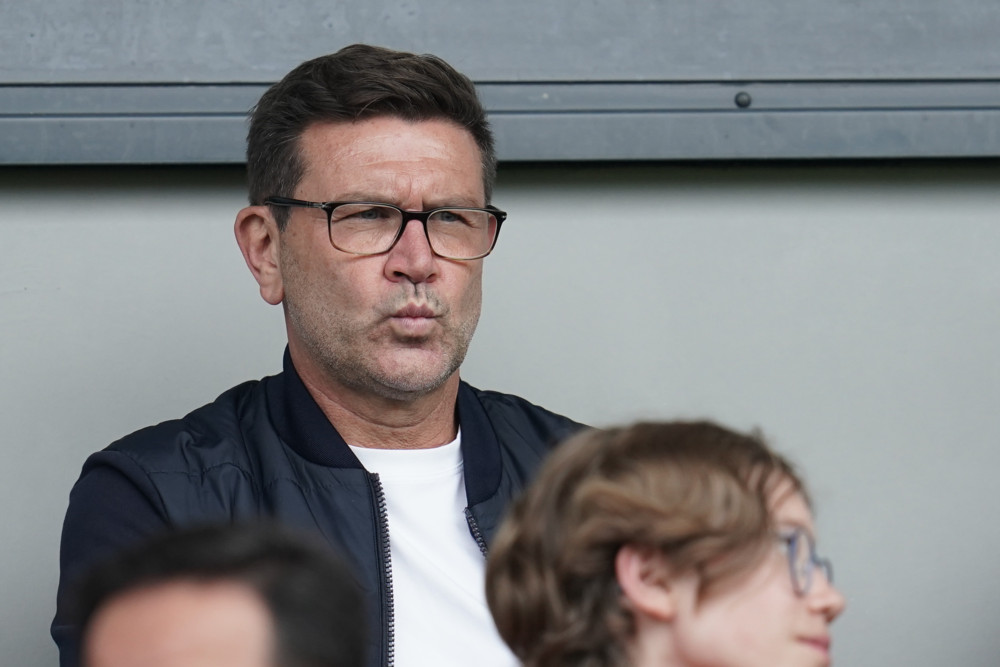



Et get Zeit dat dei Fehler vun der Regierung BECH erem gutt gemat ginn.
La guerre d‘Espagne , l’antichambre de la prise de pouvoir du fascisme en Europe ,de la deuxième guerre mondiale . Beaucoup de nos concitoyens suite au lavage du cerveau en temps de la guerre froide considérèrent toujours les héros des Brigades internationales comme des criminels communistes , des adversaires.La « Gelle Fraa » pleure des combattants Brigades Internationales ,traités toujours en communistes criminels ,qu’on refuse d’honorer d’une plaque commémorative auprès des vaillants combattants contre le fantôme du communisme en Corée, en Russie.