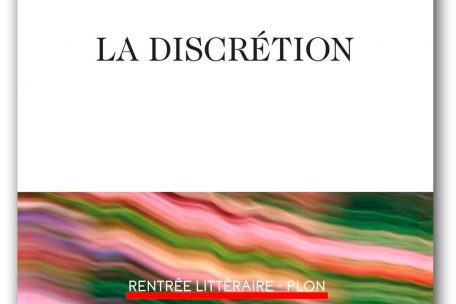
Faïza Guène et Fatima Daas ont beau avoir dix ans d’écart, elles sont de la même génération. De la deuxième génération, plus précisément. La première née en France d’une famille immigrée, d’origine algérienne, musulmane. Et à ce titre, leurs parcours et les écrits qu’elles ont respectivement publiés à l’automne se recoupent en des points saillants. Elles décrivent chacune à leur manière le juste équilibre qu’il leur faut trouver entre le respect de l’héritage culturel, leurs propres aspirations et les assignations ambigües de la société.
Depuis „Kiffe kiffe demain“, Faïza Guène raconte l’histoire des siens, avec toujours plus de profondeur, une plume vive et une bonne dose d’humour pour apaiser la violence, symbolique ou directe, que ses histoires contiennent. Car on ne peut être Français et d’origine maghrébine sans avoir vécu l’humiliation et l’injustice faite aux siens, à l’occasion d’événements traumatisants comme la guerre d’Algérie, ou par le racisme ordinaire qui hante le quotidien. La différence de trajectoires se révèle dans ce qu’on fait de ces blessures.
La génération qui a franchi la Méditerranée a souvent fait profil bas, préféré baisser la tête, ne pas trop se poser de questions et s’en remettre à Dieu, comme Yamina, la mère de la famille Taleb dont Faïza Guène raconte des tranches d’histoire dans „La discrétion“. Il faut dire que la mère peut difficilement comprendre que son père qu’il l’avait gardé avec elle à la ferme jusqu’à ses trente ans, a finalement décidé de la marier de force et de la voir partir en France, „dans le pays des colons qu’il avait mis tant d’ardeur à chasser du sien“.
Entre déni et simplicité
Cette passivité face à l’injustice, cette discrétion, la plus sanguine des trois filles Taleb, Hannah a du mal à l’accepter. Le récit s’ouvre sur une colère dont elle est familière, dès qu’elle entend un autochtone manquer de respect à sa mère. Les enfants de la famille, trois filles et un garçon, entre 30 et 40 ans, ont d’ailleurs un jeu qu’ils pratiquent de longue date, le „Raciste? Pas raciste?“ qui en dit long sur leur quotidien. C’est un jeu d’évaluation des intentions de leur interlocuteur auxquels ils préfèreraient ne pas jouer. „Ils aimeraient ne pas perdre tout ce temps, à se demander d’où vient cette condescendance qu’on leur manifeste, à faire des liens emmerdants avec leurs origines, ils aimeraient aussi parfois avoir le luxe du déni. (…) ils aimeraient pouvoir ignorer le mépris, comme le fait leur mère, en vérité, ils aimeraient juste que les choses soient plus simples.“
Il va lui falloir du temps à Hannah pour déceler la force qui se cache dans le silence, le capital dignité qui lui est ainsi transmis sans crier gare. A chaque génération suffit sa peine et entre l’indifférence des parents et la simplicité qu’on souhaite pour ses futurs enfants, il y a pour Hannah un parcours, y compris thérapeutique, à faire pour se libérer de cette „colère qui dévore les tripes“, Faïza Guène cite en exergue Frantz Fanon: „Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir.“
Avec „La discrétion“, l’écrivaine rend hommage aux mères, déracinées, mariées contre leur volonté et souvent empêchées dans leurs désirs. Des mères qui ne demandent qu’à être fières de leurs progénitures, pour qui la banlieue a signifié le confort. Ecrire leur vie, leur courage, leurs sacrifices, les sauver de l’oubli, c’est réparer l’offense et éviter de transmettre l’aigreur à la génération qui vient. La tache est immense car la société ignore tout de cette complexité et la nie même à chaque attentat terroriste, en refusant le deuil aux enfants Taleb et à leurs semblables, lesquels, à peine sortis de la sidération provoquée par l’événement, sont sur le banc des accusés et enjoints à des désolidarisations stériles.
C’est donc l’intérêt de tels témoignages que de restituer toute cette complexité, d’exposer ce que la discrétion empêche de dire et l’analphabétisme bien souvent d’écrire, à l’heure où cette génération arrivée dans les années 50 et 60 disparaît peu à peu.
Comme elle l’avait démontré avec „Un homme, ça ne pleure pas“, Faïza Guène sait tout aussi bien décrire avec finesse la situation de ses frères d’âge. Le garçon des Taleb, Omar, est un jeune homme qui a renoncé à la virilité, à l’autoritarisme, à une répartition des rôles en défaveur des femmes, („Pour elles, il y a un tas de petites morts avant la grande mort.“). Omar „doit inventer sa façon d’être un homme“ mais ses diplômes ne lui ont pas permis d’éviter le travail de seconde zone promis à la majorité de ses semblables. Il est chauffeur Uber, pas si loin finalement du mineur que fut son père d’hier. Cela conforte Omar, dans l’idée qu’il y a des endroits et des situations qui ne sont pas faites pour lui. Cela fait enrager sa sœur: „Les autres ils font à peine l’effort de nous exclure. Nous le faisons très bien nous-mêmes.“
Musulmane et lesbienne
Derrière la position délicate de femme, de musulmane et d’Arabe se cache aussi celle du transfuge de classe. Celle-là se gère en famille, à l’abri des regards. Cette impression de trahir les siens dès qu’on prend des distances avec leurs enseignements se cristallise dans le roman de Faïza Guène comme dans le témoignage de Fatima Daas, dans la fréquentation d’une psychologue.
Par rapport aux personnages de „La discrétion“, Fatima Daas, qui se raconte dans „La petite dernière“, a en plus à devoir gérer son homosexualité. Ses fragments de vie montrent comment elle compose avec ces contradictions. Elle cherche les moyens qu’être musulmane lesbienne ne sonne pas comme un oxymore. La situation lui fait douter du droit même à porter son nom, qu’elle répète comme pour l’accepter et nous rappeler d’où elle parle.
Fatima Daas est en quête d’une stabilité „parce que c’est difficile d’être toujours à côté, à côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, à côté de la plaque“. Elle a dû constamment faire avec des codes souvent contradictoires et qui parfois, étonnamment, se rejoignent. C’est ce qu’elle nous donne à voir, en partageant sa manière qu’elle a eu d’affronter les attentes d’une éducation musulmane traditionnelle, de l’école comme de l’univers lesbien. Dans ce dernier comme dans la famille, l’amour est tabou mais pour des raisons différentes. Quand c’est la misère qui étouffe les sentiments d’un côté, c’est la liberté de l’autre qui les oppresse. Quand sa compagne lui demande de taire sa jalousie et ses tristesses, Fatima n’a pas de mal à y répondre. „Mes parents m’avaient enseigné l’art de la dissimulation. Ne jamais rien dire.“
Sa sœur a beau lui promettre qu’elle a une tête de journaliste, l’école ne veut pas de sa réussite. En école préparatoire, un prof d’espagnol juge que sa note est trop élevée pour être honnête. Il la prend à l’écart dans le froid pour lui faire avouer la supercherie: „J’ai réalisé que prouver, démontrer, me rendre légitime, montrer ce que je valais n’était pas le lot des autres élèves qui étaient à l’intérieur, au chaud. Personne n’avait à argumenter pendant dix minutes en t-shirt, dans le froid, pour prouver qu’elle avait bien mérité un dix-sept sur vingt.“
Fatima Daas est traversée par la crainte de ne pas avoir respecté ce d’où elle vient. Ses saillies homophobes, qui parlent à sa place, la trahissent et la meurtrissent. Elle finit par écouter Descartes plutôt que sa mère. C’est le moyen de s’accorder avec son héritage. Elle réapprend la religion par elle-même, poser aux dignitaires ses questions de jeune femme moderne. Il lui faut entendre qu’avec toute la bonne volonté imaginable, elle ne peut rendre licite l’illicite et que la meilleure solution serait qu’Allah „lui donne force et courage, crée pour elle un miracle, un homme qui a des qualités féminines“.
Fatima Daas se démène avec respect et bienveillance pour les siens, sans renoncer à l’amour vers lequel l’emmènent les autres. Elle semble s’approcher du point d’équilibre quand s’achève „La petite dernière“. Une citation d’Annie Ernaux („Je ne veux pas expliquer ma passion = cela reviendrait à la considérer comme une erreur – mais simplement l’exposer“), nous donne une idée de ses intentions. Son livre est un témoignage personnel qu’elle jette à la face du monde. Mais on le parcourt, comme le roman de Faïza Guène, avec la sensation que de telles œuvres littéraires trop rares sont d’une aide précieuse pour faire société.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können