Un vieil écrivain obsédé par la certitude de sa propre mort se met en couple avec sa belle-fille Esther, qui a un demi-siècle de moins que lui. Lui est criblé de dettes et de culpabilité, „poursuivi par les créanciers, harcelé par les huissiers, menacé d’un procès par plusieurs éditeurs“, compensant ses insomnies en buvant du whiskey jusqu’à l’amnésie; elle est un jeune modèle insouciant, elliptique, distrait, anorexique, toxicomane.
Lui décrit sans complaisance le délabrement de son corps et de son esprit, évoquant le „lierre sombre de mes veines sur mes mains“, disant être devenu une sorte de „capitaine Achab qui aurait vendu son bateau pour boire et adopté lui-même la forme du cachalot“. Il baigne dans un monde auquel il ne comprend plus rien, qu’il méprise et qui le lui rend bien. Elle est curieuse, assoiffée de savoir, à la découverte d’un monde qui lui réserve bien des surprises („l’enthousiasme de la jeunesse naît du noyau de mystère que la réalité lui réserve encore“) et qui est d’autant plus à ses pieds qu’elle est d’une beauté à couper le souffle.
Leur liaison ayant déclenché un scandale, il a décidé de quitter Paris pour Sainte-Croix, petit patelin de campagne non loin de Paris où il a investi le presbytère et où il passe son temps entre réclusion et petites virées dans sa Twingo délabrée alors qu’il n’a plus de permis de conduire.
Là, les deux amants vivent en tranquillité, les habitants du village, dont le maire appartient à „un parti réputé d’extrême-droite“ – cette provocation qui consiste à peindre des personnages de fachos plus tolérants que les représentants des milieux intello-gauchistes, Liberati la tient de Houellebecq – ne s’offusquant pas outre mesure de cette liaison scandaleuse.
Alors qu’elle passe son temps à l’écouter tenir des sortes de cours magistraux sur la littérature, à faire des recherches pour le travail de son amant-vampire et à peindre, lui s’occupe du développement d’un scénario pour une série télévisuelle sur le début des Rolling Stones.
Lors de l’écriture de cette série centrée autour de la vie et mort précoce de Brian Jones, jeune ange déchu condamné à la mort, figure de cocu et de trahi qui fascine d’autant plus le vieil écrivain qu’il y voit, condensé et métaphorisé, son propre avenir, le narrateur devra faire face à des producteurs cyniques, qui le laissent croire qu’il n’est, à leurs yeux, qu’une „vieille outre à whiskey sans ressort“ pour mieux le „presser comme un citron“ – et qui veulent que ses personnages se montrent „sympathiques, clairvoyants et politiquement justes“ alors que lui essaie de sauver les meubles, voyant d’emblée tous les écueils de ce qui risquera d’être une trahison des personnes et d’une époque: „Une fois de plus, l’idée me vint que la ressemblance des comédiens avec les originaux était une grande erreur du genre ‚biopic’, vouloir du ressemblant, c’est déjà abdiquer toute vérité, Sartre avec une pipe, Hitler avec mèche et moustache étaient des pitres interchangeables, il aurait fallu faire jouer ça par des Japonais, voire des enfants japonais.“
Alors que l’incompatibilité entre les besoins de vraisemblance des producteurs et la créativité du narrateur creuse un fossé entre eux, alors que se tisse, sur fond de passion, de recherche méticuleuse, de sectarisme et d’intérêt pour l’opium, une connivence entre le narrateur et le réalisateur coréen, alors que la santé mentale et physique de l’écrivain se délabre de plus en plus, lui qui est en proie à la fois à l’incontinence et à la jalousie, un double road-novel s’esquisse, le narrateur se rendant à Korean City, un décor de tournage en toc en Espagne où il croit „entamer le dernier acte“ de sa vie, mettant ses pas dans ceux des Stones („le choix de l’itinéraire ne dépendait pas de moi, mais de Keith Richards“), retraçant leur folle cavalcade de l’Hôtel George V à Algésiras, cumulant les documentations, animant les scènes, les fictionnalisant avec un souci du détail impressionnant.
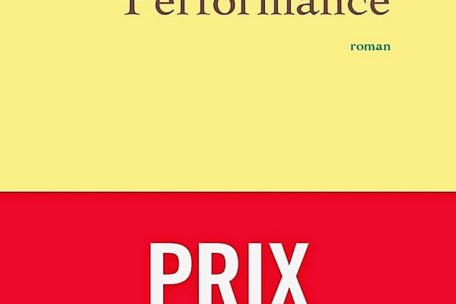
Les trois Brian
La France avait-elle besoin, après le scandale Matzneff, après le livre de Vanessa Springora, dans une époque marquée par #metoo, mais aussi le politiquement plus que correct, la bienséance – toutes choses contre lesquelles le narrateur grincheux et désabusé ne cesse de pester, convaincu qu’il est qu’une telle éthique ne correspond en rien à la période trouble que la série est censée faire revivre et pour laquelle les principes moraux en vigueur en 2022 sont autant de trahisons d’une époque plus violente, moins encline à la tolérance et à l’aseptisation – d’un énième roman sur un vieux mâle narcissique qui décrit son amour pour une femme très jeune en insistant sur le caractère subversif qui consiste à vampiriser la beauté féminine?
Si l’on peut comprendre ceux et celles qui condamneront ce roman sans en avoir lu une ligne – j’avoue avoir eu de très grandes réticences avant de le commencer, et cela malgré mon admiration pour l’écriture et le style de Liberati –, force est de constater que „Performance“ est un roman qui mérite, en dépit de certains passages un peu limites, où le narrateur donne libre cours à ses considérations antédiluviennes sur la féminité et son essence, qu’on s’y attarde.
Tout d’abord, il y a le style de Liberati, son sens de la formule, il y a le très drôle cynisme de l’écrivain qui jette un regard lucide et sans concession sur sa propre vie et le monde qui l’entoure. Il y a ces élucubrations en discours indirect libre où monologues intérieurs et exposés énoncés à voix haute s’emmêlent, Liberati rendant ainsi hommage à „Fear and Loathing in Las Vegas“ de Hunter S. Thompson et à son adaptation cinématographique de Terry Gilliam.
Il y a cette évocation à la fois plastique, ironique et précise du monde cinématographique, où l’auteur est réduit à une sorte de singe ou de marionnette, évocation qui rappelle à la fois „Barton Fink“ des frères Coen et „Mank“ de David Fincher. Il y a, enfin, ces longues périodes au rythme imparable qui soulignent le rapprochement sémantique à l’œuvre proustienne que le narrateur opère quand il fait apparaître Albertine dans ses longues pages sur l’amour, l’obsession, le sexe et la jalousie.
Mais, surtout, Liberati construit tout un réseau d’appropriations et de vampirisations dont sa relation immorale est à la fois un symptôme et, paradoxalement (et un peu problématiquement) la manifestation la plus pure – le caractère unilatéral de leur relation est par ailleurs relativisé par le personnage d’Esther, qui n’en fait qu’à sa tête et qui est loin de la jeune fille naïve tombant sous le charme d’un vieux lubrique. Ainsi, les deux jeunes producteurs exploitent l’auteur qui, lui, phagocyte le réel pour sa mise en fiction tout en sacrifiant sa personne, adaptant son mode de vie aux personnages et au décor qu’il recrée en l’inventant.
De cet embrouillement entre film, réel et fantasme qu’on connaît de l’énigmatique „Inland Empire“ de David Lynch, c’est la (dé)construction du personnage mythique de Brian Jones qui fascine le plus: entre son fantôme biographique, sa mise en fiction par le narrateur et son incarnation par le jeune acteur censé l’incarner et avec qui Esther entretient une relation trouble, il se dérobe dans ses innombrables et approximatifs dédoublements.
Apparaît, dans cet enchevêtrement, une sorte de poétique où Liberati décrit le rapport souvent malsain que l’écrivain entretient avec le réel: „Je devais me mettre en condition pour évoquer le désordre intérieur et la violence de Brian Jones“, désordre et violence qu’il „veut capturer avec les mots justes, ceux qui sortent difficilement, les meilleurs, qui viennent simplement quand on a tout épuisé, que l’homme qui écrit a tombé tous les masques, quand il se sent sur le fil du rasoir“.
C’est, paradoxalement, à Korean City, dans le décor en plastique d’un jardin anglais, qui ressemble à „une crèche maudite inventée par Lovecraft sur la Lune“, alors qu’il pensait se diriger vers un final tonitruant, où son destin rejoindrait celui de Brian Jones, qu’il se retrouvera dans cet état d’épuisement, de questionnement et d’honnêteté propice à l’écriture. Car plus qu’un récit sur un auteur qui vampirise la jeunesse, la beauté et l’innocence (toute relative) d’une jeune femme, „Performance“ est un roman sur la vampirisation réciproque entre fiction et réel – et sur celui qui, au milieu des deux, affronte le désordre et le bruyant entrechoc des deux en essayant d’en faire de la littérature.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können