 Cette année-ci, pas moins de quatre coproductions luxembourgeoises ont été présentées à Cannes dans les sélections „Un certain regard“ et „La quinzaine des réalisateurs“. Un cinéma varié, politique et, hormis le bide de Christophe Honoré, de bonne qualité.
Cette année-ci, pas moins de quatre coproductions luxembourgeoises ont été présentées à Cannes dans les sélections „Un certain regard“ et „La quinzaine des réalisateurs“. Un cinéma varié, politique et, hormis le bide de Christophe Honoré, de bonne qualité.
Ballotements politiques –
„Les hirondelles de Kaboul“ et „The Orphanage“
Deux des quatre coproductions luxembourgeoises présentées à Cannes retracent l’histoire récente de l’Afghanistan. Là où „The Orphanage“ (Samsa) raconte l’adolescence d’un jeune homme dans un orphelinat à Kaboul sous le régime prosoviétique, „Les hirondelles de Kaboul“ (Mélusine) traduit l’intrigue du roman de Yasmina Khadra – le quotidien de deux couples sous le régime des talibans – en un dessin animé sans emphase ni esthétisation superflue.
Après avoir remporté la mise pour son précédent long-métrage „Wolf and Sheep“ lors de la Quinzaine des réalisateurs en 2016, la réalisatrice Shahrbanoo Sadat revient avec ce qui s’annonce le deuxième volet d’une pentalogie. „The Orphanage“ commence par dépeindre le quotidien de petit truand du jeune Qodratollah Qadiri qui, dans un Kaboul prosoviétique, gagne son pain (et probablement pas plus que son pain) en revendant des trousseaux de clé fabriqués main et des tickets de cinéma au noir.
 Quand il se fait attraper par les autorités, il atterrit, comme le titre du film le présageait, dans un orphelinat où il est rapidement confronté à une hiérarchie interne et des bribes d’éducation soviétique (la séquence d’endoctrinement bon enfant des jeunes du film rappelle le roman „Le grand leader doit venir nous voir“ de Velina Minkoff).
Quand il se fait attraper par les autorités, il atterrit, comme le titre du film le présageait, dans un orphelinat où il est rapidement confronté à une hiérarchie interne et des bribes d’éducation soviétique (la séquence d’endoctrinement bon enfant des jeunes du film rappelle le roman „Le grand leader doit venir nous voir“ de Velina Minkoff).
La cruauté des jeunes enfants contraints de vivre l’un sur l’autre, l’impossible éclosion de leurs désirs de jeunes libidineux transformés par la contiguïté en agressivité à peine contenue: tout cela est dépeint sans pudeur ni emphase par le regard d’une caméra qui capture ce pullulement de jeunes existences ballottés par les régimes politiques – percutante la séquence où l’on demande aux jeunes de suivre l’exemple des grands et de brûler dans un grand autodafé tout souvenir ou preuve de gouvernance soviétique.
L’empathie nécessaire est narrativement opérée par la présence d’une victime (Fayaz) choisie presque au hasard et d’Ehsan, impitoyable bourreau qui a instauré en sous-traitance un règne tyrannique – l’on voit à l’œuvre deux extrêmes d’une organisation sociale qui reflète aussi la terreur et la tyrannie à l’extérieur, comme si le microcosme carcéral de l’orphelinat ne pouvait reproduire que les violences du réel.
Face au dénuement et à la laideur socio-réaliste de son quotidien transformé en jeu autant que faire se peut (les jeunes jouent aux cartes, aux échecs, jouent aussi à s’imaginer comment se taper leurs institutrices), le jeune Qodratollah, épris d’une des filles dans sa classe, se réfugie dans des scénarios kitsch bollywoodiens, par quoi le film commence et se clôt, comme pour contrecarrer l’Histoire officielle par l’imaginaire d’un cinéma bas-de-gamme – le message n’aurait pas été pour déplaire à un certain Quentin Tarantino.
Au début des „Hirondelles de Kaboul“, comme si l’on avait sauté quelques années dans l’Histoire de l’Orient, l’on voit un jeune homme assister à une lapidation. D’abord terrifié par la mise à mort d’une femme, le jeune homme finira par se laisser emporter par la folie ambiante, se saisit d’une pierre et finit par la lancer sur la femme voilée.
Se déroulant en 1998, alors que le régime des Talibans atteint un fanatisme extrême et que la charia met fin à toutes sortes de libertés, le roman de Yasmina Khadra dépeignait le quotidien de deux couples: Mohsen (le jeune homme qu’on vient d’évoquer) et Zunaira, son épouse, rêvent de vivre leur amour en toute liberté et sont tentés d’aller enseigner non pas à l’école coranique, susceptible d’être sous le contrôle des Talibans, mais dans l’underground.
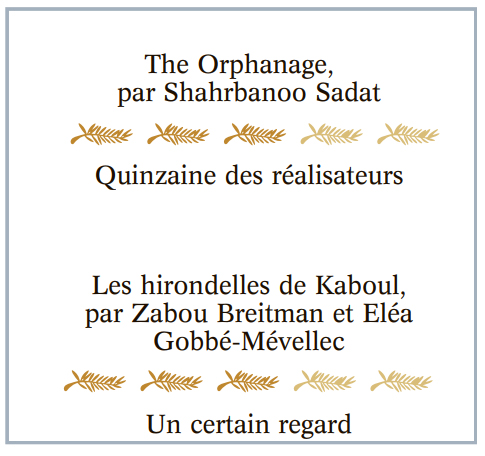 Atiq est un ancien moudjahid (on pourrait donc s’imaginer l’avoir vu à la fin de „The Orphanage“ quand les partisans afghans mettent fin au régime soviétique) qui s’occupe d’une épouse atteinte de cancer et dont, attisé par des connaissances bien plus fanatisées que lui, il souhaiterait bien précipiter la mort, espérant se trouver une épouse plus jeune – car toute femme, lui fait-on comprendre, se remplace sans heurt. Le destin des deux se liera une première fois quand Atiq rencontre un Mohsen désespéré après une dispute avec sa femme, Atiq ne comprenant pas qu’on puisse éprouver du chagrin pour un être inférieur. Il se liera de façon plus complexe quand Atiq, engagé en tant que gardien d’une prison pour femmes, se trouve devoir surveiller Zunaira et que la beauté et le chagrin de cette femme lui coupent le souffle, l’incitant à s’intéresser au sort de Zunaira.
Atiq est un ancien moudjahid (on pourrait donc s’imaginer l’avoir vu à la fin de „The Orphanage“ quand les partisans afghans mettent fin au régime soviétique) qui s’occupe d’une épouse atteinte de cancer et dont, attisé par des connaissances bien plus fanatisées que lui, il souhaiterait bien précipiter la mort, espérant se trouver une épouse plus jeune – car toute femme, lui fait-on comprendre, se remplace sans heurt. Le destin des deux se liera une première fois quand Atiq rencontre un Mohsen désespéré après une dispute avec sa femme, Atiq ne comprenant pas qu’on puisse éprouver du chagrin pour un être inférieur. Il se liera de façon plus complexe quand Atiq, engagé en tant que gardien d’une prison pour femmes, se trouve devoir surveiller Zunaira et que la beauté et le chagrin de cette femme lui coupent le souffle, l’incitant à s’intéresser au sort de Zunaira.
Le trait des physionomies est précis, les couleurs pastel esthétisent quelque peu trop les ruines de la ville, même si le minimalisme esthétique illustre le dénuement et les contraintes dans lesquels vivent les habitants de Kaboul – mais la focalisation sur le destin des êtres tantôt soumis, tantôt rebelles. L’une des forces du récit, à savoir son absence de pathos – ici, trêve d’héroïsme à l’américaine –, est desservi par le trait de pinceaux, qui montre des personnages en demi-teinte.
Si l’on peut, selon qu’on considère la fascination d’Atiq pour Mohsen comme un amour naissant ou comme pure empathie (les deux peuvent évidemment être liés), détecter une trace de kitsch dans l’intrigue – Atiq se repentit à cause de l’amour –, le portrait de quatre êtres écrasés par un régime fanatique est fait avec conviction grâce à une intrigue qui crée du suspense sans pourtant instrumentaliser les réalités politiques évoquées.

Un huis clos gonflé et bavard –
„Chambre 212“ de Christophe Honoré
Tourné à la va-vite après „Plaire, aimer et courir vite“ (en sélection officielle l’année dernière à Cannes), „Chambre 212“ de Christophe Honoré (coproduit par Bidibul) est une réflexion pseudo-métaphysique sur l’amour et la fatigue du couple qui est miné par une mise en scène artificielle, des tentatives d’humour qui tombent à plat et un imaginaire référentiel et poussiéreux.
Pourtant, le film commence fort, avec une amante agacée et impatiente qui sort du placard où elle se cachait alors que celui-ci cherche à éconduire sa copine, qui au contraire aurait bien voulu que l’amant en question, nommé Asdrubal Electorat, continuât ses minauderies érotiques.
Expliquant à la jeune femme asiatique interloquée que de toute façon elle n’avait couché avec son copain qu’à cause d’un fétichisme onomastique (il est vrai qu’Asdrubal Electorat, c’est pas mal comme nom), Maria (Chiara Mastroianni) rentre chez elle prendre une douche.
Son mari Richard (un Benjamin Biolay moyennement convaincant) lira sur un portable vibrant avec insistance les messages de l’amant éconduit – alors qu’en adultérine férue, Maria devrait savoir qu’on peut désactiver sur son smartphone l’affichage du contenu des messages quand l’écran est verrouillée (sous prétexte de verser dans une sorte de surréalisme poussiéreux, le film se croit permis toutes sortes d’incohérences narratives).
S’ensuit une discussion de couple en crise: Maria est convaincue qu’une relation ne peut subsister pendant 25 ans sans que l’une ou l’autre escapade érotique ne vienne apporter un souffle nouveau, alors que Richard tombe des nuées – lui n’a jamais trompé Maria. L’adultérine fait quelques bagages et va s’installer dans l’hôtel en face (dans la chambre 212, eh oui) pour réfléchir à la suite des événements.
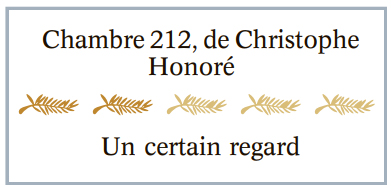 Dès lors, les différentes hésitations des personnages se personnifieront de façon surréelle: la mauvaise conscience, l’écoulement du temps ou encore le vieillissement étant ici incarnés à travers l’alter ego rajeuni de Richard ou encore la professeure de piano du jeune homme, qui fut aussi son premier grand amour.
Dès lors, les différentes hésitations des personnages se personnifieront de façon surréelle: la mauvaise conscience, l’écoulement du temps ou encore le vieillissement étant ici incarnés à travers l’alter ego rajeuni de Richard ou encore la professeure de piano du jeune homme, qui fut aussi son premier grand amour.
Le film se veut drôle, léger et sulfureux – la personnification de la volonté de Maria ressemble à Aznavour, la mère qui apparaît pour gronder sa fille est à son tour grondée par sa mère à elle, la prof de piano dépucèle le jeune Richard alors qu’elle est bien plus âgée que lui. En réalité, les idées de la mise en scène sont pompeuses et gorgées de références lourdes. Surtout, c’est très mal écrit: les dialogues sont bâclés et les personnages peu crédibles (on dira que c’est voulu, cela n’empêche pas le film de ne pas fonctionner), au point que le décalage assumé entre le propos du film, sérieux, et la volonté de traiter cela formellement comme une sorte de comédie musicale surréelle ne fait qu’aboutir à un long-métrage dont on salue surtout, en fin de compte, la brève durée. La presse française jubile, évidemment. C’est surtout inquiétant quand on voit que le cinéma français (féminin) se porte très bien – il suffit d’aller voir le brillantissime „Portrait de la jeune fille en feu“ de Céline Sciamma.
Souffrir et faire souffrir –
„Viendra le feu“ d’Olivier Laxe
Après la logorrhée sans fond ni saveur de Christophe Honoré, on est content de clore les coproductions luxembourgeoises avec „Viendra le feu“ (cosigné Tarantula Productions), un film apaisé, calme, tout en beauté, centré sur le personnage d’Amador, qui revient dans son village après avoir fait de la prison pour avoir incendié une forêt.
Qu’il ait vraiment été coupable, Amador, nous n’en savons rien. Le film suit avec tranquillité son retour au village, la bienveillance tacite et taciturne de la mère, la dureté de la vie rurale, mais aussi la méfiance des habitants. Quand surgit un nouvel incendie, les animosités à peine enfouies reviennent.
Souhaitant filmer une région meurtrie par les feux de forêt, Olivier Laxe cherche à raconter sans juger ni même expliquer et l’histoire d’un homme peut-être coupable et celle de la Galicie, où les feux sont parfois le fruit du hasard, parfois la manifestation d’un mécontentement politique, parfois aussi le résultat d’une lutte pour les terrains.
Contrairement aux montages ésotériques d’un Terrence Malick, la nature n’est ici pas une cathédrale, une ode à la création – elle est filmée dans son simple être-là, la caméra capturant une vie champêtre sans symbolisme excessif tout comme les êtres sont fixés dans la nudité des rapports qui les caractérisent. Ici, une vache malade refuse d’avancer, là, les villageois oscillent entre pardon, colère et discernement. Quand surgit le feu, surgit aussi une fascination esthétique pour le feu. Contrairement à „Wildlife“, cet autre film récent sur les feux de forêts, qui en faisait un symbole d’une famille dysfonctionnelle et ne filmait pas vraiment la lente calcification, Olivier Laxe épouse la danse des flammes, le combat des pompiers, la résistance de ceux dont la vie et les possessions sont menacées – le souffle du feu est capté par la caméra sans que la fascination malsaine reprendrait le dessus.
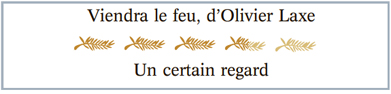 Alors certes, ce dénuement narratif qui va jusque dans la caractérisation des personnages et qui ne se traduit pas non plus par un maniérisme excessif a comme revers certains passages à vide – il manque peut-être à ce film l’urgence des questions politiques dont se revendique son réalisateur.
Alors certes, ce dénuement narratif qui va jusque dans la caractérisation des personnages et qui ne se traduit pas non plus par un maniérisme excessif a comme revers certains passages à vide – il manque peut-être à ce film l’urgence des questions politiques dont se revendique son réalisateur.
Mais la plupart du temps, son approche minimaliste et la beauté de ses plans aboutissent à quelque chose de poétique et d’incisif. Car plutôt qu’une introspection des personnages, ce film très peu bavard travaille par images et par allégories: lors d’un échange avec sa mère, Amador explique que les eucalyptus plongent profondément leurs racines dans le sol, formant des maillages „comme un vieux sac de pommes de terre“, étouffant ainsi toute autre forme de vie. „S’ils font souffrir, c’est parce qu’ils souffrent“, répond sa mère. Tout est dit de la nature humaine, de ses rapports de domination à autrui, de ses désirs de possession en ces quelques lignes tout comme les plans de la caméra en disent plus que les échanges entre les habitants. Comme dans une nouvelle de Hemingway, la plongée dans l’intériorité des personnages nous est interdite, rendant cruciaux le regard de la caméra, les expressions faciales et le montage des images.










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können